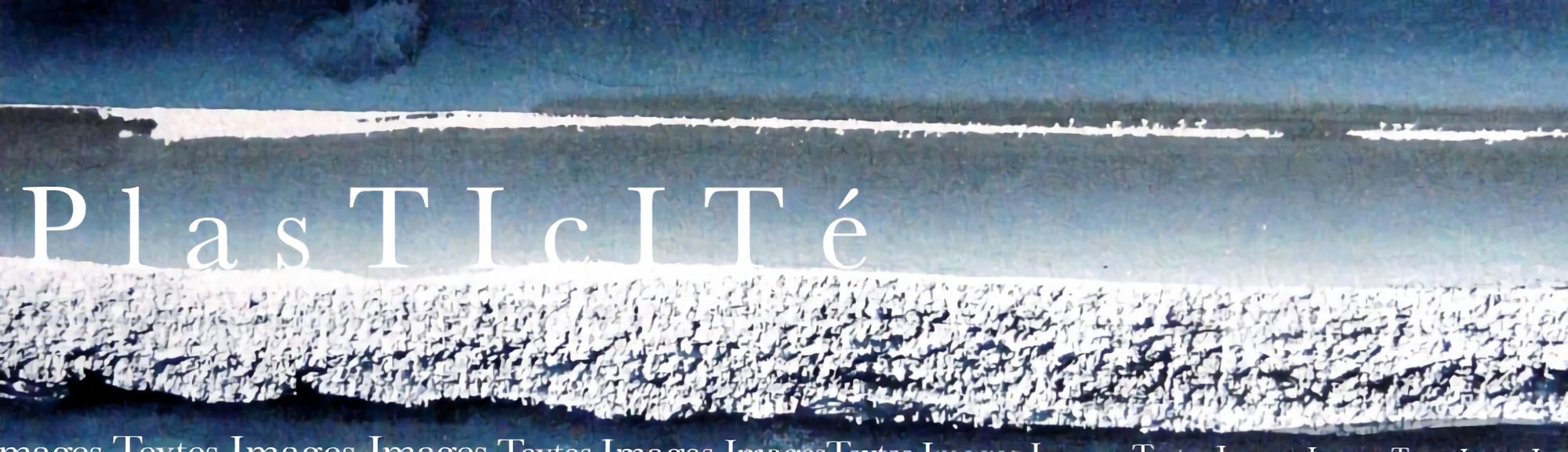Lorsqu’on se penche sur la représentation de la mafia dans la bande dessinée japonaise, le nom de Ryoichi Ikegami s’impose rapidement. Ce dessinateur, dont le trait réaliste se rapproche davantage des productions occidentales que des conventions du manga, a en effet souvent choisi de faire du milieu de la pègre le cadre fictionnel de ses œuvres, dans Sanctuary (prépublié entre 1990 et 1995) et Heat (1999-2004) notamment. L’un de ses succès les plus populaires est la série Crying Freeman, publiée de 1986 à 1988 dans le magazine Big Comic Spirits et regroupée en dix volumes1. L’histoire, écrite par le scénariste Kazuo Koike, met en scène un potier japonais, Yo Hinomura, qui intègre contre son gré les rangs d’une organisation criminelle chinoise, les Cent Huit Dragons. Celle-ci transforme le jeune homme en tueur à gages implacable par l’effet combiné de l’hypnose et d’un entraînement rude. Le seul espace de liberté qui reste à Yo, contraint d’obéir aux ordres, sont les larmes qu’il verse systématiquement après avoir abattu sa cible, d’où son surnom « Crying Freeman ». Le récit débute par la rencontre de cet homme avec Emu Hino, une jeune peintre témoin de l’un de ses assassinats, qui va bouleverser la situation dans laquelle il est enfermé. Le manga oscille ainsi entre une ambiance mélancolique, née de la contradiction entre les actes du personnage principal et ses sentiments profonds, des scènes d’action violentes et une dimension érotique très présente. L’?uvre trouve ainsi facilement sa place dans le registre du polar, si l’on considère les grandes lignes tracées par Raymond Queneau en 1945 à l’occasion de la création de la collection « Série noire » de Gallimard : « L’attention de l’auteur et du lecteur n’est plus portée sur l’intrigue, mais sur les personnages qui dessinent cette énigme […]. La brutalité et l’érotisme ont remplacé les savantes déductions. Le détective ne ramasse plus de cendres de cigarette, mais écrase le nez des témoins à coups de talon2 ». Plus précisément encore, Crying Freeman s’inscrit dans un cadre « urbain, sombre, [où] le crime s’organise, se trame au niveau individuel ou collectif3 ».
Fort de son succès auprès des lecteurs, le manga d’Ikegami et de Koike a connu plusieurs adaptations audiovisuelles4. Il a tout d’abord été décliné en série d’animation, comme il est très courant dans l’industrie culturelle du Japon. Produite par le studio Toei entre 1988 et 1994, cette adaptation en six épisodes d’une heure a la particularité d’avoir été distribuée directement en cassette vidéo, sans passer au préalable par une diffusion hebdomadaire sur une chaîne de télévision. Ce mode de distribution alternatif, très courant dans l’archipel nippon, n’a pas la connotation négative du direct-to-video anglo-saxon : il permet à l’équipe d’animation de produire son œuvre hors des contraintes télévisuelles (dates butoir de diffusion, longueur du programme imposée, censure) et de jouir, en théorie, d’une plus grande liberté artistique et technique. Ces avantages ont conduit l’industrie audiovisuelle et les spectateurs à désigner les productions empruntant ce circuit de diffusion par un terme spécifique, les OVA – pour Original Video Animation. Cette adaptation a largement contribué au rayonnement de l’œuvre originale, notamment dans les pays où le manga n’était pas encore publié. Le metteur en scène français Christophe Gans, séduit par le récit, a ainsi entrepris de réaliser une adaptation en prise de vues réelles – nous utiliserons par la suite l’abréviation PVR – à destination du grand écran. Tourné en langue anglaise, cette coproduction internationale connaît à sa sortie en 1995 un bon succès critique et commercial, et ouvre la voie à une diffusion plus large des longs-métrages adaptés de bandes dessinées japonaises.
Ces deux œuvres audiovisuelles, qui oscillent entre fidélité au découpage des planches de Ryoichi Ikegami et affranchissement du support original, constituent des objets d’étude particulièrement riches du point de vue de l’adaptation, dont l’intérêt est redoublé par les régimes d’image différents auxquels elles appartiennent. Nous proposons ainsi, dans une perspective intermédiale, de confronter ces deux objets par le biais d’une analyse comparée à travers trois axes thématiques particulièrement prégnants dans Crying Freeman, et que nous avons identifié comme caractéristiques du polar : le rapport aux décors, la mise en scène de la violence et la place du corps et de l’érotisme. Nous veillerons à ne pas tomber dans l’écueil classique de la comparaison qui introduit parfois une échelle de valeur entre les différentes adaptations et « conduit trop souvent au constat de la supériorité de l’œuvre originale5 ». Nous nous attacherons, au contraire, à explorer les spécificités inhérentes aux régimes de l’animation et de la PVR, et à mettre au jour la façon dont elles emploient, pour les mêmes scènes, des moyens qui leur sont propres. Et à l’inverse, nous nous attarderons sur leur manière de mettre leur représentation en danger, par l’emploi de formes ou de sujets précis. Nous soulignerons ainsi que la plasticité de l’animation et du cinéma PVR entre en jeu autant que celle de la bande dessinée.
Adapter : au-delà de la transcription cinématographique, la question du format et de la nature de l’image
Il convient, dans un premier temps, de préciser les modalités d’adaptation de ces œuvres, qui s’opposent sur certains aspects clés. Le premier point de divergence est bien évidemment leur format. Le film de Christophe Gans se caractérise par une sélection d’une partie de l’histoire et une condensation des éléments scénaristiques : il restreint son adaptation aux vingt-deux premiers chapitres du manga – du tome 1 jusqu’au tout début du tome 3 –, qui se terminent par la fuite de Yo et Emu après qu’ils ont repoussé la mafia japonaise qui était à leurs trousses. Ce recentrage fait ressortir plus nettement certaines potentialités du récit, notamment le combat que mène le tueur à gages pour son émancipation, intrigue finalement mise de côté dans le manga lorsque le personnage choisit, à partir du chapitre 23, de réintégrer les Cent Huit Dragons et d’accéder à la tête de l’organisation. Par ailleurs, le long-métrage déplace l’intrigue dans un contexte international, en situant la majeure partie de l’intrigue au Canada, à Vancouver, en plus de Shanghai et du nord du Japon. Ce changement, cohérent avec la réalité du développement des organisations criminelles chinoises en dehors de leurs frontières – le Canada recensait onze syndicats affiliés aux Triades sur son territoire en 19866 –, permet en outre d’ouvrir le récit aux pays anglo-saxons et plus généralement au public anglophone.
La série produite par Toei Animation, quant à elle, profite d’une durée presque quatre fois supérieure à celle du long-métrage, lui permettant de couvrir la totalité des dix tomes du manga. La spécificité de cette adaptation tient dans son mode particulier de diffusion : un seul épisode était réalisé par an, ce qui donna l’occasion au Studio Toei de modifier la composition de l’équipe technique. Trois artistes différents se sont ainsi succédés au poste de character-designer, faisant apparaître le héros sous différents jours par un trait plus stylisé ou des mimiques plus accentuées selon les épisodes. Cette souplesse dans la représentation entre d’ailleurs en résonance avec les variations d’ambiance, voire de registre, que connaît le manga à partir du troisième tome. S’engageant sur une pente résolument plus pulp, en allant puiser dans les domaines du fantastique (intrigue du sabre maudit) et de la science-fiction (les clones de Freeman fabriqués par une organisation concurrente), le récit élargit ses références visuelles à mesure qu’il progresse. L’animation épouse ces variations par l’emploi d’images et de formes (vues au rayon X des corps meurtris lors des combats, arrière-plan stroboscopique lors d’une scène d’hypnose...) souvent propres à l’épisode où elles interviennent, leur non-récurrence d’un segment à l’autre soulignant leur singularité.
Les différentes propositions de mises en scène des deux adaptations, en partie conditionnées par leur format et leur mode de diffusion, soulèvent enfin les questions de la permanence, de la transcription ou du rejet de la nature graphique de l’œuvre adaptée. Bien que ce sujet semble évident pour la version animée de Crying Freeman, dont le régime d’image conserve un rapport direct avec le graphique, nous verrons que certains choix d’adaptation non conventionnels contribuent à mettre en question la nature et les enjeux des images en mouvement. L’expression du graphique s’agence différemment dans le film de Christophe Gans, de façon moins analogue et directe. En effet, l’image photographique se caractérise par sa valeur indicielle, elle renvoie à un fragment du réel qui a existé à un moment donné devant le champ de la caméra. Le monde réel est ainsi une matière que le cinéaste doit découper et mettre en forme pour réaliser son film, en gardant à l’esprit qu’une partie de ce réel échappe toujours à son contrôle. Les images qui relèvent du graphique – peu importe les moyens techniques employés pour arriver à leur création – représentent des formes, des figures et des espaces-temps sans valeur indicielle qui les chevillent au réel. Chaque œuvre animée crée ses propres modalités de représentation. Elles résultent d’un choix d’image et d’un choix de mouvement qui témoigne de sa nature artefactuelle7, et qui s’oppose au dispositif d’enregistrement automatique de la prise de vue réelle. Cependant, le long-métrage de Christophe Gans témoigne d’une certaine résurgence de ce qui relève du « bédéique », de l’artifice plastique, bien qu’il ne s’agisse pas d’une œuvre hybride comme Sin City (Robert Rodriguez, 2005), qui fait converger l’univers graphique du comics adapté et le photographique du mode de tournage par l’emploi appuyé d’effets spéciaux numériques. Notre étude visera à qualifier au mieux les modalités d’existence des images du film de Gans, qui témoignent d’un héritage du manga, et leur discours dans un contexte cinématographique – au sens premier d’écriture en mouvement.
Mises en forme de la violence
On retrouve dans les deux adaptations de Crying Freeman une certaine fidélité au découpage des planches de Ryoichi Ikegami, repris case par case lors de certaines séquences. Pourtant, les deux œuvres développent, malgré des similitudes dans les cadrages, des mises en scène et des enjeux plastiques distincts. La différence de traitement est particulièrement manifeste lorsqu’on se penche sur l’utilisation du montage et sur la présence du ralenti. La scène de l’assassinat du chef yakuza en livre un exemple assez parlant. Se déroulant devant un poste de police, la séquence est commune aux deux adaptations. Dans la série du Studio Toei (épisode 1, [00:10:15] à [00:12:35]), Yo, le visage recouvert par un masque, se précipite sur le mafieux au moment où il sort du bâtiment accompagné de deux hommes de main. Pris par surprise, les membres du groupe n’ont pas le temps de dégainer leurs armes ni de se replier dans la voiture qui les attend : Freeman abat les gardes du corps puis tire une balle dans la tête de sa cible avant de repartir en courant. Le crime, commis en l’espace de quelques secondes du point de vue diégétique, est ici étiré par l’utilisation du ralenti, qui insiste sur les gestes des personnages et leur visage lorsqu’ils réalisent ce qui est en train de se dérouler. Il s’agit d’un emploi relativement classique de ce procédé visuel, qui confère davantage de poids dramatique aux événements. Il permet également de rejouer un « effet-BD », en soulignant les poses des personnages, comme un reflux du découpage en phases fixes des planches dessinées.
Le recours au ralenti n’est toutefois pas anodin lorsqu’il intervient dans le cadre de l’animation : la dilatation temporelle de plus en plus forte laisse entrevoir une certaine fixité, tabou absolu des images animées. L’immobilité marque en effet la fin de l’illusion de la vie, de l’enchantement suscité par le dispositif et ouvre sur une peur du vide, de la disparition. Selon le mot de Dick Tomasovic, « [i]l y a bien, dans toute image animée qui se fige, une révélation de la mort avec son cortège d’émotions douloureuses8 ». En cela, la fixité se pense comme une limite des possibilités de représentation de l’animation, qui se définit premièrement par le mouvement, ou tout du moins par son impression lors du visionnage. Cependant, la « mise en danger » du dispositif de l’animation n’apparaît pas comme la donnée théorique première de cette scène, puisque le spectateur moyen ne serait pas gêné par son déroulement. La raison, comme souvent avec le cinéma d’animation, est paradoxale : l’illusion du récit et l’immersion sont maintenues par le ralenti, par la forme cinématographique qui pourrait justement les faire vaciller. C’est par la façon dont elle se réfère à des habitus, à des conventions visuelles extérieures et préétablies que la scène assure sa continuité : la référence avouée aux polars hongkongais (notamment de John Woo) et leur esthétisation accrue de la violence prend un temps le relais, laissant les questions de représentabilité propres à l’animation en arrière-plan.
La démarche est rendue d’autant plus efficace par le réagencement des événements opéré par la mise en scène pour leur donner une incarnation cinématographique pleine. Les quelques planches du manga consacrées à cet assassinat sont ainsi traitées comme une matière-image pouvant être remodelée sans toutefois perdre son unité. L’exemple le plus frappant est la présence des deux gardes du corps : situés de chaque côté du criminel qu’ils défendent, ils apparaissent d’abord au sein du même plan, cadrés au niveau de la hanche. Puis, lorsqu’ils prennent conscience du danger qui arrive, ils sont montrés l’un après l’autre en gros plan, fouillant dans leur veston pour saisir leur pistolet. Enfin, ils sont réunis au sein d’un split-screen où l’un constate piteusement qu’il n’est pas armé, tandis que l’autre relève la tête vers Freeman. Ces deux réactions, ici séparées, sont partagées par les deux sbires dans le manga (chapitre 3, quatorzième planche). Les deux cases où ils regardent l’assaillant avec détermination sont alignées verticalement en haut à gauche de la planche, tandis que celles où ils remarquent qu’ils n’ont pas de revolver se retrouvent en bas à droite. La série animée les réunit de manière arbitraire, dans une opération de montage qui évoque une cartographie mentale de la page : deux points forts de l’image sont réunis, malgré leur éloignement sur la planche, par le travail du souvenir laissé au lecteur. L’adaptation met ainsi au jour l’« état sériel » de la bande-dessiné, issu de « la simultanéité et le panoptisme obligés de ses unités9 ». De façon similaire, la série invente de toutes pièces l’image de la tête de l’une des victimes qui traverse la vitre de la voiture, tout comme le face à face qui précède la mise à mort du yakuza. Dans l’œuvre originale, le tueur à gages et sa cible ne coexistent que dans seule image, celle du coup de feu, étalée sur une double-page. Privée de ce moyen d’emphase, l’équipe chargée de l’animation a ainsi trouvé, en dilatant la temporalité, un moyen d’insuffler une intensité tout au long de la séquence.
Les décors à contre-emploi : fonctions « réalisante » et « déréalisante »
Dans le long-métrage réalisé par Christophe Gans, le poids dramatique est davantage assuré par une forme de surenchère, qui s’incarne moins dans la mise en scène à proprement parler que dans les conditions fictionnelles dans laquelle la séquence se déroule : les deux gardes du corps deviennent un groupe entier, le protagoniste principal reçoit l’appui d’un sniper allié, la retraite du chef yakuza est coupée par l’explosion de sa voiture. Contrairement à la scène d’introduction et aux dialogues entre Emu et Yo, qui sont chevillés à l’agencement des cases du manga, les séquences d’action s’affranchissent de ce modèle et laissent place à une mise en scène plus personnelle, qui se tourne volontiers vers l’artifice, vers l’effet (pyrotechnique ou visuel). Cette approche influe particulièrement sur la place qu’accorde le film à ses décors, et le champ de signification qui en découle. Il est très intéressant de noter que les arrière-plans dessinés par Ryoichi Ikegami suscitent une forte impression de réalisme : des amples paysages nocturnes de Shanghai ou Tokyo – parfois retranscrits avec l’appui de véritables photographies, dont le contraste est ajusté par souci d’homogénéité avec le dessin en noir et blanc10 – aux intérieurs chinois lourdement ornementés, le travail du dessin permet, par le détail, d’accéder à un effet de réel qui sert d’ancrage au caractère hors du commun du milieu du crime organisé et des états d’âme des personnages principaux. De plus, la récurrence de lieux typiques du polar (chambre d’hôtel, quais, entrepôts, commissariat), confère au récit une familiarité qui contrebalance le profond romantisme de l’intrigue de départ. La volonté de prise sur le réel par le biais des décors, poussée donc jusqu’au recours au caractère indiciel de la photographie, se retrouve néanmoins inversée dans l’adaptation cinématographique en prise de vue réelles. Le long-métrage de Christophe Gans emploie à plusieurs reprises ses décors comme facteur « déréalisant », qui trahit l’existence d’une mise en scène. La séquence se déroulant dans le manoir d’Emu, où Freeman la défend de mafieux qui entrent par effraction chez elle, en livre un exemple parlant. Un plan en particulier se détache de l’ensemble : celui où le tueur à gages se hisse en haut d’une porte pour s’y tenir debout, en attendant de tomber par surprise sur les hommes de main ([00:34:11] à [00:34:21]). La rareté de l’angle de caméra choisi pour représenter l’action laisse deviner son lien direct avec la bande dessinée : peu de films de cinéma mettent en scène des plans zénithaux, où la caméra est installée à la verticale au-dessus des interprètes, du fait notamment des moyens techniques importants qu’ils nécessitent. De plus, l’ascension de Yo est accompagnée par un mouvement d’appareil, qui se termine à plusieurs mètres du sol. Ce travelling, appuyant un cadrage déjà atypique, amène un sentiment de sursignification : la hauteur exprimée par le plan semble subitement trop importante, même pour les larges pièces d’un manoir, et met en question le point de vue offert par la caméra. Par reconstitution mentale de l’espace, le spectateur « sent » le plafond dans le hors-champ, et l’appareil recule sans peine alors qu’il devrait logiquement le percuter. Cette contradiction ne rappelle pas seulement au spectateur le fait que la caméra, comme dans toute scène, ne fait pas partie de l’espace diégétique. Il s’agit aussi d’une désignation concrète d’une réalité du tournage : ce décor de studio ne possédait pas de plafond. Le décor de cinéma, présence devant habituellement rester transparente pour ne pas perturber l’immersion dans la fiction, se retrouve ainsi dévié de sa fonction traditionnelle et révèle une des « coutures » avec laquelle le film est assemblé.
À plusieurs reprises au cours du long-métrage, les décors incitent subtilement le spectateur à adopter une position de recul. Ils remplissent leur fonction classique de définition du cadre de l’action et n’entravent pas le déroulé du récit, mais suggèrent également autre chose que leur simple apparence. La représentation de la forêt offerte par le film est à ce titre éloquente, puisqu’elle confère un caractère immédiatement non-naturel à un environnement qui relève justement de la nature, sans que la raison saute immédiatement aux yeux. Est-ce à cause de la densité des arbres à l’image, qui contraste avec toutes les scènes d’intérieur ? Est-ce la photographie, qui donne aux plantes une couleur trop franche ou trop profonde ? De façon générale, les scènes d’extérieur près de la maison du potier (de [00:48:47] à [00:50:42], puis à nouveau lors de la longue séquence de fin de [01:25:44] à [01:37:33]) laissent une impression d’irréel, en particulier les statues, supposément en pierre, dont la manière d’accrocher la lumière révèle une surface trop peu mate. Ce sentiment est alimenté par le goût du factice du réalisateur, qui redouble l’impression de carton-pâte des statues en montrant que l’une d’elle est fausse et dissimule une cachette d’armes. Christophe Gans transforme également l’environnement naturel de la forêt en lieu de tous les artifices et effets pyrotechniques du cinéma de divertissement. L’arrière-plan de l’image devient ainsi, lors de la dernière scène d’action du film, un lieu d’expériences plastiques, où interviennent plusieurs éléments : des feuilles mortes volant dans tous les sens, une brume épaisse héritée du cinéma d’action asiatique, mais aussi une utilisation du flou qui fait ressortir les visages au premier plan, et des ralentis soulignant autant le poids des chutes que la force des explosions. La réalisation de Christophe Gans, sous couvert d’habiller ses scènes pour les besoins de l’action, sélectionne aussi ses effets de mise en scène pour leur capacité à « donner à voir » une image, à inciter celui qui la contemple à dédoubler son regard. De cette façon, il opère un croisement entre matière et image qui entre en résonance avec le statut d’adaptation de son film. Une des rares scènes inventées pour les besoins du long-métrage cristallise ce qui se joue thématiquement et esthétiquement dans l’œuvre de Gans ([00:43:25] à [00:44:58]). Un policier, lancé à la poursuite d’Emu, a un accident de voiture au cours duquel meurt sa coéquipière. S’échappant du véhicule retourné et en feu, il est projeté par une explosion sur le mur situé près de lui, qui s’enfonce légèrement sous le choc : il s’agit en réalité d’une toile tendue, peinte en gris pour simuler la surface du béton. La matière diégétiquement solide devient subitement souple et malléable aux yeux du spectateur. Recouvrant la totalité du photogramme, le faux mur en toile se confond symboliquement avec la matière de l’image filmique, elle-même pétrie, remodelée, façonnée « à l’image » d’une œuvre graphique préexistante. Le long-métrage s’ouvre ainsi à une réflexion sur la composition et recomposition des œuvres graphiques et cinématographiques, s’aventurant doucement vers des champs habituellement réservés à l’animation.
Le corps à l’image : composer avec sa présence, compenser son absence
Parmi ces considérations au sujet de l’image, de l’adaptation et de la représentation, la question du corps reste à explorer. L’érotisme au cœur de l’œuvre de Ryoichi Ikegami et Kazuo Koike se décline de façon différente dans la série et dans le long-métrage, pour une raison de dispositif en premier lieu. Comme le souligne Marcel Jean, « Le corps de l’acteur est […], au cinéma, l’élément à travers lequel des images animées deviennent, justement, plus que des images. C’est à travers le corps que les images prennent vie, que l’illusion du mouvement […] est transcendée pour devenir la représentation de la vie même11 ». La principale caractéristique de l’animation serait donc, d’après l’auteur, une absence de corps réels qui entraîne ce régime d’image vers d’autres considérations esthétiques. Une autre raison de la différence entre les deux adaptations tient à leur système de production et de diffusion. Comme nous l’avons déjà évoqué, la publication de la série directement en vidéo permet de contourner les impératifs de chaînes de télévision. En revanche, pour une coproduction internationale à destination des salles de cinéma, les enjeux sont différents. L’impératif de rentabilité conditionne plus étroitement les possibilités d’expression de l’?uvre, qui peut difficilement proposer une dimension franchement érotique sans se fermer au grand public et à certains réseaux de distribution. L’implication demandée aux interprètes n’est pas la même également. La nudité demeure assez rare dans le divertissement hollywoodien, auquel le film s’apparente dans sa logique de production. Les deux adaptations de Crying Freeman se situent donc sur deux voies parallèles, mais circulent en sens inverse : l’une doit composer avec la présence du corps, tandis que l’autre doit en compenser l’absence. Ces postures influencent la représentation du sexe à l’écran, mais aussi le sens esthétique qui en découle.
Les adaptations de Crying Freeman ne peuvent éluder totalement la question du désir charnel puisque c’est la scène d’amour entre Emu et Yo qui noue l’enjeu narratif principal : le tueur à gages, venu éliminer la jeune femme qui a été témoin de son précédent assassinat, accède à sa requête de connaître un homme une fois dans sa vie avant de mourir, et tombe amoureux d’elle. La version de Christophe Gans opte pour approche brève. La représentation de la nudité, à l’exception d’un plan de Yo vu de dos dans un miroir, est évitée. Des travellings ralentis viennent insister sur le dos, les bras et les expressions de plaisir des personnages, mais la mise en place d’une ambiance voluptueuse est entravée par un montage alterné, qui montre une discussion entre un policier et un membre de la mafia à l’extérieur du manoir. Il s’agit de la seule séquence introduisant une forme d’érotisme, contrairement au manga et à son adaptation animée, qui mettent en scène de manière récurrente la nudité des protagonistes ainsi que des relations sexuelles. La série retranscrit la séquence d’amour en reprenant scrupuleusement l’ensemble des cases du sixième chapitre, et prend davantage de temps pour montrer le jeu de séduction qui précède l’acte – les dialogues suggestifs et l’effeuillage progressif des deux amants. En cela, la version animée s’oppose aux considérations générales de Marcel Jean sur la représentation du sexe dans le cinéma d’animation. Selon lui, les propositions tiennent soit de la « parodie, [de l’]immense farce visant à tourner en dérision l’inaccessible12 », soit du malaise profond, imposant la sexualité « comme l’une des forces qui domine l’homme », qui « appartient au domaine de l’inavouable » et qui s’exprime « par des débordements, dans une atmosphère trouble, souvent baignée de violence13 ». La série Crying Freeman échappe totalement à ces descriptions et aborde son sujet comme si elle oubliait que les personnages sont fictifs et les corps absents. La dimension érotique diffère donc de celle du film, puisqu’elle est développée sur un temps continu, et portée par une représentation plus explicite de l’acte (écartement des cuisses, pénétration), bien que les appareils génitaux des deux amants restent dissimulés. L’érotisme trouve toutefois dans les deux versions un autre point d’accroche à travers un élément visuel récurrent : le tatouage.
Le tatouage, entre définition de l’identité et érotisme
Dans le manga, le tatouage apparaît à plusieurs reprises en pleine page. C’est le cas de celui de Freeman, qui porte un dragon dans le dos et sur son torse, que l’on aperçoit dès la première illustration. De nombreux autres protagonistes dévoilent leur tatouage au cours des dix tomes, attestant du lien étroit entre cet ornement et l’identité de la personne. En effet, le tatouage se définit en premier lieu comme marqueur social :
Incorporé, introduit sous la peau, introjecté, le discours symbolique est inscrit pour toujours ; en cela, il manifeste une quête d’absolu. En délimitant ce qui relève de la culture en opposition avec la nature, il exalte aussi ce qui est caché sous la peau et prend le sens d’un blason. Rite de passage qui scande le temps social, il marque le passage à un autre état de conscience, non seulement en raison de la douleur à fonction cathartique, mais aussi par la transformation qu’il produit dans le corps et le psychisme du tatoué et dans le regard que la société porte sur lui14
Longtemps associé à la marginalité et au milieu criminel, le tatouage est encore utilisé aujourd’hui parmi les yakuza et les Triades comme rite d’entrée dans l’organisation15. La permanence du tatouage marque également un point de non-retour, un engagement dont on ne peut plus se défaire. Cela en fait un élément privilégié pour incarner le conflit de Yo, à qui les Cent Huit Dragons ont imposé ce symbole comme une nouvelle peau, comme une nouvelle identité. Mais le tatouage dans Crying Freeman reste néanmoins chargé d’ambiguïté, puisqu’il est aussi source de désir, sans que cela tienne uniquement au dévoilement du corps. Tous les personnages importants dans le récit portent un tatouage d’animal dangereux (dragon, tigre, serpent...) perçus comme des totems et décrits à plusieurs reprises comme exerçant une influence sur le comportement de leur porteur et leur philosophie de vie. Occasionnellement, la révélation du tatouage crée la surprise car il est associé à un personnage ou un type de corps inattendu (celui de la nonagénaire Fu Furin dans le chapitre 11), mais le plus souvent le geste de dévoilement agit à la fois comme une déclaration d’appartenance à un groupe et une mise en garde. Il crée alors une tension qui prend souvent un caractère sexuel en mêlant le désir avec le danger.
Le générique d’ouverture du film (de [00:00:28] à [00:03:33]) exprime parfaitement cette ambivalence. Composé d’une succession de gros plans sur des parties d’un corps masculin, il évoque d’emblée la trajectoire érotique du récit tout en réaffirmant la question de l’identité : si le spectateur peut identifier le modèle filmé comme étant Yo, ce n’est pas grâce à son visage ou sa silhouette qui restent hors-champ, mais par la présence du dragon qui couvre son dos et son torse. Par ailleurs, la séquence incarne métaphoriquement l’émancipation du personnage en ayant recours à l’animation, ou plus précisément aux effets spéciaux par images de synthèse : le tatouage se met subitement en mouvement et descend le long des membres de l’acteur, comme si le dessin caressait son propre support. Progressivement, le corps filiforme du dragon s’épaissit puis quitte la peau du tueur à gages pour s’envoler dans les airs. Le générique met ainsi en scène un fantasme typique de l’animation en laissant la part graphique de l’image devenir autonome, déléguant la mise en scène du fantasme et du désir à un régime de représentation différent de celui de la PVR.
Le héros et sa représentation : une ambivalence propre au support papier ?
Cette proposition formelle tisse un lien, par les moyens de l’animation, entre le domaine du graphique et le corps physique capté par la prise de vue réelle. Il s’agit du seul recours explicite du film à l’animation, mais il soulève une autre question plus complexe : celle de la persistance des objets fictionnels dans la bande dessinée appartenant au domaine du graphique (dessins, tableaux...) et de leur modalité d’existence au sein du nouveau régime d’image où ils sont réincarnés. Le personnage d’Emu étant peintre, le portrait de Yo qu’elle réalise après leur première rencontre apparaît comme la manifestation la plus évidente de ce type d’objets. Le tableau sert de moyen de conjuration du désir qu’elle éprouve pour le tueur à gages, il symbolise une présence par procuration qui n’appelle qu’à être remplacée par le modèle peint. L’irruption de Yo dans la maison arrivera fatalement car elle suit une règle donnée par Emu en voix off : un assassin chinois qui vous donne son nom reviendra vous tuer. Par ailleurs, le tableau occupe une place particulière dans le manoir. Il n’est ni accroché au mur, ni posé dans le coin d’une pièce, mais laissé au fond d’un couloir sombre, au milieu du passage. Pour surprendre sa victime, Freeman a ainsi l’idée de se substituer à l’image, en reprenant une pose identique. Au moment où Emu allume la lumière, il apparaît en pleine page (chapitre 4) : ses jambes et sa tête dépassent du cadre, une ombre sur sa manche fait comprendre qu’il avance sa main vers la jeune femme, mais le souvenir de la peinture aperçue plus tôt dans le même chapitre entretient la confusion avec le modèle, même après avoir remarqué ces détails. L’écrasement des perspectives des cases montrant l’assaillant, toujours cadré de face, facilite l’association mentale avec le tableau. L’aplat n’est finalement brisé que par une vue de profil du couteau dépassant du cadre. Mais l’effet de confusion demeure particulièrement réussi du fait de l’absence de différenciation immédiate entre un dessin d’un tableau de Freeman et un dessin de Freeman lui-même : les deux partagent le même support et relèvent d’une mise en forme graphique opérée par Ryoichi Ikegami. La distinction entre l’image et le sujet est en premier lieu fictionnelle : c’est le contexte du récit qui aide à saisir l’enjeu de la situation, qui demeure ambiguë pour un lecteur n’ayant pas connaissance des précédentes pages.
Les deux adaptations abordent chacune la scène à leur manière. La série d’animation, qui relève elle aussi du domaine graphique, peut jouer de cette ambivalence, mais le fait finalement avec un degré moindre. Bien qu’elle reprenne le cadrage de face et l’effet de révélation par la lumière, la perspective est rendue différemment, et on prend conscience que le noir et blanc du manga participait beaucoup à l’effet. Le film en prise de vues réelles, quant à lui, choisit de modifier complètement la scène, le réalisateur ayant probablement réalisé la difficulté à rendre manifeste la confusion entre un tableau peint et de véritables acteurs. L’idée du décadrage est cependant conservée : Emu aperçoit d’abord son tableau brûlant dans la cheminée avant de lever les yeux et de remarquer dans un miroir la présence de Yo, qui est malgré tout renvoyé au domaine de l’image ([00:26:30] à [00:27:10]). En revanche, le long-métrage propose une relecture intéressante de la scène où Yo est enchaîné nu à une statue de femme, pendant qu’un représentant des Cent Huit Dragons le soumet à des poisons (chapitre 10). Là encore, il est possible de voir dans le manga une correspondance entre le héros et la statue, non pas en termes de traits et de dessin, mais au sens plus général de matière, de support et de représentation. Enlacés dans une pose érotique, les deux corps incarnent un idéal de beauté et sont graphiquement indifférenciés – la case prise en dehors du récit ne permet pas de comprendre que Yo est en présence d’une statue. Seul le contexte fictionnel permet de différencier avec certitude la nature des corps et met en question cette apparente ressemblance : en plus de souligner le réalisme et le détail de la statue, la comparaison renvoie le corps de Yo au statut d’objet, d’identité attrayante mais construite, et interroge la représentation de l’inerte au sein d’un média constitué d’images fixes. Christophe Gans traduit ce passage en une séquence de cauchemar, puisant les lumières et l’imposant maquillage du tortionnaire dans l’imaginaire du film d’horreur ([00:56:35] à [00:57:49]). En point d’orgue de la séquence, au moment où le piège des Cent Huit Dragons se referme sur Yo, la statue ouvre les yeux et montre ses dents pointues. Le rapprochement entre le héros et la silhouette en pierre, qui découle de la nature graphique de l’?uvre originale, trouve ici une nouvelle expression. La statue servant au tournage de la scène est remplacée par un acteur lors des deux derniers plans sur son visage. Cette substitution, avec l’appui du maquillage et du montage, opère le même lien que le manga entre l’inerte et le mouvant, la représentation et le sujet représenté, en ramenant la silhouette de pierre dans le domaine de la matière organique auquel appartient le corps vivant de Yo.
Conclusion
Dans le cadre d’une adaptation passant d’un régime d’image à un autre, il semble toujours possible de détourner les enjeux esthétiques d’une séquence, de les interpréter autrement, lorsque les rejouer sur le même terrain ne fonctionne pas : « Plus les qualités littéraires de l’œuvre sont importantes et décisives, plus l’adaptation en bouleverse l’équilibre, plus aussi elle exige de talent créateur pour reconstruire selon un équilibre nouveau, non point identique, mais équivalent à l’ancien16 ». Ce principe d’équivalence énoncé par André Bazin est constamment mis en jeu dans les deux adaptations de Crying Freeman, qui inventent, chacune avec ses moyens propres, des déclinaisons possibles de chaque proposition formelle. Les correspondances facilitées entre bande dessinée et animation, toutes deux relevant de l’univers graphique, ne se font finalement pas au détriment de l’adaptation en prise de vues réelles, dont la différence ontologique avec l’image manufacturée lui laisse peut-être plus d’espace pour fonctionner par opposition, pour oser la recomposition de certaines scènes ou thématiques. La mise en rapport des deux œuvres a également permis de révéler non seulement leurs différences, mais aussi leurs contradictions internes : un même effet, comme le ralenti, peut prendre une signification différente en fonction de la proposition formelle qui l’accompagne, mais aussi en fonction du régime d’image au sein duquel il s’inscrit. L’étude comparée de l’adaptation animée et celle en PVR, enfin, a contribué à la mise en question de la représentation et des possibilités de l’image. Des possibilités de dialogue ont émergé lors de l’analyse de la place des corps et de l’érotisme, les effets spéciaux numériques et le maquillage servant de passerelle entre deux matières d’image.
Les deux œuvres audiovisuelles, marquées par leurs renvois très récurrents aux planches de Ryoichi Ikegami, mériteraient d’êtres mises en rapport avec une autre adaptation, moins soucieuse de l’utilisation du manga comme storyboard – peut-être les deux longs-métrages hongkongais, s’ils deviennent plus accessibles un jour. La confrontation entre une hypothétique nouvelle déclinaison du manga et celles analysées ici permettrait certainement de mettre au jour de nouveaux modes de translation, de commutation et de remodelage du langage de la bande dessinée, notamment si cette future adaptation s’inscrit davantage dans les types, formats et pratiques d’images qui ont émergé avec l’avènement du cinéma numérique.