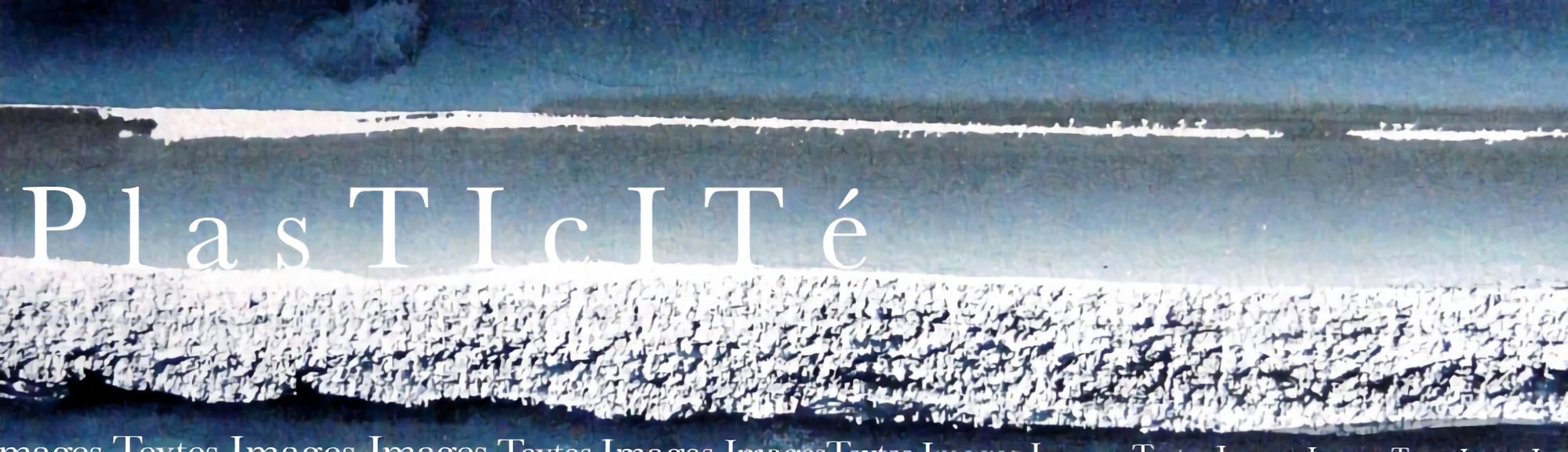Psycho1 est sans doute le film le plus plagié, copié, remaké, parodié, recyclé2, et peut passer pour l’alpha et l’omega du cinéma. Il est donc devenu un archétype déclinable à l’infini, que l’on peut faire glisser d’un genre et d’un registre à un autre, du thriller au film d’horreur par exemple, ou utiliser à des fins burlesques, comme Brian de Palma, qui, dans Phantom of the paradise (1974), remplace le couteau par un déboucheur d’évier3. Mais on peut aussi le reprendre en ne modifiant qu’un paramètre technique, la couleur par exemple : il s’agit alors d’un remake en couleurs réalisé par Gus Van Sant (Psycho, 1998) qui copie le film plan par plan, en ajoutant quatre plans. Gus Van Sant joue sur les affects induits par la couleur - qu’Hitchcock justement voulut éviter. On peut aussi le reprendre en modifiant la vitesse de défilement de l’image : tel est le choix de Douglas Gordon, dans 24 hour Psycho (1993).
Cette installation vidéo est projetée dans des structures muséales, et en particulier elle le fut au Museum of modern art (MOMA) à New York en 2006 - après avoir été installée à Glasgow et Berlin au moment de sa création, en 1993. Un des personnages de la fiction de Don DeLillo Point omega4 visite cette installation. Le narrateur décrit cette expérience de la transposition du film original d’Hitchcock de la façon suivante :
C’était de l’histoire qu’il regardait, en un sens, un film connu de tous et partout. Il jouait avec l’idée que la salle était une sorte de site préservé, la maison ou la tombe isolée de quelque poète défunt, une chapelle médiévale. C’est là, le motel Bates. Mais ce n’est pas ce que voient les gens. Ce qu’ils voient, c’est le mouvement fragmenté, des arrêts sur image en lisière d’une vie engourdie5. Il comprend ce qu’ils voient. Ils voient une salle en état de mort cérébrale dans un bâtiment de six étages resplendissant d’art accumulé. Le film original est ce qui compte à leurs yeux, une expérience ordinaire qu’on peut revivre sur un écran de télé, chez soi, avec la vaisselle dans l’évier6.
Douglas Gordon et Don DeLillo nous convient à une expérience non ordinaire du film d’Hitchcock, et introduisent une réflexion sur le temps et le mystère des choses que nous côtoyons sans les voir avec profondeur. Alors, la première réaction face à cette vidéo silencieuse et d’une lenteur extrême peut être celle d’une visiteuse qui s’interroge - « Qu’est-ce que je suis en train de regarder, là7 ? » - ou peut-être la réaction de ceux qui n’éprouvent « nul besoin de s’éterniser dans une pièce hermétique où ce qui se passait prenait, à se passer, un temps infini8. » Que regarde-t-on ? Quel nouveau spectateur Gordon fabrique-t-il et quel nouveau lecteur Don Delillo façonne-t-il ?
Ce que la vidéo fait au film. De l’art du suspense à l’art du suspens
La vidéo fait subir au film un étirement sur vingt-quatre heures : le personnage de Point omega peut voir ce film intégralement sur plusieurs jours - le film s’arrêtant au moment de la fermeture du musée et reprenant le lendemain matin. La vidéo dilate les plans, donnant alors une image du temps qui résiste au flux continu, au flot de la vitesse technologique que Don DeLillo médite dans tous ses récits. Cette manipulation entrave évidemment la dynamique classique fondée sur l’image-action définie par Gilles Deleuze9, et à laquelle Hitchcock est généralement rattaché, image-mouvement qui assure une progression déterminée dans le sens d’un enchaînement d’une action et d’une réaction, de la cause et de l’effet nécessaire à l’avancée de l’histoire et qui comprend des attentes anticipatoires de la part du spectateur. Or ici, une décomposition affecte chaque scène, chaque geste :
Qu’un acteur remue un muscle, que des yeux cillent, et c’était une révélation. Chaque geste était divisé en composantes si distinctes du tout que le spectateur se trouvait coupé de tout recours à l’anticipation10.
En effet, la vidéo défait la représentation pour nous amener peu à peu à une révélation. Prenons l’exemple de la séquence de la douche : depuis le plan rapproché de Marion de dos contre le rideau de la douche jusqu’au plan où l’on voit Norman Bates sortir de la maison et se diriger vers le motel, cette séquence dure deux minutes trente-neuf secondes et comprend quarante-six plans, comme le rappelle Martin Lefebvre11. Hitchcock était très fier de cette prouesse inédite au cinéma. La vidéo ralentit la scène et lui enlève les effets du montage frénétique. Le narrateur de Point Omega rend alors les pensées du visiteur dans les termes suivants :
Il songea qu’il aurait voulu chronométrer la scène de la douche. Puis que c’était bien la dernière chose qu’il voulait faire. Il savait que la scène était très brève dans le film original, moins d’une minute, c’était bien connu, et il avait regardé ici même la scène étirée quelques jours plus tôt, tout en mouvement morcelé, sans suspense, sans effroi, sans la chouette. Des anneaux de rideau, voilà ce qu’il se rappelait le plus clairement, les anneaux du rideau de douche qui tournent sur la tringle quand le rideau est arraché, moment perdu à vitesse normale, quatre anneaux qui tournent lentement au-dessus du corps affaissé de Janet Leigh, étrange poème au-dessus de la mort infernale, et puis le tourbillon de l’eau ensanglantée, qui submerge la bonde, minute par minute, pour finalement s’y engouffrer. Il mourait d’envie de revoir la scène. Il voulait compter les anneaux du rideau de douche, peut-être quatre, mais peut-être cinq, ou plus, ou moins12.
Comme il y en a en réalité neuf, cette erreur prouve encore les limites de notre capacité perceptive et de notre capacité à témoigner des choses que nous sommes censés voir dans l’image qui défile normalement. La scène reprise en vidéo, privée de son, déforme la scène filmée qui se caractérise par la rapidité, et modifie la perception de l’action, lacunaire du fait de la succession des plans, trop rapide pour un œil normal. Dans la vidéo, se demande encore le visiteur, « [p]ouvait-on qualifier de scènes, à ce point d’amortissement, ce développement élémentaire d’un geste, l’arc interminable qu’une main trace sur un visage13 ? » Ceci revient à dire que la forme ne saurait s’épuiser, ne saurait que continuer, s’élaborer sans fin. Il faut se faire à « [c]ette idée qu’il ne se passe rien […] [c]ette idée d’attendre pour attendre14. » « Quelque chose suit son cours » – comme ce grand maître de l’attente, Beckett, le fait dire à Clov par deux fois dans Fin de partie, lorsque Hamm demande « qu’est-ce qui se passe15 ? » La vidéo place le spectateur dans un inchoatif durable. Ce spectateur attend toujours la suite dans un présent étiré, et pourrait reprendre à son compte les premiers mots de Fin de partie qui marquent le début perpétuel et la fin toujours différée16. Tout le récit de Don DeLillo développe le champ lexical du temps suspendu.
Précisément, la vidéo effectue un relâchement de la narration filmique : il n’y a plus de narrativité et Gordon, par le ralenti, transforme le film en tableau, compromettant du même coup le genre auquel appartient ce film, le thriller : « Ce qu’il regardait c’était comme du film pur, du temps pur. L’horreur du vieux film d’épouvante était absorbée dans le temps17. » Le visiteur expérimente ainsi un temps sans ligne directrice, sans contenu narratif orienté, qui n’est marqué ni par le choc, ni par la surprise, ni par l’avènement, un temps non événementiel, asignifiant. Alors la vidéo révèle l’invraisemblance qui sert à la construction de la logique de l’histoire hitchcockienne, cette invraisemblance acceptable, assimilable par le spectateur :
Il ne pouvait pas comprendre pourquoi le détective, Arbogast, visiblement poignardé une fois au-dessous du cœur, dévale tout l’escalier avec des blessures au visage. Peut-être est-il prévu que le spectateur imagine un deuxième et un troisième et un quatrième coup de couteau mais il n’avait pas envie de le faire. Il y avait un décalage flagrant entre l’action et son effet visible18.
La vidéo rend sensible le fait que dans le film tout n’est pas visible aisément - le nombre de crochets du rideau de douche par exemple - ou que tout n’est pas montré : la vidéo exhibe l’artifice du montage, qui raccorde des plans mais laisse beaucoup de matière existante, de vie réelle entre ces plans, une masse continue qui est évacuée de la mise en scène. Gordon fait ressortir une latence dans l’image, une masse visuelle continue, dont l’image défilant à vitesse normale ne rend que des pans plus éclatants que les autres. La vidéo rend ce qui borde ces pans saillants que la mémoire du spectateur retient - par l’effet de choc ou de surprise - elle remet au premier plan les transitions, ce qui est « entre » - ce mot est le plus important de la citation supra. La vidéo suggère ce qui devrait se voir entre ces plans « actifs » pour qu’ils aient un sens - d’autres coups de couteaux se portant sur Arbogast par exemple.
Ce que la vidéo fait au spectateur : une expérience de la contemplation et de l’absorption, presque hypnotique
La vidéo exige une « concentration totale 19» une « absolue vigilance20 » impitoyable et une pénétration des profondeurs de l’image, jusqu’à l’imperceptible. L’analyse menée par le narrateur développe largement un champ lexical qui traduit cette absorption du spectateur - nous soulignons dans les deux citations suivantes :
Moins il y avait à voir, plus il regardait intensément, et plus il voyait. C’était le but du jeu. Voir ce qui est là, regarder, enfin, et savoir qu’on regarde, sentir le temps passer, avoir conscience de ce qui se produit à l’échelle des registres les plus infimes du mouvement21.
L’exercice de l’œil est une épreuve :
L’homme pouvait compter les gradations du mouvement de la tête d’Anthony Perkins. Anthony Perkins tourne la tête en cinq phases croissantes plutôt que dans un mouvement continu. C’était comme les briques d’un mur, qu’on peut dénombrer distinctement, pas comme le vol d’une flèche ou d’un oiseau. Là encore, ce n’était ni semblable à autre chose ni différent. La tête d’Anthony Perkins pivotant, interminablement, sur son long cou maigre. Seule une observation intense ouvrait à une telle perception22.
Don DeDillo exprime une relation au monde qui se fonde sur la présence extrême dans l’instant coupé de la ligne temporelle, présence attentive et dépassant presque les capacités humaines. Cette acuité et cette pénétration inhabituelles peuvent nous déciller, en nous sortant de l’illusion de « ce que nous croyons voir quand nous ne le voyons pas23. » Cette vision du monde rappelle les analyses menées par Georges Didi-Huberman, qui donne à un de ses essais le titre Ce que nous voyons, ce qui nous regarde et pose la question d’une anthropologie visuelle dès les premières pages :
Ouvrons les yeux pour éprouver ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne verrons plus – ou plutôt pour éprouver que ce que nous ne voyons pas, de toute évidence (l’évidence visible) nous regarde pourtant comme une œuvre (une œuvre visuelle) de perte. Bien sûr, l’expérience familière de ce que nous voyons semble le plus souvent donner lieu à un avoir : en voyant quelque chose, nous avons en général l’impression de gagner quelque chose. Mais la modalité du visible devient inéluctable – c’est-à-dire vouée à une question d’être – quand voir, c’est sentir que quelque chose inéluctablement nous échappe, autrement dit : quand voir, c’est perdre. Tout est là24.
Don DeLillo, autant dans son écriture poétique qui fait éclater des points énigmatiques, points omega - point ultimes - du sens, que dans son approche de la réalité, a le souci du détail qui pourrait rattraper cette perte :
Une extrême attention est requise pour voir ce qui se passe devant soi. Du travail, de pieux efforts sont nécessaires pour voir ce qu’on regarde. Cela le fascinait, les profondeurs qui devenaient possibles dans le ralenti du mouvement, les choses à voir, les profondeurs de choses si faciles à manquer dans l’habitude superficielle de voir. Des gens, de temps en temps, qui projetaient une ombre sur l’écran25.
La posture du spectateur devient très particulière, l’inscrivant dans un temps et un espace défamiliarisés. Le récit commence par la description du dispositif et par celle des visiteurs de l’exposition-installation, par exemple de cet homme qui « leva une main vers son visage, répétant, avec une extrême lenteur, le geste d’un personnage sur l’écran26. » Le corps du visiteur mime celui du personnage, les deux comme situés dans un seul espace. L’image est perçue, ressentie si profondément qu’elle modèle le corps, se trouve comme matérialisée dans le corps de celui qui regarde. Cette pénétration dans la profondeur de l’image et cette immersion dans une image qui devient un milieu enveloppant font glisser de la vision à la sensation corporelle aiguë :
Rester debout faisait partie de l’art, l’homme debout participe […] il revenait toujours au mur pour un contact physique, faute duquel il risquait de se retrouver à faire quoi, il ne savait pas trop, à transmigrer de ce corps qui était le sien à une image qui tremblait sur l’écran27 ? » Tout un champ lexical dit l’absence de distance du récepteur mis en situation de « penser, des heures durant, à l’intérieur du film, à l’intérieur de lui-même. Ou bien était-ce le film qui pensait à l’intérieur de lui, se répandant en lui comme une sorte de fuite de fluide cérébral28 ?
DeLillo parle d’« immersion totale 29», du visiteur qui
voulait que le film se déroule plus lentement encore, requérant une implication plus profonde de l’œil et du cerveau, toujours, que la chose contemplée s’enfouisse jusque dans le sang, dans l’intensité de la sensation, partageant avec lui l’acuité de la perception30.
On peut trouver ici un écho de la phénoménologie de Merleau-Ponty, de sa notion de l’entrelacs, d’une « vision [qui] est prise ou se fait du milieu des choses31 ».
Ce que la vidéo fait à l’écriture.
Il est impossible de voir toute la vidéo. Il faut accepter cette idée d’une vision limitée à un fragment et concentrée sur un seul aspect, non dispersée mais rassemblée dans l’infime. De la même façon, l’écriture de Don DeLillo recourt à cette esthétique du fragment brut qui est une réserve d’images, de mots et de fictions. Dans une autre œuvre de l’auteur, Cosmopolis, le trader insomniaque Eric Packer32, qui ne perd pas de temps en dormant et anticipe même le temps - celui du cours de devises - est féru de poésie pour une raison bien particulière, d’ordre « économique » :
Il lisait des choses scientifiques et de la poésie. Il aimait les poèmes dépouillés minutieusement situés dans un espace blanc, des rangées de traits alphabétiques gravés dans le papier. Les poèmes lui donnaient conscience de sa respiration. Un poème dénudait l’instant pour des choses qu’il n’était habituellement pas prêt à remarquer. Telle était la nuance de chaque poème, tout au moins pour lui, la nuit, ces longues semaines, un souffle après l’autre, dans la pièce en rotation au sommet du triplex33.
L’instant est suspendu pour être complètement investi, de façon infinitésimale. Dans sa fiction, Don DeLillo rend bien cette succession d’instants stratifiés, ouverts dans la profondeur. De ce fait, l’écriture rappelle la technique du kaléidoscope ou de la vision fractale qui ressemble au rideau de douche choisi par Gus Van Sant pour son remake en couleurs, rideau non lisse mais dont la surface semble constituée d’une multitude de petites alvéoles. Ces composantes bien distinctes déjà évoquées à propos des gestes de Norman Bates s’apparentent aux Haïkus, images brutes qui contiennent tout un univers spatio-temporel : « Le haïku ne signifie rien au-delà de ce qu’il est. Un étang en été, une feuille au vent. C’est de la perception humaine en milieu naturel. C’est la réponse à tout sous forme d’un nombre fixe de vers, d’un compte prescrit de syllabes34. » Les textes de Don De Lillo prennent leur rythme d’une oscillation entre récit très réaliste et classique, et d’un détournement de cette trame image-mouvement par les propos philosophiques, abstraits, les divagations et surtout l’énigmaticité poétique qui ouvre un monde. Le romancier donne un exemple concret, celui du stratège conseiller de guerre, retraité, protagoniste du récit qui tire un bilan de sa fonction au documentariste venu le filmer chez lui :
Je voulais une guerre haïku, dit-il. Une guerre en trois vers. Aucun rapport avec l’état des forces en présence ou avec la logistique. Ce que je voulais c’était un ensemble d’idées ayant à voir avec des objets éphémères. Telle est l’âme du haïku. Tout dénuder, tout rendre visible35. Voir ce qui est là. À la guerre les choses sont éphémères. Voir ce qui est là puis se tenir prêt à le voir disparaître36.
Ce propos n’est pas le plus énigmatique mais révèle bien le style poétique de Don DeLillo, appliqué à tous les domaines de la vie, y compris à la politique. Le romancier crée une prose plastique, forge les mots pour créer de la réalité, comme on donne une unité minimale lexicale, visuelle, pour qu’elle s’active, si on fait bouger tous les paramètres qu’elle contient potentiellement. Revenir à un énoncé - visuel ou verbal - brut, permet à celui-ci de déployer toutes les actualisations possibles :
Nous essayions de créer de nouvelles réalités en l’espace d’une nuit, de soigneux assemblages de mots qui sonnent comme des slogans publicitaires, mémorisables, répétables. C’étaient des mots qui finiraient par produire des images avant de devenir tridimensionnels37.
Don DeLillo semble écrire lui aussi en comptant sur l’activation de ces blocs d’énoncés susceptibles de devenir des fictions - ce sont alors des réserves d’histoires - et de devenir des images - ce sont alors des réserves de visions.
Ce que l’écriture fait au lecteur : une imagination se logeant entre les plans visibles et les mots écrits
Dans la vidéo, peu à peu l’attention se détourne du caractère informatif des images - répondant aux questions « qui ? » (le « Whodunit ? » du récit policier), « que ? », « quoi ? », « pourquoi ? », « comment ? » - pour se recentrer sur le potentiel sensible, plastique, poétique, qui dit aussi quelque chose, qui a du sens. Ainsi, le ralenti ancre une image dans la mémoire, image réutilisable ensuite, hors de toute considération plus pragmatique, de toute lecture plus informative. Si on prend l’exemple de la scène où Marion est dans la voiture sous la pluie, approchant du motel, on peut analyser la scène en termes informatifs et en lecture pragmatique : il pleut, elle est gênée, il faudrait qu’elle s’arrête, elle cherche à s’arrêter, elle va s’arrêter, que va-t-il se passer si elle s’arrête, ou alors elle va avoir un accident, et que se passera-t-il alors ? Si nous analysons à présent la même scène en termes plastiques - en nous situant du côté des signifiants -, un autre type de discours sera produit : il pleut, un écran s’installe - qui annonce le rideau de douche au spectateur averti -, un obstacle se dresse, elle sera bloquée derrière un écran qu’elle ne pourra plus franchir de nouveau vivante - le rideau de douche, l’eau de la douche -, elle est éblouie par une lumière agressive - les phares -, elle sera agressée par l’éclat d’une lame et elle se heurtera aux carreaux brillants du sol de la salle de bain - dont on sait d’après les évocations de la réalisation du film qu’ils étaient trop brillants et gênaient le tournage. Des paramètres qui ne sont plus informatifs et narratifs apparaissent, paramètres techniques - formes et lumières -, paramètres poétiques et plastiques. Ce qui fait sens est un élément - matière ou objet - doué de plasticité, c’est-à-dire susceptible de changer de fonction dans le film. De fait, les éléments de la diégèse se trouvent décontextualisés dans la vidéo, c’est-à-dire sortis d’une fonction qui sert l’image-mouvement. En revanche, à la suite encore des analyses que Deleuze mena, on peut parler d’une exacerbation de l’image-temps, cette image qui a une valeur « optique-sonore pure38 » – ce qui confirme le « film pur », le « temps pur » évoqués supra39. Ici, chaque élément a sa force de présence, matérielle et plastique et entre dans de nouvelles combinaisons, comme encore le pommeau de la douche, le trou d’évacuation de la baignoire et l’œil de Marion Crane, celui de Norman Bates le voyeur devant le trou du mur. Autant de motifs entre lesquels il n’est plus fait de différence, les uns et les autres ayant perdu leur place dans une trame qui serait événementielle et dont la cohérence viendrait de la fonction et de l’utilité de chaque élément par rapport aux autres - comme dans l’image-mouvement définie par Deleuze. Par le ralenti, chaque élément est renvoyé à sa pure matérialité, les uns et les autres se faisant écho pour construire un sens visuel et plastique différent mais aussi fort que le sens de l’action racontable, une signification qui passe au premier plan. Le sens plastique l’emporte sur le sens créé par les actions.
À la suite de la vidéo, le style poétique souvent énigmatique et philosophique de Don DeLillo crée une réserve d’images dans l’image et de fictions dans la fiction. Point omega contient deux histoires. La première est celle du stratège qui a visité l’exposition avec un documentariste qui prévoit de tourner avec lui un entretien, dans le désert où habite le stratège rejoint par sa fille. Celle-ci arrivée à la résidence de son père disparaît soudain après avoir reçu des appels téléphoniques, que personne ne pourra expliquer. Cette première histoire oriente le roman vers le fait divers - enlèvement voire meurtre à élucider. La seconde histoire donne lieu au récit de l’expérience d’un visiteur de l’exposition, qui un jour parle à une fille qui lui laisse son numéro de téléphone. On peut imaginer que les deux trames convergent, la visiteuse ayant rencontré le visiteur de nouveau, et ayant disparu à cause de lui. Mais rien n’est sûr, et toutes les fictions sont possibles - ainsi, une enquête ne sera pas résolue, contrairement à ce qui se produit dans le film d’Hitchcock. Par conséquent, Don DeLillo en reste à des ébauches de fictions, que le lecteur pourrait compléter, formuler jusqu’à un accomplissement qui éviterait au roman de prendre la forme déceptive du début de Fin de partie cité au début de cet article40. La forme élaborée par Don DeLillo est suspendue : l’intérêt réside en toutes ces histoires possibles, qui actualisent des bribes brutes de récits mais dont aucune n’est achevée. Au lecteur de s’immiscer dans les interstices et de modeler la fiction selon les indices qu’il a saisis et selon ses capacités à fictionner, selon aussi sa fantaisie.
La thématique temporelle, donc on voit qu’elle privilégie le motif de l’instant et malmène la linéarité et la continuité, s’articule à une vision souvent négative de notre rapport au temps. De fait, Don DeLillo est préoccupé par la condition tragique de l’homme mélancolique auquel le temps échappe alors qu’il veut habiter le temps. Le temps désormais, comme le décrit ce roman de l’argent dématérialisé qu’est Cosmopolis, se compte de façon infinitésimale, grâce aux avancées de la technologie, comme en atteste ce dialogue entre le trader de Cosmopolis et la responsable de son service Recherche et Analyse conceptuelle qui lui demande « -- Quelle est la mesure qu’on appelle nanoseconde ?41 » et à qui il répond : « -- Dix à la puissance moins neuf / -- C’est quoi. / -- Un milliardième de seconde, dit-il42. » Le trader poursuit son exploration poétique de la terminologie temporelle43, qui donne toute la vastitude des mesures infimes, comprenant les « zeptosecondes », ou « yoctosecondes » - représentant « un septilionième de seconde ». Il semble que pour Don DeLillo il soit regrettable que « [l]e futur devie[nne] insistant44 » et qu’il faille « corriger l’accélération du temps. Ramener la nature à la normale, plus ou moins45 ». On comprend alors que l’œuvre de Douglas Gordon coïncide avec les préoccupations du romancier et que le vidéaste y trouve une forme vitale d’investissement du présent. Le trader lui-même, pourtant contraint par l’anticipation et la nécessité de doubler le cours du temps, de devancer le futur, exprime cette perte mélancolique :
La course infernale des chiffres et des symboles, les fractions, les décimales, le signe du dollar stylisé, le flux continu des mots, des informations multinationales, tout cela trop fugace pour être absorbé. [ …] Peu importe la vitesse qui rend difficile la lecture de ce qui se passe devant les yeux. C’est la vitesse qui compte. Peu importe le renouvellement sans fin, la façon dont les informations se dissolvent à un bout de la série pendant qu’elles se forment à l’autre. C’est ce qui compte, l’élan, le futur. Nous n’assistons pas tant au flux de l’information qu’à un pur spectacle, l’information sacralisée, rituellement illisible. Les petits écrans du bureau, de la maison et de la voiture deviennent ici une sorte d’idolâtrie, ici les foules pourraient se rassembler dans la stupéfaction46.
Alors, l’évolution de l’humanité fait rêver à un retour à plus de matière et la littérature de l’extinction se comprend par l’idée de fin déjà à l’horizon, de mort en cours. Le philosophe Teilhard de Chardin crée le concept de point oméga, de point final et le romancier fait une analyse justifiant le titre de son roman, par le biais du personnage : « Il disait que la pensée humaine est vivante, qu’elle circule. Et que la sphère de la pensée humaine collective approche de son terme, de l’explosion finale47. » Cette extinction paraît certes inévitable, interminable mais pleinement assumée, habitée :
Nous sommes une foule, une masse. Nous pensons en groupes, nous voyageons en armées. Les armées portent le gène de l’autodestruction. Une seule bombe ne suffit jamais. Le brouillard de la technologie, c’est là que les oracles complotent leurs guerres. Parce que l’heure est désormais à l’introversion. Le père Teilhard connaissait une chose, le point oméga. Un bond hors de notre biologie. Posez-vous cette question. Devons-nous rester éternellement humains ? La conscience est à bout de forces. À partir de maintenant, retour à la matière inorganique. C’est ça que nous voulons. Être des pierres dans un champ48.
Le propos philosophique volontiers visionnaire de Don DeLillo s’articule avec cette fin de monde qui oblige à penser une nouvelle voie d’accès au réel, dépassant la technologie et la biologie. Dans cette pensée aporétique, comment la représentation nous donne-t-elle cette occasion de redevenir inorganique, une pierre ? Sans doute le fait-elle par assimilation à des images lestées de gravité et matérielles, plastiques, sans doute par un texte dont le discours est opacifié, nous obligeant à repenser les choses depuis leur état premier, brut, choses hors catégorie vues par un regard qui ne les réduit pas à une fonction, qui n’est pas animé par le pragmatisme, la détermination, la volition mais par une sensibilité et un imaginaire très matériels. Là encore, Don DeLillo rejoint la phénoménologie de Merleau-Ponty lorsque celui-ci rend hommage au peintre Cézanne :
Nous vivons dans un milieu d’objets construits par les hommes, entre des ustensiles, dans des maisons, des rues, des villes et la plupart du temps nous ne les voyons qu’à travers les actions humaines dont ils peuvent être les points d’application. Nous nous habituons à penser que tout cela existe nécessairement et est inébranlable. La peinture de Cézanne met en suspens ces habitudes et révèle le fond de nature inhumaine sur lequel l’homme s’installe. C’est pourquoi ses personnages sont étranges et comme vus par un être d’une autre espèce. La nature elle-même est dépouillée des attributs qui la préparent pour des communions animistes : le paysage est sans vent, l’eau du lac d’Annecy sans mouvement, les objets gelés hésitants comme à l’origine de la terre. C’est un monde sans familiarité, où l’on n’est pas bien, qui interdit toute effusion humaine. Si l’on va voir d’autres peintres en quittant les tableaux de Cézanne, une détente se produit, comme après un deuil les conversations renouées masquent cette nouveauté absolue et rendent leur solidité aux vivants. Mais seul un homme justement est capable de cette vision qui va jusqu’aux racines, en deçà de l’humanité constituée. Tout montre que les animaux ne savent pas regarder, sans rien attendre que la vérité. En disant que le peintre des réalités est un singe, Emile Bernard dit donc exactement le contraire de ce qui est vrai, et l’on comprend comment Cézanne pouvait reprendre la définition classique de l’art : l’homme ajouté à la nature49.
Le spectateur de la vidéo reconnaît à celle-ci ce pouvoir de l’inorganique sur notre corps réceptif :
Tout donnait l’impression d’être réel, le rythme était réel, paradoxalement, des corps qui se mouvaient musicalement, des corps qui bougeaient à peine, une dodécaphonie, des choses qui se passaient à peine, cause et effet si radicalement séparés que tout lui paraissait réel, à la façon dont sont dites réelles toutes les choses du monde physique que nous ne comprenons pas50.
Introduire un peu d’incompréhensible laisse une chance au lecteur de réadapter son langage, de formuler à neuf, c’est-à-dire de ne pas seulement penser le texte dans le contexte qu’il détermine mais le déplacer, le transposer selon d’autres paramètres. Le narrateur critique cette façon qu’ont les visiteurs de recevoir de façon normative les images de la vidéo, ce qui leur fait manquer le sens plastique de l’œuvre :
Ils avaient besoin de penser en mots. C’était leur problème. L’action se déroulait trop lentement pour s’accompagner de leur vocabulaire filmique. Il ne savait pas si cela avait le moindre sens. Ils ne pouvaient pas percevoir la pulsation des images projetées à cette vitesse. Leur vocabulaire filmique, songea-t-il, ne pouvait pas s’adapter à des tringles à rideaux, à des anneaux de rideaux et à des œillets51.
Conclusion
En conclusion on peut suggérer que Don Delillo pense un certain engagement humain - via cette expérience esthétique de contemplation d’une œuvre douée de plasticité. Cet engagement consiste sans doute à se déshabituer à voir, à essayer de modifier en permanence le point de vue, à « engager l’individu à une profondeur bien au-delà des suppositions habituelles, des choses qu’il présume et considère comme acquises52. » Tel est en somme le fond des choix esthétiques de Don DeLillo et le sens même de l’œuvre de Douglas Gordon. Le spectateur n’est plus manipulé par le film ou par un récit. Il peut même aller derrière l’écran et alors l’image se renverse : comme le fait remarquer le visiteur, pour ouvrir la portière, Norman Bates utilise sa main droite d’un côté de l’écran, gauche de l’autre. La confrontation d’un film avec la vidéo qui le régénère en le métamorphosant – littéralement, en jouant sur sa forme – et avec le roman qui transpose à la fois le film et son traitement vidéographique, permet de définir l’ensemble film-vidéo-texte comme un cas d’intermédialité extrêmement riche du point de vue du renouvellement des formes plastiques - visuelles et verbales - et comme vecteur d’une pensée politique sensible, contre toute fabrique et imposition venue de l’extérieur : « Nous avons besoin de nous emparer à nouveau de l’avenir. La force de volonté, la pure nécessité viscérale. Nous ne pouvons pas laisser forger notre monde, nos cerveaux, par d’autres53. »