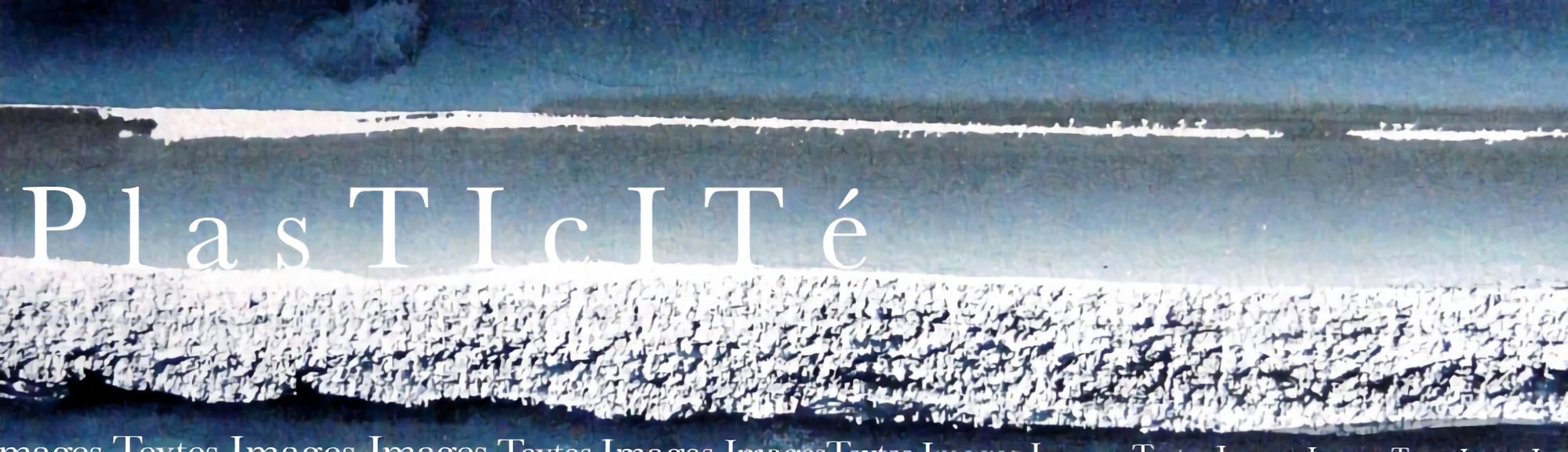Hantise
Ma vie rouge Kubrick, premier livre de Simon Roy paru en 2014, est un récit hybride — entre essai et récit de soi — qui met en regard le film The Shining, de Stanley Kubrick1 et ce que le narrateur appelle sa « généalogie macabre2 ». Nous avons affaire à une écriture fragmentaire bien cadrée (Ma vie rouge Kubrick compte 52 fragments numérotés et titrés qui constituent autant d’unités autonomes) brouillant la frontière entre la critique cinématographique et l’écriture de soi. Entre le spectateur fasciné depuis l’enfance et son modèle se noue une relation au moins triple croisant le commentaire réflexif, la (re)narration et l’imitation créatrice.
Jouant d’un savoir disparate, déhiérarchisé, autant biographique que critique, Simon Roy met en scène sa fascination pour The Shining, qui réfléchit exemplairement quelque chose de sa vie : le modèle permet de donner forme et sens à une tragédie familiale dont le récit serait la catharsis. La succession des morts violentes dans la branche maternelle de la famille3 trouve un écho dans la folie meurtrière de Jack Torrance, dans le film, mais aussi dans les massacres scolaires aux Etats unis.
Dans le fragment 23 intitulé « I am Charlie Decker», Simon Roy interroge le pouvoir qu’a pu avoir Rage, une fiction meurtrière de Stephen King publiée sous pseudonyme en 1977 puis « retirée de la circulation commerciale4 ». Dans ce roman « [u]n élève du secondaire, Charlie Decker, […] prend sa classe en otage après avoir abattu sa professeure de math » (p. 78). Plusieurs adolescents qui, en 1988, 1989, 1996, 1997, ont ouvert le feu dans des écoles secondaires américaines, se seraient identifiés à Charlie Decker. En 1999, après la fusillade de Colombine, « Stephen King a fait cesser la publication de son roman » (p. 79). Ces considérations engagent le lecteur de Roy à adhérer à l’idée reçue suivant lequel la fiction n’est pas coupée de la vie : elle contamine et influence les esprits fragiles d’une façon inquiétante. Dans cette mesure, l’analogie qui s’instaure entre la vie du narrateur et le film de Kubrick joue de la répétition du massacre tout en en transformant la dynamique : loin d’être un moteur passif, le film de Kubrick agit à titre de filtre5 autant esthétique qu’existentiel. Ainsi, Ma vie Rouge Kubrick réfracte et diffracte la relation trouble, complexe, entre le modèle cinématographique et le récit de vie, l’un et l’autre se répondant en miroir et en décalage. Entre Ma vie et Kubrick, c’est le rouge, le rouge sang des massacres collectifs et des tragédies familiales, qui fait lien. L’analyse du modèle cinématographique se combine dès lors avec la remise en jeu littéraire de soi, jusqu’à déployer le potentiel créateur de la relation au modèle comme hantise.
Dédoublement initial : soi-même en écho
Le titre du premier fragment — « Tu aimes les glaces, canard ? » — est une citation tirée de The Shining. L’enfant lumière. Après avoir défini le sens du mot shining, forme fulgurante de télépathie orientée vers le futur ou le passé6, Roy raconte sa première rencontre avec le film. Soirée d’été, sa mère en visite dans le bungalow d’en face ; le garçon de 10 ou 11 ans passe le temps devant la télévision. Il tombe, par hasard, sur une scène du film de Kubrick, en elle-même peu terrifiante, mais qui trouble le jeune spectateur. La scène se passe à l’hôtel Overlook, où la famille Torrance s’installe avant la fermeture pour l’hiver : « Pendant qu’il fait visiter le garde-manger à Mme Torrance accompagnée du garçon [Danny], le chef cuisinier, Dick Hallorann, se retourne vers l’enfant et lui dit d’une voix distordue, comme au ralenti : “Tu aimes les glaces, canard ?” tout en continuant d’énumérer pour le bénéfice de Wendy Torrance la liste des aliments qu’on y stocke » (p. 12). Le jeune spectateur n’en verra pas plus tant ce passage l’impressionne et constitue, pour lui, un choc initial, c’est-à-dire un événement : « Ce qui fait événement […] n’est pas sa nouveauté comparée à d’autres “événements”. C’est qu’il a valeur d’initiation en lui-même. On ne le sait que plus tard. Il a ouvert une plaie dans la sensibilité. On le sait parce qu’elle s’est ouverte depuis et se rouvrira, scandant une temporalité secrète, peut-être inaperçue », écrit Jean-François Lyotard7. En ouvrant Ma vie rouge Kubrick par cette scène augurale, Simon Roy remet en jeu la force d’ébranlement que, jeune spectateur, il a ressentie : « Une brèche venait d’être ouverte dans le ciment de mon confort tranquille d’enfant » (p. 13) écrit-il, pour ajouter aussitôt — traduisant un autre extrait du film : « À jamais. À jamais. À jamais » (p. 13). La fascination pour The Shining découle d’un premier choc inexplicable, mais repris en écho, à l’instar des mots À jamais trois fois répétés, dans le film, par les jumelles Grady puis par Jack Torrance, le père de Danny8. En racontant cette scène dans le premier fragment d’une série de 52, Simon Roy répercute le choc initial de l’expérience du dédoublement.
Les citations, que signalent les italiques, sont caractéristiques d’une composition en miroir manifeste. La mise en récit de la vie et du film se répondent en écho et dans un écart, dans une traduction constante des images en écriture et de l’anglais au français. On saisit mieux, dès lors, en quoi le double n’est pas seulement un thème terrifiant mais aussi une composition fragmentaire structurante engagée dès le premier fragment. Roy reprend au modèle de Kubrick les jeux de miroirs, mais, contrairement au modèle cinématographique, il sort de l’univers clos de la fiction et multiplie les familles — à la famille « Kubrick » correspondent la famille « ma vie » et, à un moindre niveau, celle des « massacres collectifs » — dont il mélange soigneusement les cartes tout en ménageant, d’une famille à l’autre, des liens. La symétrie patente entre le film et la vie contribue ainsi à problématiser la part autobiographique du récit de soi : la filiation cinématographique contamine, double et, manifestement, re-génère l’histoire des antécédents familiaux, faisant du film un filtre d’élection auquel la « généalogie macabre » en partie se rapporte.
Redoublements critiques
La relation fascinée du spectateur avec son modèle trouve, dans les modalités de l’essai critique, une manière assumée de mettre en œuvre une secondarité créatrice : c’est par le biais d’échantillonnages, d’ekphrasis, de gloses, de traductions, de citations et de résumés, que Roy s’approprie le film de Kubrick et le fait, littéralement, sien. Le savoir qu’il a accumulé au fil des années n’est pas dissocié d’un intérêt subjectif. Bien au contraire, le commentaire relève d’une obsession intime chargée d’affects, explicitement réfléchie et revendiquée comme telle : « Forcément, il doit y avoir quelque chose d’incarné, d’intimement ressenti, un lien passionné, voire passionnel, entre l’enseignant et la production artistique étudiée. Sinon, à quoi bon ? » (p. 26). Mais la passion critique et intime que le livre redéploie sur un mode maîtrisé part du choc initial subi par le spectateur enfant.
Simon Roy souligne, à cet égard, qu’on « ne choisit pas ses souvenirs » (p. 13). Le jeune spectateur désœuvré s’est trouvé happé par une scène de dédoublement, il est atteint malgré lui par ce qui n’était « que des images diffusées à la télévision » (p. 13), « comme si l’homme noir […] me regardait, moi précisément, plutôt que le petit garçon nommé Danny, d’ailleurs resté quelque peu à l’écart, dans le cadre de la porte de la pièce réfrigérée » (p. 13). L’expérience première est celle du décalage de l’image et de la voix, susceptibles l’une et l’autre de « crever » l’écran, de traverser la frontière de la fiction pour projeter un malaise et semer l’inquiétude dans la vie. En relatant d’emblée cette expérience première, en la réfléchissant, le narrateur répercute, activement cette fois, la fulgurance que l’enfant a ressentie9. La passivité devient passion esthétique – double créateur d’un trouble initial jamais écarté.
Le premier fragment du récit va cependant au-delà d’une réappropriation créatrice du choc. La confusion d’ordre hallucinatoire éprouvée par le jeune spectateur fait indirectement écho à une autre scène du film dans laquelle Danny, sur son tricycle, voit les jumelles Grady dans un couloir de l’hôtel Overlook. Danny s’arrête net de pédaler. Les jumelles l’invitent alors, par deux fois, à jouer avec elles : « Hullo Danny/Come and play with us/Come and play with us, Danny ». À l’invitation double, en miroir, des jumelles se tenant par la main succède, par montage « sec » produisant un effet de choc, l’image du corps des jumelles baignant dans leur sang dans le même couloir étroit. L’image des corps massacrés alterne à trois reprises avec celle des petites filles se tenant par la main tandis que leurs voix poursuivent, de conserve : « For ever…and ever…and ever.» En insérant, dans son premier fragment, la traduction de la ritournelle des sœurs Grady, Roy produit, par les moyens de l’écriture, un effet de surimpression, jouant du double de façon créatrice pour démultiplier les niveaux de sens. Plus encore, c’est, dans The Shining, à la suite de la vision du corps massacré des sœurs Grady, que Danny, les mains sur le visage, avoue à Tony, son ami imaginaire, qu’il a peur. Tony, alors, le raisonne : « Remember what Mr. Halloran said. It's just like pictures in a book, Danny. It isn't real. » De la même manière que Danny tente de désamorcer la puissance des images en les rapportant à un médium – ici le livre —, le spectateur enfant de Ma vie rouge Kubrick tente de contenir son malaise en renvoyant sa scène initiale du Shining à un mode de diffusion télévisuelle. Les deux raisonnements se répondent en écho, comme si la seule manière d’échapper au choc redoublait une scène du film tout en réflechissant à la porosité des images, redoublement abyssal ouvrant une brèche dans le monde clos de The Shining et générant, entre le spectateur et son modèle, une filiation esthétique aux ramifications potentiellement infinies.
Le narrateur de Ma vie rouge Kubrick se pose ainsi comme le traducteur, l’interprète, le passeur du film. Le jeune spectateur médusé est devenu un re-spectateur averti doublé d’un professeur cherchant à ressaisir le fil de sa généalogie à partir de ce qu’il désigne comme un film filtre (p. 26). Les procédés de re-narration, de traduction et de commentaires déploient une réflexion explicite sur le redoublement et l’impression de déjà-vu10. Mais tout en réfléchissant au double, l’écriture s’écarte de la glose savante pour rejaillir comme une force troublée, troublante, de dédoublement : les considérations rétrospectives sur le malaise de l’enfant Roy confronté pour la première fois au film de Kubrick sont, on l’a vu, chargées d’échos et de citations renvoyant au modèle, comme dans un tourniquet infernal. En chevillant les savoirs encyclopédiques et la perspective critique à une expérience esthétique et existentielle de longue portée, Roy fait du commentaire une forme d’invention remettant en jeu, à un autre niveau, le double. À la manière du petit Poucet de la fable dont Danny, sur son tricycle, serait le frère jumeau, il se fraie un chemin dans le labyrinthe du film. Ainsi retrouve-t-on dans le fragment 32, au milieu d’un commentaire, la ritournelle des sœurs Grady, ritournelle qui revient deux fois, dans deux langues, et dont le sens ne cesse de se ramifier, comme si le jeu d’écho absorbait, d’un même geste, la démultiplication labyrinthique du même et la possibilité d’une altération libératrice :
Pour avoir vu The Shining un nombre incalculable de fois, je peux affirmer que le temps n’a pas de prise sur ce film. Forever, and ever, and ever. Pas plus qu’il n’en a sur les pensionnaires éternels de l’hôtel Overlook, à tout prendre. Il reste qu’une part d’inconscient a forcément dû jouer pour imposer The Shining comme une œuvre phare qui guide mes pas dans le labyrinthe ténébreux de ma généalogie macabre. […] The Shining pourrait n’être rien d’autre que mon Overlook à moi, où je serais condamné à me perdre à jamais, à jamais, à jamais ? (p. 108)
L’inquiétude de la répétition infernale sur laquelle repose le film (Jack Torrance se trouvant voué à répéter l’homicide de l’ancien gardien de l’hôtel Overlook) se voit ici réactivée. Si la passion critique du narrateur pour The Shining se projette comme un « fil d’Ariane » (p. 28) pour sortir du piège, il n’en demeure pas moins que l’œuvre-guide risque toujours de se renverser en œuvre-labyrinthe précipitant le narrateur à sa perte. L’aventure reste potentiellement dangereuse : les variations constantes et les multiples traductions des mêmes termes déplacent le sens de façon dynamique, échappant ainsi à la répétition mortifère qui, malgré tout, la hante. La réflexion, chez Roy, passe par l’expansion, la modulation et le déplacement de quelques thèmes (ou termes) ; elle attire notre attention sur des détails du film devenus, chemin faisant, porteurs de sens et de tension.
Détails et intermédialité
Dans le jeu des commentaires, Roy ne cache pas sa passion élective pour le détail décentré. On pense ici à l’opposition barthésienne entre le punctum et le studium. Barthes charge les détails d’affects et d’une sorte de force autonome, faisant du punctum affaire de regard touché d’une manière inexplicable. Le punctum est rencontre, événement au sens où Lyotard l’entend, bouleversement imprévu et, pourtant, recherché. On ne choisit pas plus le punctum photographique qu’on ne choisit ses souvenirs cinématographiques : « […] ce n’est pas moi, écrit Barthes à propos du punctum, qui vais le chercher […] c’est lui qui part de la scène, comme une flèche, et vient me percer11. » De la même manière, quelque chose, dans la scène initiale de The Shining, se détache du monde de la fiction pour venir toucher le petit garçon : « Était-ce [se demande rétrospectivement le narrateur] ce que l’on appelle, dans le film The Shining, la fulgurance ? » (p. 13) La fulguration inexplicable du détail atteint un point aveugle du sujet spectateur, agite une sensibilité secrète sur laquelle Roy, dans son essai-récit, tente de revenir dans une mise en abyme touchant à l’inconscient familial, folie meurtrière et déraison passionnelle se répondant en miroir12.
Dans un essai sur la cinéphilie, André Habib parle de la passion du détail dans l’image, revendiquant, pour le cinéma, ce que Barthes réserve à la photographie :
Ce qui reste d’un film et continue de nous revenir, en incarne le plaisir secret, le plus intime et qui est souvent compliqué à partager, est la plupart du temps de l’ordre de l’anecdote, du détail anodin, quelque chose qui échappe à la trame narrative […] mais qui nous touche, nous marque, nous retient à lui d’autant plus qu’il est déraisonnable. Barthes a merveilleusement nommé cette déraison le punctum : le punctum, c’est ce supplément que “j’ajoute à la photo et qui cependant y est déjà”. Si Barthes ne considérait pas le cinéma capable de générer un punctum (l’image défile trop vite, on ne peut rien lui ajouter, elle ne peut donner lieu à une saisie pensive), on est sûrement en droit de le contredire — l’expérience le démontre amplement — et de faire valoir l’existence de punctums […] cinématographiques. Certes, ils ne s’établissent pas dans le même temps, selon un même tempo, un même rapport à la liberté du regard, mais ils n’en sont pas moins prégnants et décisifs13.
Le tempo du punctum cinématographique serait celui de la mémoire habitée par autant de fulgurances arrachées à la trame narrative. Mais l’expérience tient aussi à un entraînement du regard qui, s’il ne sait pas d’avance ce qui viendra le toucher et raviver sa mémoire, sait que les détails poignants sont l’occasion à saisir dans l’image. À la pure contingence de ce qui fulgure correspondent alors les techniques et les pratiques prédisposant une forme d’attention élective et sélective. Le re-visionnement et l’arrêt sur image favorisent le décentrement du regard, ils rendent possible une critique pensive, buissonnière, que l’écriture seconde et prolonge. Le choc initial appelle, chez Roy, un désir d’analyse, de découpage, d’appropriation et de transmission. Il ausculte le choc tout en en réfractant l’effet d’un fragment à l’autre, entraînant les détails dans d’étonnantes ramifications. Ce faisant, Roy se détourne de l’insignifiance sur laquelle Barthes insiste tant : force de fulguration, le détail est aussi une « force d’expansion14 » devenue, en chemin, significative.
Deux exemples me permettront de montrer l’importance des détails et la façon dont Roy transpose, dans le texte, une dimension visuelle d’ordre cinématographique. Pour qualifier la robe bleu pâle des sœurs jumelles Grady, Roy reprend invariablement la formule « bleu azurin ». Dès le premier fragment, il décrit la vision d’horreur de Danny : « Il voit […] outre une cage d’ascenseur d’où se déversent des flots de sang, deux fillettes se tenant par la main, en apparence immobiles, en apparence des jumelles, vêtues de robes bleu azurin » (p. 16). Le contraste frappant entre le flot rouge et le bleu de la robe des jumelles passe, dans le texte, par la description des deux plans du film, mais aussi par un choix lexical : l’expression bleu azurin n’est pas commune et, par là, se démarque. Le transfert intermédial du film au livre ne tient donc pas uniquement à l’ekphrasis ; il traduit le contraste des couleurs dans un contraste verbal et fait ressortir un effet visuel à partir d’une expression rare qui tranche par rapport au style relativement neutre du livre. Le bleu azurin passe alors de la famille Kubrick à la famille des antécédents ; on le retrouve dans le récit du meurtre commis par le grand-père du narrateur sous les yeux de ses filles jumelles :
Au moment où elles s’apprêtent à ouvrir la porte-moustiquaire, les fillettes se figent sur place. La scène d’horreur à laquelle elles assistent les traumatisera à jamais : leur père, ensanglanté, est en train d’asséner un coup, puis un autre, sur la tête de leur mère. Il la frappe avec un marteau. […] La chemise bleu azurin de Jacques Forest est toute maculée du sang de sa femme, dont la tête repose sur la table de cuisine. […] De l’autre côté de la porte-moustiquaire […], les gamines, sous le choc, se tiennent immobiles, main dans la main. Pas un son, sinon celui de la respiration haletante de Jacques Forest. Et tout ce liquide rouge foncé qui coule de la table jusque sur le plancher de la cuisine. La flaque de sang s’étend de seconde en seconde. (p. 101)
Dans cette scène du fragment 30, le bleu azurin de la chemise du grand-père contraste avec le sang qui la macule et s’écoule, attirant notre attention sur les parallèles entre ce meurtre familial et le massacre des sœurs Grady à coups de hache : la flaque de sang sous la table fait écho au flot de sang s’écoulant de la porte d’ascenseur de l’hôtel Overlook ; le marteau du livre transpose la hache du film ; le prénom de la mère (Danielle) renvoie à celui de Danny et le prénom de Jacques à celui de Jack ; les fillettes immobiles, main dans la main, sont un décalque de la scène du film… Le cumul des analogies rend manifeste la composition en miroir de cette scène traumatique, de sorte que la filiation esthétique redouble – et problématise (du point de vue de la vérité autobiographique) — la filiation maternelle. La répétition telle quelle du bleu azurin a dès lors pour fonction de signaler au lecteur naïf cette double filiation, dont elle est partie prenante. À l’instar d’une formule magique, la reprise rituelle du bleu azurin en fait une force qui performe et réfléchit le double par les moyens de l’écriture.
Un deuxième exemple me permettra de suivre, en détail bien sûr, le transfert intermédial du film au livre. Le fragment 10 de Ma vie rouge Kubrick s’ouvre sur une notice biographique de Heinrich Ludwig Kleyer, fondateur de la firme Adler. Adler, qui signifie aigle, renvoie au blason de l’Allemagne mais aussi au magazine Nazi, Adler, publié pendant la seconde guerre mondiale. Cette dérive autour du nom d’Adler n’a, a priori, aucun rapport avec le film de Kubrick ni avec la vie de Roy : la première partie du fragment est ouvertement décentrée par rapport au sujet principal, de manière à produire, à la lecture, un effet de rupture et de discontinuité. L’écrivain reprend ainsi, en l’adaptant, le montage «à sec» pratiqué dans le film. Il répercute le décentrement du regard du cinéphile au niveau du thème, que le lecteur, dérouté, perd momentanément de vue. Dans la deuxième section du fragment, séparé du premier par trois étoiles, on trouve une ekphrasis filmique dans laquelle les commentaires sur la réaction du spectateur se mêlent à la description de la scène étoffée de précisions encyclopédiques d’ordre anecdotique :
Des bruits de bombardements15 dans un décor d’intérieur d’hôtel. Leur régularité intrigue. Douze coups retentissants se font entendre hors champ pendant que s’offre au spectateur l’image en gros plan d’une ancienne machine à écrire, pratiquement hors commerce au moment du tournage du Shining, à la fin des années 70. Sans doute le cinéaste avait-il des raisons bien précises de cadrer en plein centre de ce plan sans texte une machine à écrire de fabrication allemande, la terrifiante Adler. (p. 42)
Alors que la description du gros plan semble dénuée de rapport avec Adler — la déroute du lecteur de Roy redoublant celle du spectateur de Kubrick intrigué par des bruits hors champ —, les deux premiers segments du fragment 10 se relient par le détour (ou, plutôt, le retour) de la marque Adler, lisible, explique Roy, sur la machine à écrire de Jack Torrance. Pourtant si, dans le film, l’inscription de la marque Adler occupe bien le centre de l’image, elle n’en est pas moins, à première vue, invisible. Pourquoi ? Parce qu’elle n’a aucune fonction narrative. Les cinq lettres de Adler se fondent dans le décor de par leur insignifiance narrative. Ce sont ces lettres que Roy, en scrutateur averti, «ajoute» à l’image et qui cependant y sont déjà, invisibles mais exposées (comme la lettre volée d’Edgar Allan Poe). Qui plus est, Roy retarde, dans le fragment 10, le moment où le sens se noue : le mot Adler, placé à la toute fin paragraphe, crée un écho in extremis qui tombe à pic et, en bout de ligne, place ce qui semblait anecdotique en plein centre de son intrigue.
Dans le troisième et dernier segment, l’Adler, associée aux Nazis, n’est plus un détail énigmatique mais le symbole du « clavier de la mort » (p. 43) dont le « claquement incessant» relie la pulsion meurtrière des pères et le génocide des Juifs. Entre effet de choc, effet retard et interprétation associative, la marque Adler symbolise un massacre à grande échelle où la grande Histoire (le génocide des Juifs et des Amérindiens), l’histoire du film et l’histoire familiale correspondent. On voit dès lors en quoi la reprise de détails d’un segment à l’autre crée des recoupements entre les familles et engendre des ramifications imprévues qui mettent en tension, au fil de la lecture, la fulgurance du choc et le cheminement sinueux, partiel, du sens.
Sortir du labyrinthe
Du film au livre, la répétition créatrice d’une histoire de répétition mortifère est en jeu. Chez Kubrick, le double est une force trouble qui redouble celle de l’image cinématographique comme miroir. Dans Ma vie rouge Kubrick, le spectateur s’inquiète de voir cette force sortir de ses gonds pour l’envahir, à l’instar des visions d’horreur dont Danny n’arrive pas à se détacher. Pour Roy, le film révèle et traduit une hantise familiale inquiétante. Or, si le modèle du film offre au spectateur un cadre de compréhension et de projection intime, il ouvre aussi une brèche sensible et réveille le spectre de la répétition meurtrière dont il s’agit, précisément, de se délivrer. Le livre a une visée performative : en revenant sur le film qui le touche et le hante, le narrateur entend rompre le cercle infernal du retour du même. Certes, Roy suit, ce faisant, le modèle de Danny qui, dans le film, échappe à la hache de son père et sort vivant du labyrinthe. Roy s’identifie à Danny pour mettre fin à sa « généalogie macabre ». Son récit, toutefois, démultiplie les jeux de miroir : il réfracte et diffracte son expérience de spectateur fasciné/averti pour faire de la répétition un double déplacé, une traduction intermédiale libératrice.
Dans la mouvance de l’expansion du biographique caractéristique, selon Dominique Viart, du « retour au sujet» contemporain, le récit de Simon Roy engage une porosité générique entre « l’essai et la fiction16 » qui trouve, du film au livre, une inflexion intermédiale. La composition des fragments fait en sorte que le récit de soi et la réappropriation critique de The Shining se répondent en écho, troublant, du même coup, la frontière entre généalogie familiale et généalogie esthétique. La manière dont Roy apparie sa fascination pour le film de Kubrick au récit de sa vie transforme la répétition inquiétante en force structurante d’expansion, arrimant la (re)narration et la glose à une poétique de la reprise. Sa « critique fiction17 » envisage ainsi le modèle cinématographique qui le hante comme un monde possible à explorer, faisant de l’écriture seconde un mode intrinsèquement créateur.