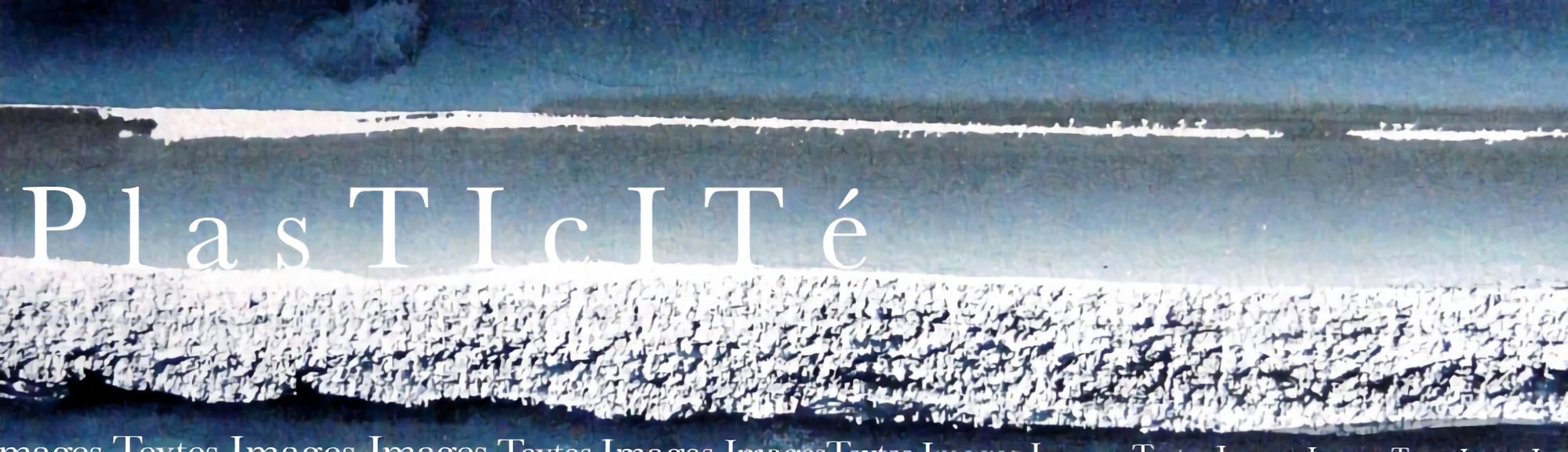Le roman de Jacqueline Harpman, Orlanda, s’annonce comme le récit fantaisiste des effets spectaculaires provoqués sur une lectrice, Aline Berger, par la lecture d’un roman de Virginia Woolf, Orlando : a biography. Dans ce roman, l’existence trans-séculaire du personnage principal, Orlando, est marquée par l’événement d’un changement spontané de sexe : d’abord homme, Orlando, un matin, se réveille femme. Or, dans Orlanda, Aline Berger voit sa vie bouleversée par la découverte de cette métamorphose. Lisant et relisant le passage où la métamorphose d’Orlando advient, elle subit une schize : une partie de sa psyché se détache, pour s’incarner dans le corps d’un jeune homme, Lucien. Bref, Aline se dédouble. Le roman de Jacqueline Harpman se présente ainsi, dès l’abord, comme un immense jeu avec la littérature, dans lequel il s’agit d’envisager les effets les plus radicaux de la lecture et le jeu que la littérature peut installer dans une subjectivité. Entre Orlando et Orlanda se joue une contamination du trouble identitaire, l’altération éprouvée par un personnage littéraire, Orlando, contaminant une lectrice elle-même fictive.
Parce que le roman de Virginia Woolf trame une vie qui se moque du genre de celui ou celle qui la vit, il s’amuse aussi avec les codes du genre littéraire qu’est la biographie. Orlando est en même temps une fantaisie, une biographie fictive, une biographie à peine masquée de Vita Sackville-West, un récit de consolation qui donne à cette dernière sa vie rêvée, voire une autobiographie ludique de Virginia elle-même. Mettant en scène un personnage qui, à dire le moins, se déforme, il est aussi une parodie du roman de formation. Jacqueline Harpman, de son côté, propose dans Orlanda une variation ludique sur Orlando, qui implique que l’auteure, Jacqueline, se laisse contaminer par Virginia, de même que son personnage, Aline, se laisse contaminer par Orlando : biographie de l’un qui devient autre, Orlando devient, dans sa réécriture, une biographie fictive dédoublée, celle d’Aline et de Lucien. Dans ce cadre, l’exploration de l’intériorité ne pourra avoir lieu qu’en interrogeant les relations de l’un et de l’autre, du personnage féminin et de son double masculin. Le thème, ainsi, se déplace. Jacqueline Harpman, en installant au seuil de son intrigue un dédoublement psychique, joue bien plus avec le genre roman psychologique qu’avec celui de la biographie pour interroger une subjectivité qui a apparemment perdu son unité.
D’Orlando à Orlanda, le jeu littéraire de reprise n’opère pas sans glissements : la modification du dispositif est immédiatement celle des questions qu’il permet de poser. Jacqueline Harpman, d’ailleurs, n’hésite pas à se mettre en scène comme narratrice pour montrer à son lecteur le plaisir qu’elle a à jouer avec le texte qu’elle écrit, à se laisser embarquer par ce que l’expérience-limite qu’elle prend pour thème l’invite à penser. Si elle se peint parfois en maîtresse du jeu, elle intervient aussi pour se dire débordée par ses personnages, par les implications de l’expérience qu’elle s’est donnée au départ. Il s’agit bien, ce faisant, de rejouer le plaisir que prend Virginia Woolf à exhiber un narrateur débordé par son sujet, forcé de suivre les aventures d’un personnage qui, immortel et non assigné définitivement à un sexe, ne contient pas dans les formes apparemment naturelles d’une vie humaine et ne rentre pas dans les cases du genre. Mais il est tout autant possible que la narratrice débordée qu’est Jacqueline Harpman manifeste la difficulté qu’il y a à se laisser embarquer dans une expérience de pensée qui, effectivement, devrait défaire les cadres de l’identité. Et cela d’autant plus que la tournure psychologique prise par Orlanda opère un glissement qui n’est peut-être rien d’autre qu’un pas en arrière, dans la mesure où Virginia Woolf raille ouvertement dans son roman la tentative de percer l’énigme d’une personnalité à partir de l’examen des faits qui se succèdent dans une vie, mais récuse, surtout, toute pertinence à une explication de l’autre.
Bien des gens, tenant compte de ces éléments et estimant qu’un tel changement de sexe va à l’encontre de la nature, se sont donné beaucoup de mal pour prouver : 1) qu’Orlando avait toujours été une femme ; 2) qu’Orlando est toujours un homme. Laissons les biologistes et les psychologues en décider. Il nous suffit de présenter les choses dans leur simplicité : Orlando avait été homme jusqu’à l’âge de trente ans ; puis il devint femme et l’est encore à ce jour. (WOOLF, 1993 [1928], 137)
Loin du parce que ceci, alors cela, la vie d’Orlando se joue dans la pure succession. Or, il se pourrait, au contraire, que Jacqueline Harpman, qui est aussi psychanalyste, entretisse trop lourdement son roman de schémas et d’explications qui limitent l’indétermination que l’intrigue pouvait ouvrir. Pour le dire simplement, alors que le lecteur d’Orlando navigue à vue, le lecteur d’Orlanda peut rapidement avoir l’impression que le jeu n’est pas si ouvert que cela, voire que les dés sont pipés. Alors, Jacqueline Harpman et sa narratrice jouent-elles le jeu jusqu’au bout ? Se laissent-elles prendre dans les directions ouvertes par la schize ludiquement posée au départ, ou bien le roman referme-t-il l’espace de jeu qu’il a d’abord ouvert, échouant à troubler les identités et le genre ?
1. Comment lire pour jouer ?
Orlanda veut jouer avec le roman de Virginia Woolf et nous invite à le relire en creux, à l’aune de ses effets sur Aline, jeune enseignante à l’université sommée de préparer un cours sur Orlando. À travers la crise subie par la lectrice fictive se manifeste, d’une part, la force subversive de la biographie fictive écrite par Virginia Woolf, qui ne saurait laisser sa lectrice indemne, et devient sensible, d’autre part, le fait que l’efficace de la littérature, et du jeu qu’elle propose à son lecteur, ne tient pas à la possibilité d’une répétition à l’identique de l’expérience des personnages qu’elle met en scène, mais à une répétition dans l’écart, à une façon de rejouer, toujours autrement, ce que le texte propose. La contamination ludique est imprévisible, ou encore, elle n’advient pas comme transmission de formes mais comme invitation à une déformation dont les conditions d’exercice sont livrées aux lecteurs. En effet, la rencontre du personnage transsexuel de Virginia Woolf donne lieu, lorsqu’il est reçu par Aline, à une transmigration : une partie refoulée de l’âme d’Aline se détache de son corps pour se réincarner dans celui d’un jeune inconnu, Lucien.
Aline Berger, alors qu’elle attend son train pour Bruxelles dans un café proche de la Gare du Nord, se force, sans entrain, à lire Orlando afin de préparer un cours. La lecture qui provoque la crise est une lecture contrainte, une lecture prescrite par l’institution académique, et qui se doit, dès lors, de se plier à ses règles. Lisant Orlando, Aline « s’attache au texte, qui ne la captive pas vraiment » (HARPMAN, 1996, 9-10). S’attacher au texte est même peu dire, puisqu’au moment où nous la rencontrons, Aline relit pour la dixième fois le passage de la métamorphose d’Orlando en femme ; « cherchant à en saisir le sens sous-jacent, elle a toujours le sentiment de rester en surface et ne consent pas à penser qu’il n’y a peut-être rien en dessous » (HARPMAN, 1996, 10). Sont inscrites, ici, les règles du jeu de la lecture académique. Dans une telle lecture, le sens, pour être légitime, se doit d’être profond ou remonté des profondeurs. Il est gagné à coups de sonde, il requiert érudition et dextérité d’analyse, c’est-à-dire qu’il ne saurait être identifié à ce qui se montre à la surface. Ce qu’il y a à comprendre, ce n’est pas ce qui saute aux yeux, mais ce qui n’est pas dit, ce qu’il faut deviner. Ces règles du jeu, qui se fondent sur l’opposition du visible et du caché, installent dans la lecture littéraire l’opposition de l’explicite et de l’implicite, mais elles renvoient aussi, dans la pratique psychanalytique, à celle du manifeste et du latent. Quoi qu’il en soit des règles que s’impose une lecture qui refuse d’être dupe des apparences, ce qui est pourtant pleinement exposé dans ce passage du roman de Virginia Woolf c’est le corps d’Orlando qui « apparaît totalement nu à nos yeux » (WOOLF, 1993 [1928], 136) : un corps d’homme soudainement métamorphosé en corps de femme. Ce qui est tout aussi visible, c’est que cette métamorphose, dont Aline s’obstine à vouloir déceler le sens profond, n’a rien de problématique pour celui auquel elle est arrivée. Au moment où il découvre son nouveau corps, Orlando, en effet, « n’eut pas l’air troublé le moins du monde, puis s’en fut, probablement, prendre son bain » (WOOLF, 1993 [1928], 136). Mais Aline, lectrice appliquée, s’efforce, apparemment, de ne pas voir ce que le texte exhibe, de ne pas lire ce qu’il lui donne à lire pour mériter de proposer ce qui est caché.
Cela étant, cette lecture avide de profondeur, ce jeu réglé, n’est pas le seul possible. Et d’ailleurs, pendant qu’Aline, consciente et maîtresse d’elle-même, s’ennuie sur le texte à expliquer, la narratrice versée en psychanalyse commence d’entendre un « autre courant de pensée » (HARPMAN, 1996, 10), une petite voix secrète ou inconsciente qu’Aline n’entend pas ou qu’elle fait taire. Cette petite voix se propose de jouer le jeu proposé par Orlando, de faire ce qu’il dit, pour de vrai : « Et si on changeait de sexe ? Si je t’abandonnais, ô âme timide, ce corps de fille, et si j’allais loger dans un garçon, tiens ! celui qui est là, en face de moi […] » (HARPMAN, 1996, 10). Un bout d’âme, donc, décide de prendre son envol. Si, à la surface, la lecture patiente et consciente d’Aline ne provoque chez elle que de l’ennui, dans les profondeurs inconscientes de sa psyché, un autre projet est en route, qui implique, concrètement, rien moins qu’une schize et qu’une métempsychose.
À avoir insisté sur les règles qu’Aline s’impose en tant que lectrice qui sait ce qu’elle fait et ce qu’elle doit faire, on peut être tenté de remarquer que la schize envisagée par cette âme souterraine redouble la scission de la lectrice. Aline, dans son rôle institué d’enseignante, ayant intériorisé les exigences de l’institution académique, se doit d’opérer une lecture profonde et problématique du texte. Ce faisant, elle fait taire ou elle refoule, sans y parvenir tout à fait, la lectrice naïve qui, spontanément, lit moins le texte qu’elle ne découvre, à même la vie des personnages, des existences possibles, et a dès lors tendance à penser que les possibilités d’être que font miroiter les romans ne sont pas seulement faites pour être contemplées. Tandis qu’Aline, consciente et maîtresse d’elle-même, s’ennuie à l’analyse, son âme secrète, celle qu’elle n’écoute pas, se prend au jeu affectif et éthique que sollicite toute lecture et rencontre le roman comme invitation à être d’une certaine manière. Cette petite voix qu’Aline n’écoute pas est celle d’une lectrice que les règles académiques de la lecture font taire ou tiennent cachée. Qui est-elle, alors, cette petite voix ? Et comment se propose-t-elle de jouer Orlando ?
2. Jouer le jeu de la métamorphose, autrement
Cette partie refoulée d’âme, qui s’échappe du corps d’Aline, c’est la partie dite violente de son âme, toute « vigueur », « force » et « rage » (HARPMAN, 1996, 10). Autant de termes qui engagent à considérer que cette partie d’âme est masculine. Qu’elle choisisse de s’installer dans le corps d’un jeune homme, Lucien, nous conforte sur cette piste, de même que son comportement, pour le dire ainsi, lorsqu’elle prend possession, avec force et vigueur, du corps de Lucien. En effet, elle n’a pas frappé avant d’entrer, et la métempsychose s’opère dans un geste de viol ou de colonisation, par lequel on s’installe fermement dans le corps de l’autre.
Je suis dans le jeune homme blond, j’ai pénétré, tranquille, dans sa tête. Il ne remarque rien. Peut-on si aisément se laisser déloger ? Il ne devait pas beaucoup tenir à lui-même car il a disparu sans un souffle. La maison est à moi (HARPMAN, 1996, 14).
L’acte d’incarnation, ici, se joue dans l’annihilation de l’autre ; c’est ainsi, apparemment, qu’on devient un homme. Et sans oser dire que le jeune homme en question l’a bien cherché, on souligne, à tout le moins, qu’il n’a pas résisté, ce qui, apparemment, autorise tout. Voire, on l’a aidé à y voir clair : assassiner un suicidaire n’est pas vraiment un crime – ce que confirmera d’ailleurs la fin du roman. Bref, en première approche, la voix secrète qu’Aline faisait taire était une voix masculine ; et faire entendre cette voix, lui faire droit, ce serait commettre viol et violence. D’ailleurs, lorsque ce jeune homme à l’âme renouvelée, quelques minutes plus tard, couche avec un autre homme dans les toilettes du train qui le mène, comme Aline, à Bruxelles, la narratrice – qui, par pudeur, n’en dit pas grand-chose – parle tout de même de « violence », de « duel », de « combattants », de « choc » (HARPMAN, 1996, 37), choses toute positives pour cette âme nouvellement incarnée dans un corps vigoureux.
À en rester là, il ne se dirait, dans Orlanda, qu’une vision convenue de la masculinité, et cela à l’occasion d’une métempsychose qui, elle-même, se jouerait caricaturalement comme le mouvement d’une âme masculine pour rejoindre le corps qui lui convient. À suivre cette piste, le bout d’âme d’Aline, psyché masculine refoulée dans un corps de femme, se donnerait le corps qui lui permet de manifester les manières d’être qu’elle n’a pu inscrire dans un corps de femme. Cependant, la narratrice intervient pour défaire l’interprétation de son lecteur et affirmer que ce bout d’âme qui s’est échappé n’est pas tant une psyché masculine, auparavant refoulée dans un corps de femme, que la dimension masculine d’une psyché féminine, demeurant, même évadée de sa prison, ambivalente. Ainsi, ce qui naît de la métempsychose n’est pas un homme, si on accepte de définir un homme par la coïncidence d’une âme forte et vigoureuse dans un corps qui l’est tout autant – définition discutable, certes –, mais autre chose, sans que l’on sache quoi. Ce pour quoi la narratrice, remarquant que Virginia Woolf continue d’appeler son personnage Orlando en « mettant les pronoms personnels au féminin », ce qui « entretient ainsi le trouble dans l’âme du lecteur » (HARPAMN, 1996, 19), décide d’appeler le jeune homme nouvellement colonisé Orlanda.
D’Orlando à Orlanda, il y aurait donc eu contamination du trouble, et le jeu de Jacqueline Harpman poursuivrait celui de Virginia Woolf. Cependant, alors qu’Orlando devient spontanément femme, son aventure invite l’âme refoulée qui la lit à quitter volontairement un corps de femme, « prison où il avait été enfermé et dont il n’avait jamais imaginé s’évader » (HARPMAN, 1996, 43), pour gagner une liberté nouvelle dans un corps d’homme. Si la petite voix désormais émancipée, nommée Orlanda, joue avec le roman de Virginia Woolf en récusant les règles académiques de lecture incorporées par Aline et en inventant ses propres règles du jeu, force est de constater qu’en imposant celles-ci, elle inverse aussi le jeu woolfien. Elle le fait d’une part parce que le mouvement s’opère ici du féminin vers le masculin et referme ainsi abruptement la possibilité ouverte par Orlando, celle-là même qui fait sa portée subversive, à savoir un passage du masculin au féminin qui n’est pas une catastrophe ou une amputation et d’autre part, parce que la métamorphose insensible et non problématique d’Orlando qui, dans l’histoire d’une vie, passe de l’un à l’autre, devient ici l’épreuve d’une crise : Aline subit une schize et perd une partie de son âme au moment où Orlanda, s’emparant du corps de Lucien, annihile l’âme de ce dernier. Bref, là où vit Orlanda, il semble bien qu’on ne saurait jouer avec le partage des sexes sans entrer en guerre. À quoi cela tient-il ? Qu’est-ce qui contraint le jeu à mal tourner ?
3. On ne joue plus !
Lorsque Orlanda envisage de faire sécession, elle annonce immédiatement que, si elle quitte ce corps de femme, corps-prison, c’est pour quitter le gynécée, pour se tenir dans la compagnie exclusive des hommes. Cela ne signifie pas, ici, qu’il s’agira de jouer au foot et d’aller au bistrot, mais que seule une sexualité homosexuelle est envisageable. Au premier abord, on pourrait être tenté de considérer que l’ambivalence d’Orlanda se manifeste ici. Non seulement Orlanda ne sera pas vraiment un homme, parce que son âme vigoureuse est aussi échappée d’un corps de femme, mais surtout, Orlanda ne sera pas un homme, si on accepte ici de définir un homme par le fait qu’il désire des femmes – définition tout aussi discutable, certes, que la précédente –, parce qu’elle se promet de désirer des hommes. Bref, ce qui joue ici, pour manifester l’ambivalence, ce n’est pas seulement un quelconque hiatus entre le corps physique, donc le sexe, et l’âme qui saurait être dite masculine ou féminine selon les manières d’être qu’elle met en jeu, donc le genre ; l’identité elle-même, in fine, semble se cristalliser par la direction du désir, par le choix d’objet : être homme, c’est désirer les femmes, mais aussitôt, être femme, c’est désirer les hommes. Dès lors, toute ambivalence ne saurait relever que d’une discordance, pour le dire ainsi, entre le sexe et le choix d’objet : Orlanda est ambivalente parce qu’installée dans un corps d’homme, elle désire comme une femme ou en tant que femme. Ou, pour le dire autrement, elle est ambivalente parce qu’étant, pour qui s’en tiendrait à la mécanique des corps, un homme manifestement homosexuel (ce qui, dans ce dispositif, est une contradiction), elle est plus profondément une femme hétérosexuelle (ce qui, dans ce dispositif, est un pléonasme).
Cela apparaît notamment dans la scène qui succède immédiatement à celle de la métempsychose. Orlanda, nouvellement incarnée dans le corps de Lucien, fait un arrêt dans les toilettes de la gare avant de prendre son train. Il se regarde dans le miroir, décide de s’arranger les cheveux, se trouve beau. Au premier abord, on est tenté de voir là un désir du masculin pour le masculin, mais la narratrice intervient aussitôt pour préciser que
c’est l’enveloppe corporelle d’un autre qu’il admire ainsi, comme une fille qui s’émerveille d’un nouvel habit, car il était fille il y a un quart d’heure, et fille sensible aux garçons (HARPMAN, 1996, 21).
Bref, il s’agit ici de rappeler que le désir d’Orlanda est hétérosexuel, qu’il est le désir d’une femme pour un corps qui n’est pas appréhendé, encore, comme le sien, mais comme le corps de l’autre. L’enthousiasme ne s’arrête pas là, puisque Orlanda aperçoit aussitôt la promesse d’une nouvelle expérience : elle doit « pisser », ce qui le remplit d’abord d’une certaine gêne, sa main étant encore la main de celle qu’il n’est plus, et le sexe celui d’un autre qu’il n’est pas encore, mais le remplit ensuite, à dire le moins, d’une certaine émotion. Mais là encore, ce qui est mis en avant, c’est la satisfaction pour Orlanda de tenir dans sa main ce que la fille n’a pas. Si Orlanda désire ce qu’il désire comme s’il ne l’avait pas, en d’autres termes, s’il désire son pénis nouvellement acquis comme celui d’un autre homme, cela signifie proprement qu’il est une femme – si on accepte ici de définir une femme comme un être structuré par l’envie du pénis. Le désir hétérosexuel qui anime Orlanda se dit comme désir d’avoir pour soi ce que possède l’autre, épreuve jamais surmontée d’un manque. En quoi Orlanda, quoi que la narratrice dise du trouble qu’il devrait faire naître, reste bien, dans cette expérience, fille – et fille selon la définition psychanalytique du partage des sexes.
Bref, tout n’est pas remis en jeu par la schize et par la métempsychose. Si Orlanda quitte le corps d’Aline, la transmission du choix d’objet continue de les lier. Or, cette transmission, non seulement referme le trouble qui pouvait naître en rendant explicable la sexualité d’Orlanda, mais elle réinstaure aussi l’identité d’Aline et d’Orlanda, de telle sorte que leurs chemins, en fait, ne sauraient diverger ; les possibilités ouvertes par la schize sont ainsi aussitôt refermées. Surtout, il semble que si on se laisse prendre au jeu de l’ambivalence supposée d’Orlanda, pour tenter d’en dénouer les fils, on prend le risque de ne pas remarquer que ladite ambivalence d’Orlanda n’est que la confirmation de l’identité fermement hétérosexuelle d’Aline. Si Orlanda, partie d’âme refoulée, soudainement émancipée du corps d’Aline, s’incarnait dans un autre corps pour désirer des femmes, il faudra en effet conclure à la bisexualité d’Aline. L’homosexualité apparente d’Orlanda ne sème qu’un moindre trouble parce qu’elle confirme aussitôt l’hétérosexualité d’Aline. C’est-à-dire que le roman de Jacqueline Harpman, rejouant Orlando, voulant jouer le jeu de la métamorphose, ne joue pas sans règles, dans la mesure même où elle n’envisage pas que la crise qui a lieu puisse aussi impliquer une instabilité du choix d’objet, une remise en question de l’hétérosexualité.
Or, ce faisant, c’est précisément Orlando qui n’est pas rejoué. En effet, Orlando, lorsqu’il est encore homme, « car son sexe ne faisait aucun doute quoique la mode du temps contribuât un peu à la travestir » (WOOLF, 1993 [1928], 13), vit certes comme un coureur de jupons, mais sans qu’il aille de soi que ses conquêtes féminines soient le fait d’un désir exclusif de l’autre sexe. À l’instant où Orlando tombe amoureux de Sasha, sa princesse russe, il s’éprend concrètement d’une « personne, de nom et de sexe inconnus » (WOOLF, 1993 [1928], 37). Ce n’est donc pas le sexe de Sasha qui compte, et l’on peut même penser que l’enthousiasme qui s’empare d’Orlando tient surtout à ce que cette personne lui évoque, spontanément et en même temps, « un melon, un ananas, un olivier, une émeraude » et « un renard dans la neige » (WOOLF, 1993, 37). Et si Orlando est rassuré quand il comprend que Sasha est une femme, rien n’indique non plus que ce soit parce qu’il craignait sa propre homosexualité ; il craignait peut-être bien plus que Sasha soit un homme à femmes – exclusivement – et non aussi un homme à Orlando, comme Orlando est prête à être un homme à Sasha, quel que soit son sexe. Virginia Woolf, là, nous force à envisager que l’amour puisse naître à même l’indétermination de son objet.
Certes, dans Orlando, comme dans Orlanda, une continuité ou un héritage est en jeu au moment de la métamorphose : de même qu’Orlanda emporte avec elle la sexualité d’Aline, Orlando, dans son nouveau corps de femme, conserve sa sexualité antérieure : « c’était encore la femme qu’elle aimait » (WOOLF, 1993 [1928], 158). Apparemment lesbienne, Orlando, là, est peut-être, comme Orlanda, hétérosexuelle au-dedans, sa psyché résiduelle d’homme, pour le dire ainsi, continuant de désirer les femmes. Mais les choses ne sont jamais simples ou explicables dans Orlando. Dans un des passages les plus amusants du roman, Orlando, femme qui désire des femmes, est courtisée par l’archiduchesse Harriet. Mais on apprend aussitôt que celle-ci n’est autre que l’archiduc Harry ayant entrepris de se travestir pour faire la cour à Orlando : il pourrait sembler, ici, que Harry prend en compte l’homosexualité, au moins, apparente, d’Orlando pour la séduire en se donnant, au moins par le déguisement, le sexe qui convient. Or, le lecteur apprend aussitôt que Harry est tombé amoureux d’Orlando avant sa métamorphose : Harry est un homme tombé amoureux d’un homme qui, après la transformation de ce dernier en femme, se travestit en femme pour le séduire. Et être femme ou être homme, dit le texte, ne sont que des « rôles » (WOOLF, 1996 [1928], 175), qui ne définissent en rien les personnes. De fait, concrètement, chacun est indéterminé et, dès lors, sa sexualité ne saurait que l’être aussi.
Cela est encore plus manifeste lorsque Orlando rencontre, plus tard, celui qui deviendra son mari, Marmaduke Bonthrop Shelmerdine :
« Shel, vous êtes une femme ! », s’exclama-t-elle.
« Orlando, vous êtes un homme! », s’exclama-t-il. (WOOLF, 1993 [1928], 244)
Marmaduke, donc, dit ici Shel, est un homme qui n’est pas un homme, ou qui est aussi une femme, ravi de découvrir, chez Orlando, une femme qui n’est pas une femme, ou une femme qui est aussi un homme. Bref, Orlando et son mari, aussi aventurier que lui, sont engagés dans un mariage queer : un mariage qu’on ne saurait déterminer, dans lequel on ne saurait dire qui épouse qui, parce qu’il n’est ni le mariage d’un homme et d’une femme, ni celui de deux hommes ou de deux femmes, ni hétérosexuel ni homosexuel. Dans le mariage d’Orlando et de Marmaduke, il n’y a rien à démêler ou à comprendre ; l’objet du désir n’est pas précisément déterminable, et il n’est pas important de se poser la question. Orlanda, au contraire, semble exclure la non-hétérosexualité ou, tout au moins, l’indétermination du choix d’objet. Jacqueline Harpman joue dans le cadre de la « matrice conceptuelle hétérosexuelle » (BUTLER, 2006 [1990], 52), si bien que le jeu est immédiatement domestiqué. À suivre cette ligne de lecture, le jeu sur la sexualité et le genre, ouvert dans le roman de Virginia Woolf, est refermé dans Orlanda. Le trouble qu’aurait pu faire naître Orlanda est aisément dissipé parce que sa sexualité est explicable, de même que l’identité d’Aline, plus que d’être sans ambiguïté, est aussi posée comme allant de soi. Le jeu de Jacqueline Harpman, donc, tourne court. Comment serait-il possible de le relancer ?
4. Être contrainte à jouer la femme
Le début du roman de Jacqueline Harpman, qui s’arrête sur Orlanda pour tenter de le cerner, a semblé rejouer, à sa façon, le trouble dans la sexualité et dans le genre qui traverse le roman de Virginia Woolf. Or, à notre sens, le jeu tourne court. Mais la narratrice s’en aperçoit peut-être, puisqu’elle propose, dans un autre fil de l’intrigue, d’examiner maintenant les effets de la lecture d’Orlando sur Aline, dans l’après-coup de la schize. C’est bien là le moyen de rejouer autrement Orlando, ou de faire jouer une autre de ses dimensions, à savoir le féminisme de Virginia Woolf. Si le corps d’Orlando subit un changement spontané de sexe, il lui reste, néanmoins, à devenir femme. Et la question est ouverte de savoir ce que cela veut dire.
Dans Orlando, la métamorphose corporelle ne transforme pas immédiatement celui qu’elle concerne, Orlando demeurant « tel qu’en lui-même » (WOOLF, 1993 [1928], 137). Sa personnalité et son comportement ne changent pas. Mais le narrateur remarque aussitôt que cette métamorphose, d’abord superficielle, ne saurait le rester longtemps, dans la mesure où la mutation d’Orlando altère son avenir : il faudra que la vie d’Orlando se conforme à son sexe. Cette conformation, cependant, n’advient pas immédiatement. Orlando, au moment de sa métamorphose, se trouve à Constantinople avec des Bohémiens et, en leur compagnie, elle peut continuer de se vêtir et de vivre selon son habitude : jusqu’à ce que la décision soit prise de revenir en Occident, et plus précisément en Angleterre, « elle n’avait pas […] accordé la moindre attention à son sexe » (WOOLF, 1993 [1928], 151). Une fois le retour envisagé, par contre, sont mises en avant toutes les contraintes, inscrites dans le droit et dans les mœurs, qui s’exercent sur les femmes. Orlando se doit de « sentir des jupes lui enserrer les mollets » (WOOLF, 1993 [1928], 151) et découvre, peu à peu, « l’édifice de l’économie féminine » (WOOLF, 1993, 151) et les « responsabilités sacrées de la femme » (WOOLF, 1993 [1928], 155), qui règlent jusque dans ses moindres détails les parcours d’une existence. Mais parce qu’Orlando traverse les siècles, ce n’est en fait qu’à l’époque victorienne, dans laquelle « les sexes s’éloignèrent de plus en plus l’un de l’autre » (WOOLF, 1993 [1928], 223), qu’elle se doit véritablement d’incorporer les exigences et les contraintes culturellement imposées à son sexe, s’exposant ainsi à une altération durable – plus violente que la métamorphose initiale, bien que moins spectaculaire. Contrainte de réaliser l’adéquation socialement construite et prescrite du genre au sexe, Orlando devient femme dans un corps de femme.
Sa pudeur concernant ce qu’elle écrit, sa vanité touchant sa propre personne, ses alarmes à propos de sa sécurité, tous ces indices semblent suggérer que ce que l’on disait un peu plus tôt – qu’il n’y avait pas de différence entre Orlando l’homme et Orlando la femme – cessait d’être tout à fait vrai. Elle devenait un peu moins fière de son intelligence, ce qui est typique des femmes, et un peu plus vaine de sa personne, ce qui est typique des femmes. Certaines inclinations s’affirmaient avec plus de force et d’autres s’effaçaient. La différence vestimentaire y était, certains philosophes l’assurent, pour beaucoup. Les vêtements peuvent sembler de vaines bagatelles mais, disent ces mêmes philosophes, leur fonction la plus importante n’est pas de nous tenir chaud. Ils changent notre vision du monde et la vision que le monde a de nous (WOOLF, 1993 [1928], 183).
Le narrateur refuse cependant que cette explication soit définitive et envisage aussitôt qu’Orlando a peut-être changé de vêtement et de sexe – le corps n’étant que le premier vêtement – que parce que sa personnalité, au gré de ses expériences, avait changé, l’âme, donc, informant le corps. D’ailleurs, le poids des vêtements, s’il est lourd, n’est pas impossible à soulever. Même réinstallé en Angleterre, Orlando continue de jouir de l’indétermination qui est la sienne – puisque, devant le tribunal, la question de son sexe n’a pas encore été tranchée – et elle s’habille, à son gré, en femme ou en homme, faisant varier les apparences ou les apparitions d’une personnalité si multiple ou labile qu’elle ne saurait prendre corps une bonne fois pour toutes. Elle peut d’ailleurs, de ce fait, « être aimée par les deux sexes également » (WOOLF, 1993 [1928], 215). Orlando avance donc en suivant, simultanément, deux directions contraires : tout en entretenant son indétermination, elle incorpore peu à peu les comportements réglés qui sont le lot des femmes, ceux-ci étant clairement signifiés, dans le roman de Virginia Woolf, comme contraintes et non comme manières d’être naturelles. Comment la critique féministe, alors, est-elle rejouée dans Orlanda ?
Au lendemain de la schize, nous retrouvons Aline dans son appartement bruxellois. Toujours dépitée devant un texte qui lui résiste, elle s’afflige de ne pas « penser comme il faut » (HARPMAN, 1996, 25), c’est-à-dire de ne pas parvenir à identifier la règle de lecture que lui impose, comme tout grand texte, Orlando, règle de lecture à laquelle tout lecteur émérite sait se soumettre. La narratrice, qui observe désespérément Aline s’acharner à l’interprétation, propose un retour en arrière afin d’expliquer l’amour des règles qui anime cette dernière. Il s’agit là, plus précisément, de revenir à l’enfance d’Aline et à ses relations avec sa mère. Cette dernière apparaît, sans surprise, comme une figure castratrice : lorsque nous la rencontrons, elle reproche à Aline, encore enfant, d’être « masculine » (HARPMAN, 1996, 27), parce qu’elle est entrée un peu trop vivement dans la maison. Masculine, ici, cela signifie donc vive et spontanée. Cette remarque, qui réclame à Aline de se comporter en fille, glisse cependant sur Aline-enfant comme la pluie. Elle ne devient audible et ne déploie pleinement ses effets que lorsque Aline a ses premières règles, comme si une modification spontanée dans le corps, qui manifeste la plasticité de ce dernier, rendait aussitôt l’âme elle-même plastique, prête à prendre la forme qui lui sera prescrite. Mais les choses ne sont cependant pas si simples, dans la mesure où ces règles, vécues d’abord comme pur événement corporel, ne font pas grand effet à Aline. Elles ne font effet que le mois suivant, après avoir été prises dans les paroles de la mère, qui recommande à sa fille de garder le lit pour se prémunir contre les malaises. Le sens des règles a été imposé, et avoir ses règles, maintenant, cela ne signifie pas seulement qu’il se passe, certes, quelque chose dans le corps, mais que ce quelque chose doit régler le comportement d’Aline, lui prescrire ses gestes. Plus que les métamorphoses du corps, ce sont donc les mots des autres qui fabriquent l’identité sexuelle, voire le corps vécu
1, comme corps souffrant, les règles d’Aline ne devenant douloureuses, aussi, que lorsque sa mère lui indique qu’il doit en être ainsi.
Il s’agit bien ici de rejouer la critique féministe présente dans Orlando, et de rejouer la métamorphose d’Orlando autrement, en la transposant dans la biographie d’Aline. La métamorphose spontanée et réelle du corps d’homme d’Orlando en corps de femme devient, dans la biographie d’Aline, la métamorphose du corps de l’enfant en corps de femme (si l’on accepte de définir un corps de femme par les menstruations). Et de même qu’Orlando, découvrant son corps métamorphosé, ne s’en offusque pas et continue sa journée comme si de rien n’était, Aline, d’abord, constate ses règles sans en être affectée. La métamorphose du corps, ici comme dans Orlando, ne change rien de prime abord.
À cette étape du roman, en laissant Orlanda à ses occupations et en revenant à Aline, la narratrice semble bien relancer, au moyen d’une transposition, le jeu avec le roman de Virginia Woolf, en même temps qu’elle se met en mesure de rejouer davantage que le seul passage de la métamorphose. À la faveur de la transposition, la lecture d’Orlando, en creux, se poursuit, cependant que la dimension féministe du roman de Virginia Woolf trouve à inscrire son écho. Dans Orlanda comme dans Orlando, on devient femme. Les règles d’Aline interviennent comme le signal qui autorise sa mère à faire désormais peser lourdement sur sa fille les injonctions par lesquelles celle-ci incorporera son genre, le genre féminin exigeant que certains corps soient colonisés par des prescriptions qu’ils se doivent d’incarner. Cela étant, prescrire des comportements à Aline n’a pas seulement pour effet de fabriquer une femme, mais aussi de tuer quelque chose d’autre, de faire disparaître ce qui est déjà là : le masculin.
Sa chevelure abondante et désordonnée fut domptée par d’excellents coiffeurs, elle apprit à manipuler les objets sans se casser les ongles et les idées sans heurter ses interlocuteurs. Elle aima plaire, c’est ce qui tue le garçon dans la fille (HARPMANN, 1996, 28).
Le genre féminin, donc, s’incorpore violemment, et la fille naît de son renoncement, non seulement à des possibilités d’être à venir, mais aussi à ce qu’elle a déjà été. D’une certaine manière, la transposition d’Orlando, dans sa dimension féministe, est ici parfaite, en ce qu’Aline a joué, dans son enfance, la même métamorphose qu’Orlando : elle a été masculine avant de devenir, de force, une femme, elle a subi une transformation du corps qui n’était que le coup d’envoi d’une altération de l’âme. De même qu’Orlando, d’homme, devient femme, Aline, d’abord garçon, devient fille.
Néanmoins, dans Orlando, être femme ou être homme consiste seulement à jouer un rôle, la personne, en deçà, demeurant indéterminée, tant dans son genre que dans sa sexualité. Or, Aline, nous l’avons vu, est fermement hétérosexuelle. Mais surtout, à lire ce que la narratrice, dans Orlanda, dit des femmes et de leur fabrication, on perçoit la tentation d’une naturalisation du masculin. En effet, pour la narratrice d’Orlanda, des femmes qui ne sont que femmes, qui ont pleinement incorporé les prescriptions qui leur ont été faites, il n’y a rien à dire. Aline, en tant que femme, échoue à être singulière, « elle ressemble à sa mère, qui ressemblait à sa mère » (HARPMAN, 1996, 30). Et les femmes ne peuvent être qu’inintéressantes, incapables, aussi, de fournir la matière d’un personnage, précisément parce qu’elles sont l’exacte incarnation de normes générales. Dès lors, seul le masculin saurait être particulier, de même que la vitalité et la spontanéité – que l’on tue dans les filles – sont masculines. Le genre masculin, ici, posé comme spontané et premier, est bien naturalisé, tandis que le genre féminin, construit et prescrit, est essentiellement social.
Pourtant, contrairement à Aline, Orlando, lorsqu’elle devient femme, demeure « virevoltante », légère et fantasque. Elle ne s’arrête pas de vivre mais continue de courir en tous sens, en s’amusant, seulement, des nouvelles règles de la course ou des stratagèmes dont elle peut user pour les déjouer. Le féminisme de Virginia Woolf, semble-t-il, ne nous invitait pas à penser que la vitalité n’appartient qu’aux hommes. Ainsi, à rejouer l’intrigue Orlando, en la transposant cette fois dans l’enfance d’Aline, en l’y inscrivant telle qu’elle, n’a-t-on pas, encore une fois, arrêté de jouer ?
5. Jouer comme un enfant ?
La tentative de faire jouer la métamorphose d’Orlando dans le personnage d’Aline, de même que la tentative précédente de faire jouer l’indétermination sexuelle d’Orlando dans Orlanda, tourne court. Comment, dès lors, encore une fois, relancer le jeu ? Le narrateur d’Orlando est un narrateur sans cesse surpris par le personnage dont il tente de faire la biographie, voire tourmenté dans sa tentative de donner cohérence à une existence qui, à dire le moins, ne tient pas. C’est ce jeu-là que la narratrice d’Orlanda propose aussi de jouer, en mettant en scène l’étonnement qu’Aline, pourtant femme, provoque soudainement.
Aline, en effet, n’est pas une femme comme les autres. Comme le souligne la narratrice elle-même, elle « a quelque chose de particulier, cela est sûr, son travail sur Proust est vraiment remarquable » (HARPMAN, 1996, 30). Aline, donc, n’est pas reproductrice comme le sont les femmes – les femmes générales dont il était question plus haut, celles qui se ressemblent toutes –, mais elle est créative comme un homme, a-t-on envie de dire. Ceci étant, parce que le travail sur Proust dont il est question précède la schize, on pourrait être tenté de considérer que la créativité qu’il manifeste tient à la présence secrète d’Orlanda : certes refoulée lorsqu’elle habitait Aline, elle est aussi masculine et spontanée et pouvait, après tout, opérer en secret. Pourtant, dans les jours qui suivent la schize, Aline, continuant désespérément de rechercher ce qui lui permettrait d’expliquer le sens de la métamorphose d’Orlando, parvient à surprendre sa narratrice par sa créativité. Alors qu’elle s’efforçait, jusque-là, en lectrice appliquée, d’examiner les signes du texte comme autant d’indices qui lui délivreraient le sens caché de la métamorphose, alors qu’elle s’imposait de faire ce qu’elle exige de ses étudiants, à savoir chercher le sens du texte dans le texte seul, un déclic advient soudainement.
Mais il n’a jamais été un garçon ! s’écria-t-elle. Les sept jours au lit, ma mère m’a-t-elle assez bassiné les oreilles, c’est la puberté ! Tout n’est qu’allégorie, et c’est elle-même que Virginia raconte : enfant, elle était forte et ardente, elle jouait à la guerre contre les Maures au grenier, elle avait une amie qu’elle adorait et qui s’est mise à la négliger pour les garçons, alors elle s’est retirée dans l’étude et dans la rêverie […] (HARPMAN, 1996, 64).
Soudainement, la lectrice exulte d’avoir tramé sa propre interprétation. Or, celle-ci ne peut surgir que parce qu’elle mobilise un immense hors-texte qui renvoie, d’une part, aux connaissances qu’elle possède sur la vie de Virginia Woolf et, d’autre part, aux souvenirs personnels qui se trouvent soudainement mobilisés. Bref, le nœud de la lecture, par lequel lire ce livre-là parvient enfin à être joué et a enfin quelque chose à dire à sa lectrice, se forme au moment où la lectrice, sans l’avoir décidé, se passe des règles qu’elle s’imposait. Sa lecture, alors, met en jeu le sens du texte, plus qu’il ne le décèle et, en même temps, la subjectivité concrète de la lectrice est tout entière mise en jeu par la lecture, puisque l’histoire personnelle d’Aline est réinvestie pour donner sa clé au texte.
Certes, on le remarque aussitôt, Aline propose ici une interprétation qui n’est autre que celle qui a déjà été avancée par la narratrice, mais cette dernière, qui ne s’attendait pas à tant, intervient néanmoins pour se dire étonnée de voir Aline si « à l’aise dans la réflexion ! » (HARPMAN, 1996, 64). Et, plus que cela, l’interprétation créative d’Aline, quelle que soit sa nouveauté pour la narratrice, permet à cette dernière de débusquer le présupposé qui était le sien, à savoir que « seul le garçon possède la vigueur » (HARPMAN, 1996, 65). Bref, surprise : Aline est vigoureuse ! Et cela, même avec un bout manquant, même privée d’Orlanda !
Que faut-il en conclure, dès lors, quant à la vigueur ? Il faudrait tenir que la vigueur, la spontanéité, la créativité, appartiennent à l’enfant et non au masculin. Ce qui est premier et naturel ne serait donc ni masculin ni féminin. Mais quoi alors ? Après être retombée, à chaque fois, dans la matrice hétérosexuelle, en n’admettant comme pensable qu’un partage du masculin et du féminin, de l’homosexualité et de l’hétérosexualité, la narratrice, ici, ne semble pouvoir s’en sortir qu’en prenant la fuite, qu’en envisageant quelque chose comme un neutre ou une indétermination qui tiendrait à l’absence de déterminations sexuelles. Au contraire, l’indétermination d’Orlando, celle que Virginia Woolf nous invite à penser, ne se joue pas en ce sens-là : elle est l’indétermination de qui navigue, spontanément ou par contrainte, entre des déterminations sexuelles multiples et peut-être contradictoires ; elle force à penser l’historicité et l’instabilité de la sexualité, du genre et du corps lui-même au sein d’une vie personnelle, et non le passage d’une préhistoire de l’enfance dans laquelle le corps comme l’âme seraient neutres, à l’information de ces mêmes corps et âmes par des déterminations qui pourraient les assigner à une identité stable. Bref, il semble impossible, dans Orlanda, de sortir de la matrice hétérosexuelle, sinon en se faisant la fiction d’un neutre qui précéderait la sexualité, le genre et même l’information des corps, c’est-à-dire en se faisant la fiction d’une personnalité originelle dans laquelle il n’y aurait pas encore de jeu. Le partage entre masculin et féminin, in fine, est évincé et remplacé par le partage de l’enfant et de l’adulte ; et une fois ce glissement opéré, la question de la formation-déformation de soi, celle du jeu et de l’indétermination qui se trament dans une vie s’efface devant la question de la formation du sens des textes.
Conclusion : pour jouer, ne pas vouloir jouer
Il est vrai que les questions de la créativité et de l’écriture travaillent dans Orlando. Mais celui-ci invite-t-il à penser que, pour être créatif, il faut encore être un peu enfant, au sens où il s’agirait d’être mâtiné d’une indétermination qui relève du neutre ? Orlando, depuis son plus jeune âge, écrit : homme, il a écrit des milliers de pages, mais c’est devenue femme qu’elle publie, à l’époque victorienne d’ailleurs, son chef-d’œuvre, Le Chêne. En accordant le succès littéraire à la femme qu’Orlando est devenue, Virginia Woolf sème le trouble dans les récits d’hermaphrodisme qui, depuis le mythe, opèrent le plus souvent du féminin vers le masculin. Dans le mythe d’Hermaphrodite, Hermès, violé par la nymphe, est irrémédiablement altéré. Mais il n’a pas disparu, de même qu’il n’est pas devenu quelque chose d’absolument autre, qui serait issu du mélange des sexes. Son corps, certes, a subi l’incorporation du féminin, mais il lui a aussi résisté : l’altération subie par Hermaphrodite lui accorde de rester un être de discours, tandis que la voix de la nymphe a disparu. C’est ce mouvement, précisément, que Virginia Woolf inverse. Orlando publie son œuvre en étant devenue femme : la métamorphose ne l’a pas fait taire.
En revanche, dans la manière dont Orlanda rejoue la métamorphose, l’alternative est la suivante : être Orlanda et quitter un corps féminin qui est une prison ; être Aline et n’être créative qu’à avoir gardé la spontanéité, neutre, des enfants, qui savent jouer sans règles. Mais revenir à l’enfance, c’est retrouver quelque chose qui était déjà là. Le partage du masculin et du féminin dans Orlanda, comme celui de l’adulte et de l’enfant, renvoie à ce qui est disponible – peut-être perdu et objet de nostalgie, certes, mais jamais à l’horizon ou à venir. On est loin des « peut-être plus de deux mille » moi que chacun porte en lui (WOOLF, 1993 [1928], 304) et qui ne cessent de s’ajouter en se modifiant. D’une certaine manière, il semble que Jacqueline Harpman, auteure ou narratrice, ne parvienne pas ou ne veuille pas sortir du modèle de la connaissance de soi, de l’explication du caché, de la révélation du déjà-là. Elle ne veut pas penser ou ne parvient pas à penser que, dans l’histoire d’une vie peut se jouer, non la composition de choses déjà existantes, mais, effectivement, une métamorphose continue, dans laquelle il ne s’agit pas de composer le masculin et le féminin, l’adulte et l’enfant, mais d’être ce qui n’a pas de nom, sinon Orlando, et ne demande peut-être pas à en avoir.
Orlando, c’est précisément celle ou celui, ou ni l’un ni l’autre, qui fait tomber à plat toutes les déterminations, qui met en échec tout ce qu’on pourra en dire. Il n’est pas du genre homme, parce qu’il ne demeure pas homme mais se transforme, spontanément, en femme ; il n’est pas du genre femme, parce qu’il le devient ; il n’est pas exactement transgenre parce qu’il demeure aussi un homme en devenant une femme ; il n’est pas hermaphrodite, parce qu’il possède les deux sexes non pas simultanément mais successivement, et qu’il s’en moque. Orlando, surtout, n’est double ou altéré que vu de l’extérieur, c’est-à-dire pris dans les catégories instituées et disponibles pour déterminer les uns et les autres ; mais de l’intérieur, pour le dire ainsi, il demeure le même : une multitude bigarrée, une indétermination dynamique, tenue ensemble non par une forme, mais par le temps – et rien de plus. Virginia Woolf inscrit ainsi, dans Orlando, un (véritable) vitalisme :
la Nature, qui a commis tant de bizarreries (queer tricks) à notre égard, qui nous a fabriqués inégalement d’argile ou de diamant, d’arc-en-ciel ou de granit, avant d’en remplir une enveloppe, souvent incongrue au possible, donnant au poète une tête de boucher et au boucher celle d’un poète ; la Nature qui adore la pagaille et le mystère à tel point qu’aujourd’hui nous ne savons toujours pas pourquoi nous montons à l’étage ou pourquoi nous redescendons, que la plupart de nos gestes quotidiens sont pareils à la course d’un navire sur une mer inconnue, quand les marins, perchés en haut du mât avec leur longue-vue pointée sur l’horizon, demandent : est-ce la terre que nous voyons ou pas ? à quoi nous répondons « oui » si nous sommes prophètes, et « non » si nous sommes sincères ; la Nature qui doit répondre de tant de choses (et, en plus du reste, de la longueur sans doute excessive de cette phrase), a encore compliqué sa tâche et augmenté notre confusion en faisant de notre moi intérieur non seulement un vrai sac de guenilles hétéroclites et bariolées (disons un morceau de pantalon de pandore tout à côté du voile de mariage de la reine Alexandra), mais en se débrouillant pour que toutes ces hardes fussent vaguement reliées les unes aux autres par un fil unique (WOOLF, 1993 [1928], 79).
C’est dans cette débauche d’images, dont on ne sait où elles vont, que l’on peut dire qui nous sommes réellement, c’est-à-dire le mouvement ou l’instabilité que nous sommes. Pourquoi, cependant, parler de vitalisme et non, comme précédemment, d’historicité de l’identité ? Parce que celle qui inspire Orlando, dont Virginia se nourrit, que Virginia incorpore pour s’y mélanger, c’est Vita. Si Orlanda et Aline possèdent de la vigueur, Orlando n’est que vitalité. Alors que la vigueur renvoie à l’institution symbolique du masculin et à sa valorisation, et qu’elle désigne la force physique, la robustesse ou l’endurance comme autant de déterminations que quelqu’un pourrait posséder, la vitalité, quant à elle, appartient à un autre champ. La vitalité n’est pas une propriété : elle n’est pas quelque chose mais un ensemble de choses, « l’ensemble des caractères par lesquels se manifeste la vie2 ». Ensemble et non somme discrète, la vitalité n’est pas non plus quelque chose que l’on a, mais quelque chose qui se manifeste, quelque chose qui fait venir la vie au-dehors, à la surface. Ce qui possède de la vitalité, c’est ce qui se produit sans cesse comme différent de soi, se manifeste comme non-identique, en mouvement. Virginia Woolf décrit Orlando, en le suivant au fil de sa vie, comme celui ou celle dans lequel ou laquelle, sans qu’il y ait à le vouloir, il y a spontanément du jeu. Il ne s’agit pas d’inviter à quoi que ce soit, mais de voir ce qui se passe, et ce qui se montre, si on regarde.