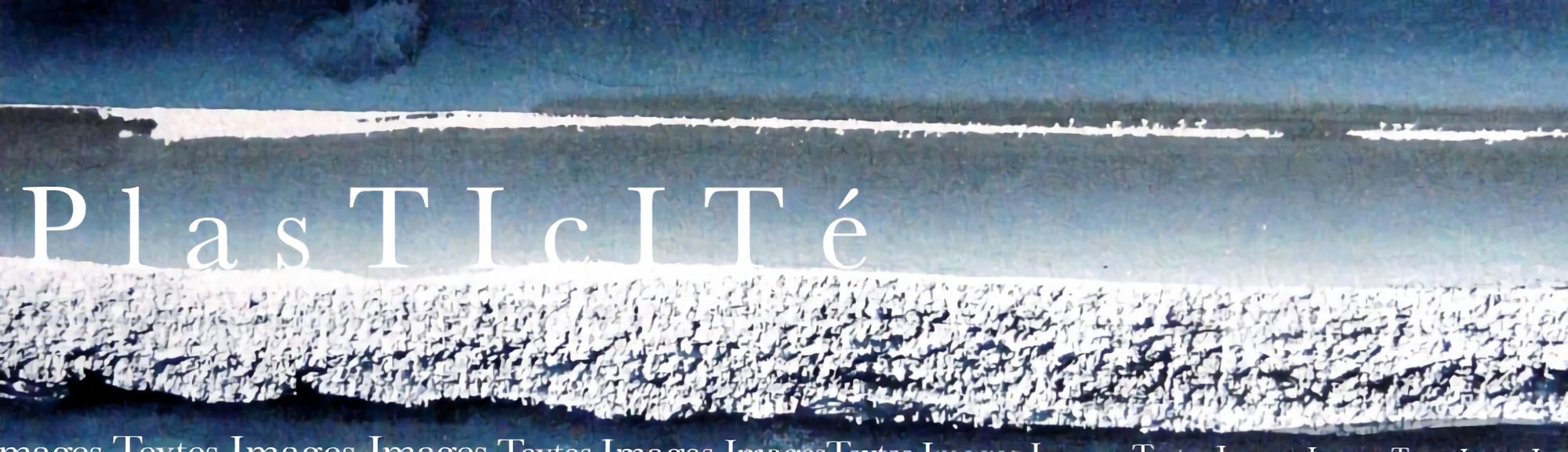L’implication du personnage au jeu de cartes pose un vrai problème : le je du personnage se modifie-t-il en fonction de sa propre vision au jeu, de son rapport aux autres joueurs, est-il en réalité un nous masqué ? Quand la part que le personnage consent au monde extérieur se résume uniquement dans la passion de jouer, il devient sans doute sous l’influence d’un désir monstrueux de supprimer toute mesure. Il perd le contrôle de soi : « J’ai une envie folle de me mettre en jeu » (V, 538), ainsi déclare le Narrateur. Quand il ne trouve pas des ressources de jeu, il fume la pipe. Il joue même aux choses les moins ordinaires : raconter des petites histoires « en gazant toujours » (V, 582). Quant à l’Artiste, il se précipite vers le jeu comme ces femmes qui « se jettent du haut des ponts dans des rivières » (V, 626). En trichant, il cherche à s’assurer d’un gain pour corriger le hasard. De là l’importance de cette vision du monde des deux amis de route – le Narrateur et l’Artiste – où tout se joue « en pleine vitesse » (V, 490) de la nuit sur la route au début, à la grande battue de la fin. À l’origine du jeu, la volonté d’être « quelqu’un » et un vide angoissant : « Le silence et le blanc font un tel vide qu’on a envie de mettre du rouge et des cris dans tout ça avec n’importe quoi » (V, 538).
Le désir de gagner à tort
Le plaisir est dans les fausses cartes. L’Artiste est passionné du « qui perd gagne ». S’il risque de perdre plus que l’argent, il aura des chances d’atteindre un divertissement royal : en trichant, l’Artiste joue sa peau et son sang ; il se joue lui-même tout entier dans son jeu.
Je me dis qu’il a trouvé mieux que le jeu : il triche. Il n’a jamais de sécurité. Ses gains sont toujours contestables. Il risque constamment sa mise et sa peau ; et la mise ne compte pas puisqu’il triche, qu’il en dispose à son gré, la donne à Pierre ou à Paul pour préparer le gros coup (V, 546).
Pour échapper à la conscience douloureuse, « tous les moyens sont bons » (V, 549) y compris de tricher ou de tromper son ami. Cette insatisfaction d’ordre existentiel, Giono l’impute au caractère particulier du héros moderne : la démesure. Sous le regard du Narrateur, l’Artiste transgresse les limites qu’impose la logique des incompatibles.
Il coupe. Je donne. Il a les quatre as. Je les fourre séparément dans le jeu. Il coupe. Je donne. Il a encore les quatre as. Je les planque au hasard, sans qu’il regarde. Je coupe. Il donne. Il a encore les quatre as. Je crois que si je les mettais dans ma poche, après la coupe et la donne de n’importe qui, il les aurait encore dans son jeu. Même chose pareille pour roi, dame, valet. Même chose pareille pour me refiler des broutilles et me composer des jeux impossibles, mais toujours probables (voilà surtout ce qui m’épate) (V, 524).
Il ne s’agit pas ici seulement de transgresser les règles de jeu mais aussi d’indiquer le chemin de la vie comme jeu presque identique au jeu de cartes. L’homme est capable dans son jeu propre de tricher et de mentir, c’est-à-dire de recréer sa vie par le détournement. La vie en ce sens semble être une table de jeu. Comme le Narrateur, il ne s’agit pas d’étonner ou d’éblouir, mais de tromper et plus encore, de provoquer pour se sentir supérieur.
Si le jeu est l’une des formes de protestation du sujet face au monde – le « besoin physique d’être quelqu’un » (V, 549) – le jeu des cartes dans Les Grands Chemins représente ce que Kierkegaard appelle « le désir d’avoir tort » ([1843] 1993, 649). L’Artiste a choisi le remède dans la transgression de la règle et la passion inconditionnée que véhicule l’idée de vivre sans plafond. Il a compris que le besoin de tricher est l’arme nécessaire pour lutter contre l’ennui. Il n’est pas le seul à vivre de cette façon ; tout le monde se donne beau jeu contre l’ennui :
Si tu attends d’un cœur simple que le rideau se lève sur les trois coups, que la bise frappe constamment contre les murs, c’est : « Un jour de bonheur, cent ans de misère » qu’on va te jouer d’année en année, sans changer de répertoire, et tous les enfants d’ici naîtront entre la fin juillet et le début d’octobre. C’est trop régulier pour que ce ne soit pas une combine, tu comprends bien. La malice est cousue de fil blanc (V, 541-42).
L’Artiste et le Narrateur ont besoin d’être heureux, mais il leur faut satisfaire leur irrésistible désir de « miser gros », car « c’est la vie » (V, 541). Au prix de la triche, ils parviennent à atteindre leur objectif. Le Narrateur se divertit avec les mots comme l’Artiste avec les cartes. Poker et conversation sont de même nature (LAIZÉ, 1998, 105). Cette parenté entre le jeu de cartes et un rapport humain – la parole – répond à quelques règles : la méfiance et le divertissement.
Ayant découvert le « peu de chose qu’on est » (V, 585), le Narrateur se projette hors de l’instant et rêve de « Pérou à tout bout de champ » (V, 467). La conscience de soi a fait naître un individu, l’a détaché du monde, car « le bonheur est un travail solitaire » (V, 501). Le sentiment du manque est remplacé par le désir de vivre enfin loin des compromis. Voilà qui est un peu court pour qui est réellement hanté par l’angoisse de n’être que soi et dont l’orgueil a percé à jour ces « mille petites combines » (V, 538) de la « vie courante » (V, 541). Le Narrateur désabusé par ses grands sentiments qui lui donnent bonne conscience, est devenu un « demi-savant » : « C’est au fond son cinéma » (V, 578). Quant à l’Artiste, il semble aller plus loin. Il cherche autre chose que d’être « comme tout le monde » (V, 613), que d’être « sage comme une image » (V, 612). Son initié – le Narrateur – « fonctionne » (V, 552) toujours en croyant « qu’il n’y a jamais nulle part aucune porte de fermée » (V, 552). C’est son plaisir d’aller « vers tout ce qui [lui] manque » (V, 626). Mais c’est l’Artiste, lui seul, qui peut être « quelqu’un en plein » (V, 546), parce que lui seul peut « bave[r] » (V, 490) de jouissance à la perspective d’être tué.
Non seulement tricher sans avoir jamais de sécurité, se risquer à montrer qu’on triche, « jouer avec le feu » (V, 615) et se donner le plaisir « bougrement rupin » (V, 614) de perdre, de « jouer sans plafond » (V, 614), mais bien davantage celui de se perdre et de s’en libérer, ce qui est proprement une extase : « après tout, il a bien profité de la vie » (V, 627). Le thème de la route rejoint donc tout naturellement celui de jeu.
Mais pourquoi désirer la perte de conscience de soi ? La conscience de soi peut devenir une haine de soi et un désir des demi-mesures. Si les deux amis vivaient au jour le jour et souffraient sans en comprendre la cause profonde, leur jeu, très narcissique au fond, requerrait à la fois expérience et imagination. Vivre un présent heureux, car curieusement plaisir et bonheur sont confondus, demande donc de vivre, dans l’instant et la durée, l’hésitation entre l’hypocrisie et l’élévation. Dans Les Grands Chemins, le jeu de cartes est aux mains d’un tricheur qui n’est pas sans réjouir le romancier. Tricher l’oblige à miser sur l’essentiel. L’Artiste triche comme il respire, mais dès qu’il ne peut plus tricher, il ne lui reste plus qu’à mourir. Giono donne des dimensions exceptionnelles au personnage « possédé » par sa passion. Ce mode d’attachement est moins déséquilibré que démesuré.
L’Artiste et le Narrateur vivent sur le même mode du divertissement : le premier triche d’une manière de plus en plus claire, lorsque l’usage de ses mains lui fait défaut, et il ira jusqu’au crime qui est un prélude à sa propre mort ; le second s’oublie de plus en plus dans une générosité sans limites, jusqu’au meurtre de celui qu’il aime.
Dans Les Grands Chemins, il n’y a pas de distance des paroles aux actes, tout est parole, c’est-à-dire mystère, opacité et souvent mensonge (GARDES-TAMINE, 1990, 20). L’Artiste, joueur de cartes et de sa vie, est un tricheur devenu symbole de sincérité. Car l’inversion paraît maintenant acquise : le mensonge de l’Artiste bon ne résidait pas dans l’intention de tromper son ami, mais dans la bonté même ; morale suspecte dont le Narrateur se découvre prisonnier ou du moins complice. Quand apparaît le mensonge brutal sur les qualités généreusement attribuées à l’Artiste, la description lucide qui suit établit non seulement une rupture avec la réalité, mais surtout le regret insupportable d’un « salaud » :
Je sens très nettement que le fameux copain dont je parle est en réalité le plus beau salaud que la terre ait jamais porté : la vache finie, voleur, menteur, égoïste, la saloperie incarnée, capable de tromper père et mère, de se vautrer dans la merde avec la joie d’une truie. J’en rajoute tant que je peux. J’ai beau en rajouter, il me manque (V, 504).
La mise en scène des personnages menteurs, manipulateurs, tricheurs, témoigne d’une « conscience ironique et décalée de leur présence au monde » (RANNAUD, 2002, 114). Cette présence est pour le moins faible et désorientée. L’appétit de dominer son semblable est le thème qui fait rebondir le mensonge. Si la volonté du personnage est de compenser l’ennui et la faiblesse marquant son existence, le mensonge apparaîtra comme complément servant à substituer le paraître à l’être :
Il ment. Il s’en tient fermement à son mensonge. Il embellit son mensonge. Je m’y connais et j’en bave. Il ment franc, si on peut dire. Je sais qu’il ment, il ne s’en cache pas et je sais qu’ayant écouté ce mensonge, je ne saurai jamais la vérité. Même si un autre me le dit, même si cent autres me la disent. Même si j’ai des preuves. J’ai trop d’intérêt à croire ce qu’il dit. Et qui est si bien arrangé (V, 510-11).
La comédie du mensonge appelle à « faire semblant », à tricher. L’Artiste corrige le hasard en trichant. Tricher c’est faire « une combine » (V, 607). C’est comme si quelqu’un faisait les routes « en sens inverse » et qu’il « rentr[ait] au bercail » (V, 508). C’est la loi du plus intelligent imposée au plus naïf. Le menteur semble être assez intelligent, courageux et égoïste pour s’imposer, mais en réalité il est saisi de peur. Ainsi il craint la perte du jeu, les gendarmes, le vide. Il sera piégé par son désir insatiable de gagner à tout moment. Ceci marquera un mouvement d’aller et de retour entre la pulsion vitale du Narrateur – comme le tonneau sans fond des Danaïdes, plus on le remplit, plus il se vide – et la pulsion de tricher de l’Artiste. Tous deux ont tendance à battre des atouts mais de façon désintéressée. Ni l’un, ni l’autre ne satisfait son désir.
L’identité fuyante
Le paradoxe de la condition humaine où se développe la liberté dans la dissimulation est bien plus clair dans Les Grands Chemins. Aux parties de cartes s’apparentent des occupations pourvoyeuses d’émotions fortes, qui mènent sur des grands chemins intérieurs : ce sont la vitesse et la jouissance. La vitesse fait partie des jeux de divertissement en ceci qu’elle ajoute à la sensation physique le plaisir de jouer contre la mort. La « buveuse de vent » – Mme Albert – en est fière :
On n’a pas vu un seul indigène, à part le vent. Nous voyons passer une bagnole grand sport, entièrement décapotée. C’est une poule minuscule qui conduit, seule, le menton haut comme les gens qui font profession de manger du vent (V, 595).
Elle prend la route en pleine vitesse pour découvrir une épaisseur de vie. Un mécanisme de jeu s’y installe. Tout cela est très profond chez Giono : la quête de plaisirs simples est motivée par la peur primaire du manque et par l’idée pascalienne de la fragilité humaine, de la vie malicieuse de l’homme et de « l’angoisse baroque » (BONHOMME, 2003, 265) qui instaure la fuite vers l’avant.
Même le récit est en fuite : le Narrateur ne nous donne que les informations qu’il choisit ou celles qui l’arrangent. Mais qui est ce personnage-narrateur ? Il est peut-être l’image du romancier dans son attitude de toute-puissance habituelle. C’est l’hypothèse d’Henri Godard :
Ce n’est pas sans intention que Giono multiplie dans ses romans personnages ou silhouettes qui, soit par le nom dont il les désigne, soit par leur activité ne peuvent qu’apparaître comme autant de figures du romancier, plus ou moins humoristiques selon les cas. Il n’affectionne pas par hasard ce nom d’« artiste » qui, dans une langue familière ou populaire se donne volontiers, avec tantôt la sympathie, tantôt plus de moquerie ou même d’ironie, à quelqu’un qui s’est distingué, dans quelque domaine que ce soit. (GODARD, 1995, 169)
Quant à l’Artiste, il est sûr de lui-même, moqueur et narcissique. Ce sentiment de supériorité le rend paradoxalement fragile parce qu’il ne peut pas se séparer du Narrateur : « Il est collé à moi comme un pou. Il donnerait maintenant la terre entière pour que je reste son parapluie » (V, 507). Son savoir-faire est en apparence technique : « Il peut faire filer la bonne carte dans des endroits où personne ne la chercherait » (V, 612), mais il est essentiellement métaphysique : pour être, il faut savoir aller jusqu’au bout et détourner les choses de leurs règles ; il faut savoir « se servir de soi comme on ne doit pas » (V, 541). Il apprend au Narrateur à placer ses filets plus haut.
Pour échapper à l’ennui, les stratégies des personnages – le Narrateur et l’Artiste – sont différentes, mais il s’agit d’un seul et même souci : « Il faudrait donc jouir de quoi, somme toute ? » (V, 539). Alors, c’est dans la façon de vivre en « oblique » et dans le « jeu » que l’on trouvera son compte.
Il n’est plus nécessaire de rester fermement debout ; je vis très bien en oblique. Nous nous prenons gravement au cœur. C’est le moment où le jeu en vaut la chandelle. Rien de plus épatant que de marcher avec la vitesse acquise, en se foutant du tiers comme du quart. On est quelqu’un (V, 506).
Dès lors, la vie en société s’apparente au jeu de cartes : hypocrisie et tricherie y sont nécessaires. La vie est une tricherie permanente, une partie de poker. L’objectif de l’existence est « de faire passer que deux et deux font cinq » ; « on a tous les chiffres à fausser » et cela à la seule fin d’avoir une identité biaisée ou plutôt de ne pas l’avoir du tout. L’identité « sans un trou » – rester soi-même – est la partie perdue. Qu’est-ce donc au juste qu’être soi ? Le portrait d’un « copain magnifique, affectueux et fidèle, et tout » (V, 504) marque une projection idéalisée d’un Narrateur qui attribue généreusement toutes les bonnes qualités à l’Artiste. Mais où les trouve-t-il sinon en lui, le menteur qui fait un aveu incomplet de transformer le je en nous ? Le mouvement de jeu se partage entre l’élan enthousiaste et le recul sceptique, impliquant aussi bien l’élan constamment renouvelé vers l’infini individuel ou collectif.
L’omniprésence du présent provoque la confusion entre les voix. Le Narrateur manipule des échantillons de parole qui ne lui appartiennent que partiellement. L’initiative de l’échange revient le plus souvent au Narrateur : c’est de son point de vue que les choses, les gens sont aperçus. Mais quelquefois, l’initiative revient au personnage rencontré (VICTOR, 1990, 27). Ces ambivalences donnent lieu à des jeux d’alternance, de mise à distance. Le discours indirect libre passe au premier plan et semble appartenir au même niveau textuel que le monologue du Narrateur, dont la cohérence est menacée par cette proximité d’autres paroles. Le problème ne serait pas seulement d’ordre linguistique : il montre que la parole au présent est menacée par la dépossession des mots et l’éclatement du je. La parole est devenue un moyen de division et de mensonge, et non plus de communication et de vérité. Elle est désacralisée et ne renvoie plus à l’ordre de jeu : « Tout le monde parle à la fois » (V, 507).
Quant à l’aspect extérieur du personnage, il est à l’image de cette parole confuse. En effet, la laideur de l’Artiste et ses regards peu avenants suscitent naturellement le dégoût : « Il a un vilain regard » (V, 484), « Son regard est mauvais plus que méchant » (V, 606), « répugnant » (V, 589), « désagréable » (V, 485). C’est pourtant cette laideur et l’aversion qu’elle fait naître qui semblent en partie retenir le Narrateur, par exemple lors de la rencontre : « Son regard a été d’un seul coup tellement désagréable que j’ai envie de le revoir » (V, 485). Il « a la gueule de bois » (V, 487). Le Narrateur apprécie la laideur de son ami. De même, la salive qui apparaît aux coins des lèvres de l’Artiste lorsqu’il jouit de son habileté aux cartes, et dont on attendrait qu’elle provoque le dégoût, engendre une réaction inattendue chez le Narrateur. S’il utilise au départ le seul terme de salive et se limite de façon neutre à constater sa présence, ce sont des expressions métaphoriques qui introduisent le terme par la suite : « une petite pâquerette de salive » (V, 546), « Il mâche tout un bouquet de salive » (V, 550).
Mais cette laideur est un atout pour gagner le jeu : c’est du matériel comme les cartes. L’Artiste s’en sert dans ses combines. C’est en jouant qu’on arrive à échapper au chaos négatif et qu’on retrouve l’autre non pas comme ennemi mais plutôt comme l’être avec qui on partage une partie de soi. Cette fascination pour l’autre, tout en gardant la haine – symbole du paradoxe des rapports humains – est bien illustrée dans le roman. Le Narrateur semble aimer voir le plaisir solitaire de celui qui le fascine : « Sa joie égoïste me fait plaisir », dit-il (V, 591), alors que la solitude de cet homme des grands chemins peut expliquer le fait qu’il désire poursuivre la route avec l’Artiste. « Sais-tu où je suis ? À ce que le toc me suffit amplement. J’achète du toc » (V, 505), s’est immédiatement dit le Narrateur en présence de l’Artiste. C’est une revendication de l’amitié, de traverser les chemins avec « l’ami-ennemi » (GODARD, 1995, 109). Ils seront des amis inséparables : « Nous nous remettons en route, sans avancer d’un pas : côte à côte, ennemis intimes et d’autant plus inséparables » (V, 591).
En l’Artiste, le narrateur admire son côté naturel : « C’était son regard naturel » (V, 485). On sait que les termes « nature » et « naturel » s’augmentent chez Giono, vers 1950 et à la suite de sa lecture de Hobbes et Machiavel, du sens de méchanceté intrinsèque, puisque, comme il le note dans le carnet 7 mai 1949 : « l’homme est naturellement mauvais » (V, 1193). En montrant un visage naturel, l’Artiste indique qu’il ne s’en laisse pas accroire sur la bonté humaine, alors que le Narrateur met encore toute sa foi en l’Homme. Aussi, il ne montre aucun intérêt aux relations humaines, ni le besoin de s’adapter au monde environnant.
L’errance : un jeu de trompe-l’œil
L’appréhension de l’image de l’errant à travers un style « behavioriste » est une technique visant l’aspect extérieur du personnage (GARDES-TAMINE, 1990, 20). Ce qu’il dit et fait est intimement lié à sa façon de se retirer calmement de ce monde. S’il faut lire ces images, il faut toujours rester attentif aux effets d’ambiguïté et aux jeux de trompe-l’œil, et se méfier de leurs indices explicatifs à caractère référentiel qui peuvent se révéler autant de fausses pistes. Comme thème central chez Giono, l’errance est inséparable de la partie de poker à l’auberge, de la tricherie et de la bagarre. L’auberge et la dame de l’auberge constituent d’ailleurs le contrepoint féminin et sédentaire de ces éléments masculins : le grand chemin, le jeu de cartes, le vagabond (LAIZÉ, 1998, 77).
Giono adore les errants : on ne s’étonne pas d’ignorer presque toujours d’où ils sortent et souvent où ils vont (RICATTE, 1982, 292). Le Narrateur était en face de l’aventure et du désordre. Quelle est dans ce contexte, la valeur du désordre ? Il s’agit pour Giono de mettre en tension les forces de l’ordre et du désordre à travers des personnages opposés, des contextes où s’expriment des comportements exagérés, des points de vue opposés. Giono envisage certains éléments concrets qui seraient susceptibles d’entrer dans son roman en les énumérant sans ordre apparent et sans les commenter. Il fait suivre ces esquisses d’une méditation qui tourne autour de trois thèmes essentiels :
L’homme est un voyageur. Il y a d’abord dans son âme le besoin du nomade qui fait de lui un errant et un déraciné, le chasse sur les routes. L’homme est encore un amoureux. Il y a chez lui le désir qui possède son cœur de se rapprocher d’un autre cœur, de trouver sa sœur ou son frère, ce tourment de tendresse qui fait de lui un amant. Enfin, il y a encore chez les plus nobles d’entre nous le besoin de pureté et de perfection intérieure, cette soif inextinguible de sa propre beauté morale qui font de l’homme un ascète et finalement un saint (Journal, février 1939, Cf., V, 1142).
Ce voyageur romanesque montre également bien que l’intention de Giono ne s’est jamais démentie : célébrer les chemins particuliers de la terre comme les plus sûrs garants de la liberté et de la disponibilité, et les lier fortement aux chemins intérieurs de l’homme. Le plaisir de l’errance lui donne une totale liberté qui le conduit ainsi à l’aventure. Pour le Narrateur, la joie et le plaisir surgissent au détour d’une route. Pourtant, cette notion de plaisir est loin d’être anodine, malgré la simplicité des joies que le voyage réserve au Narrateur. Dès l’ouverture du récit, l’ambiguïté du plaisir apparaît, jetant une ombre suspecte sur l’allégresse de ce commencement : le routier qui prend à son bord le Narrateur se demande si celui-ci se balade pour son plaisir. Le plaisir et la liberté que les deux amis supposent sont sans commune mesure avec la vie normale. Et c’est pour cela qu’à travers cette perspective se manifestent les tendances qui changent l’élan picaresque en tragédie.
La rencontre essentielle du Narrateur et de l’Artiste est une aventure unique qui va orienter tout le reste. Mais désormais la liberté des grandes routes ne serait plus possible pour le Narrateur. Dès lors, l’amitié qu’a rencontrée le Narrateur au hasard des chemins transforme et déforme ce qui aurait pu n’être qu’un roman et qui devient beaucoup plus proche par sa structure de la tragédie classique. De plus, la pause ultime, celle qui précède l’acte meurtrier (le regard de l’Artiste fixé sur son ami) n’est pas la répétition d’une autre. Ce regard prend place à l’intérieur d’un mouvement qui précède le meurtre, où le Narrateur chemine, encore et toujours, dans un état quasi symbolique. De fait, le Narrateur ne dit pas grand-chose de l’acte final, si ce n’est le commentaire qui suit : « C’est beau l’amitié » (V, 633). L’exécution est présentée comme un remède radical, non pas à son propre ennui, mais au sentiment de manque qui hante l’Artiste. Cette conclusion qui va dans le sens de l’œuvre romanesque, semble souvent s’intégrer dans une vocation d’anéantissement. Aussi, l’unité d’action quasi classique du roman de 1950 utilise donc les « grands chemins » qui mènent inexorablement à ce dénouement tragique et étonnant dans une conception aussi bien métaphysique que réaliste. Le récit apparaît beaucoup plus moral que picaresque par bien des aspects, et tout d’abord par le parti pris de généralité et d’anonymat que l’on découvre ici plus qu’ailleurs.
L’homme des grands chemins n’est-il pas l’homme en quête de divertissement ? Il est d’abord l’homme qui ne se contente du tout venant, il ne parcourt pas les routes pour gagner son pain. Tout au moins, est-ce là une motivation très secondaire. Il cherche une réponse à sa curiosité naturelle, peut-être même un débouché vers un bonheur possible ou impossible. Le jeu de cartes semble être un geste d’amitié indéfectible qui permet l’identification de l’Artiste au Narrateur : les grands chemins qui s’ouvrent à eux sont alors ceux de l’amitié, de l’errance et de l’amour du risque. Ce sont là des conditions de vagabond volontaire. Les deux amis vivent à la même hauteur : ils poursuivent un désir irrésistible de jouissances immédiates en collectionnant les expériences de la route et les présents multiples.
Le jeu des temps
Le temps présent réalise l’alliance de la totalité et de la succession. Dès la première rencontre du Narrateur et de l’Artiste, nous sommes à l’intérieur de ce temps narratif, englobés par lui, mais en même temps il fait sentir vivement sa succession d’instant en instant ; chacun de ces instants pointe et bascule, d’où cette « étrange impression de fracture narrative incessante » (RICATTE, 1977, 161).
Pour rendre compte des catégories du discours et du récit, Harald Weinrich répartit le temps selon l’axe du monde commenté (discours) et celui du monde raconté (récit). Le monde commenté se caractérise par le commentaire et l’engagement du locuteur ([1964], 1973, 102). Les descriptions sont de l’ordre du commenter, tandis que les récits d’action sont de l’ordre du raconter. Or la parole du Narrateur commente constamment les faits dans des notations brèves : « Dehors, c’est entre chien et loup, mais ça me paraît le paradis terrestre » (V, 562). Les faits sont aussi commentés dans des développements plus longs comme par exemple pendant le repas servi chez Ferréol où la réflexion sur la nécessité de bien manger pour « faire du sang », ce que le Narrateur appelle « ruminer », s’étend sur deux paragraphes. L’Artiste et le Narrateur appartiennent à une errance prolongée et personne d’entre eux ne fait référence à son propre passé. De plus, les prédictions du Narrateur et aussi les prémonitions de l’Artiste à propos du devenir structurent un univers inquiétant, l’encore-un-peu d’un temps déjà irrégulier. Tension entre le passé et le futur : le présent est par là envisageable de manière intensive. Il est entre le marteau des possibilités et l’enclume des attentes. Le présent est exposé à recevoir des coups des deux côtés. Le Narrateur ne cesse de nous persuader qu’il accumule les expériences au jour le jour, sans rien prévoir. Si c’est vrai, la construction de son récit sera linéaire, sans effets de composition qui supposeraient une préméditation. En effet, son discours pourra dans un premier temps nous apparaître linéaire par l’emploi d’un temps dominant, le présent de l’indicatif. Pourtant, nous relierons les épisodes entre eux et ce présent trop évident dans sa répétition même attirera notre attention sur des ruptures dans la durée. Le présent ponctuel est le plus fréquent, celui qui « occupe » le présent du narrateur au moment où il raconte : « Je cherche une auberge […], j’en trouve une […]. Je bois un verre de vin […]. J’arrête la serveuse » (V, 491). Cependant le présent ponctuel alterne sans préavis avec d’autres emplois qui brisent la régularité de la succession en la ralentissant ou en l’accélérant. Le présent duratif l’accélère : « Nous perdons ainsi un bon bout de temps » (V, 555) ; « Je liquide la situation en vingt-quatre heures » (V, 633). Le présent de la répétition la ralentit – comme dans « Cent mille théâtres (on sort de l’un pour entrer dans l’autre) sur lesquels à chaque instant nous faisons notre petit numéro » (V, 553) – et surtout la répétition visionnaire des derniers instants qui durent presque toute la nuit : « Nous tournons sans arrêt… » (V, 632).
L’absence du passé simple ne permet pas de détacher d’une liste d’événements les paroles de vérité générale du narrateur. Le présent de vérité générale est noyé dans le présent ponctuel ; c’est un présent invisible. Ainsi à la fin du roman : « Je lui lâche mes deux coups de fusil » (présent ponctuel), « C’est beau l’amitié » (vérité générale), « Je descends à pied » (ponctuel), « le soleil n’est jamais si beau… » (vérité générale). Le passé composé abolit très vite le passé proche pour rattraper le temps présent : « Je ne suis pas plus tôt sorti que mon éléphant à béret me prend par le bras » (V, 502). Le cas extrême du passé composé est dans la traque finale : l’Artiste « s’est jeté [équivalent d’un passé simple ponctuel] dans la pente du ravin […]. S’il faisait jour [irréel du présent] […], je parie que j’aurais vu ses traces [irréel du passé]. Il a dû se laisser rouler comme un sanglier devant les chiens. Et il a atterri sur le chemin où je suis » (V, 627). C’est la fin d’un retour en arrière qui était plutôt une reconstitution, une résurrection du passé : le Narrateur voit vraiment l’Artiste devant lui, alors qu’il est déjà plus loin. Le futur tend à son tour à se faire absorber par le présent qui peut l’annexer quand il est assez proche : « Nous partons samedi à trois heures de l’après-midi » (V, 586). Giono préfère très souvent le futur proche au futur simple, d’où une profusion de périphrases « je vais » ou « je dois » + infinitif, et « il faut » + infinitif ou « il faut que ».
Le futur n’est plus alors qu’un présent sur le point de naître : « Attends-moi, je vais verser de l’eau » (V, 493) ; « Je m’apprête à remonter et, auparavant, il me faut trouver la route… » (V, 524). Le futur proche est le temps de la fuite : « J’imaginerais que c’est fini. Mais il y a mieux, paraît-il. Il est dit que nous devons maintenant aller manger chez Ferréol » (V, 546). Quand c’est le futur simple qui est choisi, il n’en ressort que mieux ; dans une forte majorité de cas, il exprime le thème du désir, voire de l’angoisse : « Tu m’achèteras une guitare » (V, 600), « J’oublierai », « Est-ce que le jour finira par se lever aujourd’hui ? » (V, 573). Il s’agit pour Giono de faire dominer le présent, ou ce qui revient au même, le passé composé, et de gommer tout temps concurrent, surtout le futur qui n’a pas de place dans une chronique au présent. La présence massive du présent sous toutes ses formes produit un effet d’effacement de divers niveaux : discours et récit, et dans le récit même, gommage des niveaux chronologiques. La conscience du personnage et du lecteur est engluée dans une perception myope du temps : présent ponctuel, passé proche, futur proche et, du coup, angoisse et désir. Les temps du récit sont la mise en relief d’une réalité désespérante à l’image de ce paysage de neige désespérant qui efface le relief. Mais le présent est un temps subjectif et contradictoire, le temps de la domination, de jeu et de la tricherie. Le temps subjectif, c’est le temps du Narrateur, celui de l’Artiste étant objectif. L’emploi conjoint du présent et de la première personne est l’indice d’un « discours immédiat » produisant dans un récit l’illusion d’une simultanéité entre les événements vécus et leur transcription (GENETTE, 1972, 192). Le présent des Grands Chemins est à vivre en direct comme un spectacle de jeu. Le Narrateur n’a pas le temps, dans le moment où il vit, d’ouvrir une parenthèse pour expliquer un détail de son passé : les actions suivantes surviennent trop vite, le passé composé devient trop vite du présent, et le présent du futur proche. Le Narrateur assume son reportage et n’a que le temps de conter le présent. L’ancrage temporel suggéré par le présent est un piège. Le moment des « grands chemins » est pur flottement.
L’homme est toujours à la recherche des bons moments d’existence qui se résument en un seul mot : le plaisir. Le narrateur des Grands Chemins est un homme qui sait profiter de tous les plaisirs de la vie, y compris les femmes, mais avec détachement. Mais le « mais après ? » (V, 538) taraude l’instant du plaisir. Dès lors, le présent est le seul mode de vie puisque vivre, c’est simplement passer son temps :
Quand on est bel et bien en présence du problème qui consiste à ce qu’on appelle vivre qui est simplement en définitive passer son temps, on s’aperçoit vite qu’on n’arrive pas à le passer sans détourner les choses de leur sens (V, 540).
La rapidité du temps incarne une sorte de révolte contre la mémoire du passé au nom d’un avenir promis. C’est de ce point de vue que le moment nocturne cristallise les puissances néfastes qui menacent l’être humain, devenant ainsi une sorte d’archétype pour la conscience narrative, sous la forme d’une allégorie de l’homme errant. Le talent du Narrateur consiste à maintenir dans ses descriptions une cohérence totale en même temps qu’à nous persuader de leur vérité. C’est dire qu’il donne l’illusion réaliste :
L’automne continue aujourd’hui à être pour moi un bon copain. Je cherche en vain sur la montagne d’en face les traces du hameau dont je voyais hier soir les lumières. Tout est recouvert de forêts de hêtres. Vu d’ici, le monde est en cuivre du haut en bas. Je vois à travers mes propres arbres un petit bout de ciel très bleu. Qu’est-ce qu’il faut de plus ? (V, 484).
Les « bons moments » laissent ainsi la place, bien souvent, aux « moments critiques » où la conscience subjective est renversée par la jouissance de la chute et le plaisir d’aller vers n’importe quoi : « Je veux qu’un événement quelconque me donne un tour de vis dans n’importe quel sens » (V, 590). Ce serait le signe d’une gloire monstrueuse qui ne peut triompher qu’en défiant la mort : « Qu’on l’ait battu (et même plus), je sais qu’il s’en fout […]. Qu’on l’ait finalement jeté dans son sang, avec ses mains écrasées […], qu’on ait été obligé d’en arriver là, c’est sa victoire » (V, 613-14). L’attrait du risque, la fascination des enjeux forts, la passion de l’Artiste « d’aller tout le temps plein gaz » (V, 581) s’avèrent plus puissants, parce que « la sécurité ne réjouit pas. Ce qui compte, pour le bonheur, c’est de tout remettre en question » (V, 538). La nuit est le moment préféré de l’errant, ne serait-ce que pour y disparaître. La volonté de rétablir la continuité des temps du monde est liée particulièrement à un désir de retrouver dans l’action du personnage des indices qui laissent subsister l’espoir d’une transformation possible du cours des choses, mais elle implique aussi de se rappeler toujours la persistance d’un temps rapide, oppressif qui menace à tout moment l’espoir de quitter l’enfermement.
La comédie des mains
Jouer, c’est avant tout corriger le destin en forçant la main. Des mots tels que main-forte, mainmise, manipulation, manigances qui engagent la ruse ont la main pour origine. Mais ce défi lancé sans relâche au destin par l’Artiste a pour effet de placer le personnage face à lui-même, à sa condition naturelle. Au terme de ce dénudement de l’être, il retrouve sa condition première, faite de solitude et d’obligation. On joue, on triche, on force la main non seulement pour corriger le chemin / le destin d’une carte, mais aussi pour corriger une identité brisée. Si les cartes à jouer sont la mise en intrigue des mains, les mains de l’Artiste n’ont, de leur côté, pas plus d’épaisseur que des cartes à jouer. Ce sont des atouts énigmatiques et divertissants. L’Artiste donne l’impression d’un personnage « roul[é] » (V, 626) dans le destin de ses cartes en déployant « la roue » de ses mains, seule « rondeur » qui aide à vivre en définitive.
La main du joueur acquiert aux cartes une existence personnelle, une vie imaginaire analogue à celle que l’écrivain accorde à ses personnages (LABOURET, 2000, 99). En effet, les cartes à jouer deviennent de véritables personnages :
Il leur parle, il les appelle par leurs noms ; elles se dressent toutes seules hors du jeu, s’avancent, viennent, sautent. Il raconte des petites saloperies à la dame de cœur et la dame de cœur bondit jusqu’à sa bouche pleine de salive. Il dit que le roi de trèfle est jaloux ; et le voilà qui vient. En effet, il a l’air jaloux ; on dirait d’un coq. Puis il y a tout un imbroglio où se mêlent les rois, les dames, les valets. C’est une comédie à toute vitesse (V, 490).
Les cartes sont trop obéissantes à cette mystérieuse « main pleine de rois » (V, 569), qui symbolise à merveille l’autorité de l’Artiste sur les cartes et l’emprise sur ses partenaires de jeu. L’Artiste a fait ainsi main basse sur le hasard :
Alors, il se met à tripoter son paquet de cartes comme s’il tirait sur un accordéon. Il le frappe, il le pince, il le soufflette, il le caresse, il l’étire et le renferme. Il annonce : roi de pique, sept de carreau, trois de cœur, roi de trèfle, dame de cœur, neuf de pique, deux de carreau ; et chaque fois la carte annoncée tombe. Il jette le jeu de cartes dans le bassin de la fontaine et, quand il va y tomber, le jeu de cartes se regroupe dans sa main. Il me l’étale sous le nez en éventail, en fer à cheval, en roue, en flèche. Il fait couler les cartes de sa main droite à sa main gauche, en pluie, en gouttes, en cascades (V, 489-90).
Maître du jeu de cartes, donc du sort, l’Artiste devient capable de déjouer le sort. Le jeu devient aussi important que l’enjeu, car si l’Artiste joue, c’est moins pour acquérir des biens matériels que pour la beauté idéale du jeu. Là, il peut simuler, cacher, plier les cartes à sa volonté. Dominées par la force des mains, les cartes à leur tour, comme tout personnage gionien disposant de sa propre psychologie, retrouveront leur propre distraction. Le tricheur leur a apporté une nouvelle vie :
Il cherche la dame de carreau : elle est dans sa manche. Il parle du valet de pique : il sort de son soulier. Il répond à la dame de trèfle qui lui fait censément des confidences : en effet, elle est sur son oreille. D’autres font coucou de dessous sa chemise, de son col, de sa braguette, de sa ceinture ; montrent leur cœur, leur carreau, leur trèfle ou leur pique, rentrent, sortent, disparaissent, s’en vont on ne sait où. Je ne sais plus où donner de l’œil. Il claque des mains : elles sont toutes là en paquet dans sa paume (V, 490).
Si l’Artiste « vivait des cartes » (V, 624), c’est parce qu’il vivait de ses propres mains. C’est donc sa raison de vivre ; sa « raison raisonnante » (V, 568). Il est fier de ce qu’il fait : il gagne tout en perdant tout. Dans l’accomplissement du divertissement, sa main passe pour tellement maligne qu’elle coûte sa peau tout entière : l’Artiste s’est fait sérieusement tabasser par ses partenaires de jeu. Dès lors, cette satisfaction simple devient un bonheur borné, une paix apparente qui empêche le je de se fixer. L’Artiste joue « par force […] parce qu’il n’y a rien d’autre à faire » (V, 607). Le Narrateur se voit dans l’obligation de faire soigner son « frère », aussi emmène-t-il « ce zèbre en pièces détachées » (V, 577) dans un couvent de petites sœurs.
Malgré les soins des sœurs, les mains de l’Artiste, si essentielles pour lui, semblent être irrémédiablement brisées. Le Narrateur se montre attentionné : « Je me fais expliquer ce qu’il faut continuer à faire à ces mains » (V, 585), car les mains de l’Artiste sont sa seule ouverture sur le monde. Ses mains ne sont pas de simples instruments mais un tout vivant qui éprouve le monde selon la possibilité de jouer et de tricher. Il est tout entier ses mains. Incapable de jouer, après avoir brisé ses mains, l’Artiste quitte la vie. Ses mains le délestent de sa dernière attache au jeu, mais il laisse les cartes, seul moyen pour corriger le destin, se dissoudre dans la face à face avec le vide. Les cartes avaient en effet de la nostalgie pour le talon de leur maître qui se permet de tricher même « au ralenti » (V, 550). L’Artiste a réussi ce que les autres ont raté : il a fièrement joué son sang et son argent. Quand on veut, comme l’Artiste, « refaire le monde entier » par le simple matériel de cartes à jouer, « on s’aperçoit qu’en temps ordinaire on a à portée de la main de petits riens qui sont tout » (V, 538). Mais l’Artiste en temps normal était lui-même « un souffle, un rien » (V, 629). S’il joue, c’est « pour s’entretenir les mains » (V, 521). Il a le talent de composer « un imbroglio » (V, 490) où, sous les yeux du Narrateur, les cartes dansent et se mêlent : « C’est une comédie à toute vitesse » (V, 490).
Conclusion
La jouissance du Narrateur provient de l’errance du sens qu’il impose comme signification ultime, à l’image des cartes sans cesse en mouvement dans les mains des joueurs. Et c’est encore par le jeu, l’errance et la parole que le je devient nous, car le personnage a besoin naturellement de s’affirmer comme double. Le je solitaire est associé à ce nous de solidarité. Tandis que le nous visé par le Narrateur tend à être visible en racontant tout, le je de l’Artiste se dissimule dans le jeu, d’où cette volonté incessante de tromper les regards et de briser les règles de jeu. La parole permanente du Narrateur est le plus souvent extérieure, ce qui explique ce présent du récit inhabituel parce qu’il est un présent d’une voix unique qui nous soumet dans son dialogue continu. Le nous du Narrateur est un élément errant et vagabond : un désir d’une parole pure et spontanée en opposition avec la construction artificielle du jeu de cartes. Il représente pleinement l’élan picaresque, tandis que le je de l’Artiste est plutôt philosophe. Il déclare les paradoxes intérieurs de l’humanité et détruit les conventions. Cette vision a profondément touché le Narrateur : « Je sens qu’il m’a percé à jour et qu’il essaye de me faire comprendre quelque chose de très grave et de très important » (V, 609). Le Narrateur a compris que son nous spontané et parfois naïf doit rejoindre le je(u) rusé et trompeur de l’Artiste. L’identité ne serait donc accomplie que dans le fait de se doubler.