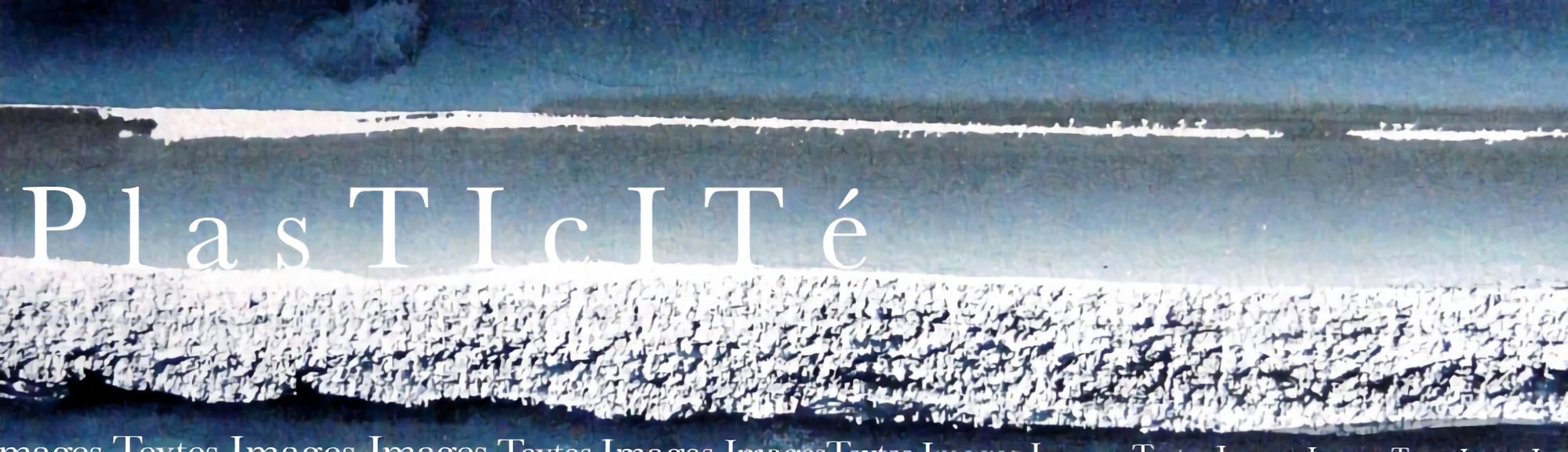Dans le cadre d’une réflexion sur le livre et ses lecteurs au cinéma, le film hollywoodien Pleasantville de Gary Ross, distribué en 1998, offre une perspective stimulante sur l’entremêlement des mondes fictionnels et les possibles ouverts par la lecture. Sans que son propos ne porte directement sur les livres, sa manière de les présenter à l’intérieur d’un monde fictionnel télévisuel enchâssé dans la fiction cinématographique constitue un excellent matériau pour penser la relation entre les univers parallèles et la lecture au cinéma. Dans cet article1, on se propose ainsi d’étudier le film à la lumière des théories de la lecture et de celles de la fiction et des mondes parallèles qu’elle peut élaborer. Cela permettra d’identifier certains éléments permettant de penser les liens entre cinéma et lecture, et de comprendre ce que le livre en tant que dispositif interroge au sein du film.
Pleasantville raconte l’histoire de deux adolescents américains des années 1990, les jumeaux David (Tobey Maguire) et Jennifer (Reese Witherspoon), aux intérêts très différents : David, plutôt réservé, se passionne pour la série télévisée Pleasantville, tandis que Jennifer est soucieuse d’entretenir sa popularité auprès de ses camarades de classe et d’obtenir des rendez-vous avec les garçons. Lors d’une dispute devant le téléviseur, ils se retrouvent plongés ensemble dans le monde de la série préférée de David. Cette série, en noir et blanc, se déroule dans l’Amérique des années 1950. Elle est rediffusée sur une chaîne destinée aux nostalgiques d’une époque révolue, louée pour ses « valeurs familiales » (family values) que le film oppose aux difficultés économiques, sociales et environnementales actuelles. Le monde de la série télé est présenté comme idéal, facile, gentil, sécuritaire, lisse et réconfortant ; il tourne autour de la famille Parker, composée des parents Betty (Joan Allen) et George (William H. Macy) et de leurs enfants, Bud et Mary Sue, rapidement remplacés par les jumeaux alors que ceux-ci sont projetés dans Pleasantville. Leur présence dans le monde fictionnel entraîne un nombre exponentiel de changements qui finissent par causer un désordre important dans ce monde parfaitement ordonné et limité. Progressivement, y apparaissent des émotions vivantes, mais aussi l’idée d’un ailleurs, d’un hors-Pleasantville, toutes perturbations qui se traduisent par l’apparition graduelle de la couleur dans ce monde de noir et blanc.
Pleasantville, un autre monde
Le travail chromatique fait tout l’intérêt du film, entièrement filmé en Technicolor, dont les couleurs saturées apparaissant dans le monde télévisuel contrastent à la fois avec le noir et blanc et avec les scènes ayant lieu dans le monde contemporain. Il a ensuite été retouché digitalement pour qu’apparaissent le noir et blanc, et non l’inverse, comme on aurait tendance à le penser, nécessitant deux éclairages différents pour chaque scène comportant du noir et blanc et de la couleur2. Le film exploite les possibilités subversives d’une perturbation de l’homogénéité chromatique, à l’inverse de films antérieurs qui distinguaient clairement deux réalités diégétiques par la couleur et le noir et blanc, comme c’est le cas, par exemple, dans The Purple Rose of Cairo (1985) de Woody Allen, où le monde réel est en couleur, tandis que le monde fantasmatique du personnage principal est en noir et blanc3. La couleur y est principalement associée aux émotions et au désir, mais elle marque aussi des temporalités et des spatialités différentes – le monde fictionnel de Pleasantville dans une Amérique fantasmée des années 1950 et celui d’une ville anonyme des États-Unis dans les années 1990 – et, ce qui est particulièrement intéressant, elle signe un entremêlement des mondes. Il ne s’agit pas d’une correspondance exacte entre la couleur et le réel et le noir et blanc et la fiction, mais la cooccurrence de la couleur et du noir et blanc suggère la coexistence des mondes, qui s’opère d’ailleurs avant même l’arrivée des jumeaux dans la série.
En effet, la présence de la télévision dans la sphère familiale introduit déjà une dissolution des frontières entre la réalité et les mondes fictionnels. Dans l’une des premières scènes du film, alors que David et Jennifer sont encore dans leur monde, la télévision insère la série dans la vie de l’adolescent. Tandis que sa mère discute au téléphone avec son père, dont elle est séparée, pour lui rappeler qu’il doit garder leurs enfants pendant le week-end, le personnage regarde un épisode de Pleasantville, dont le contenu forme un contrepoint à celui du film : on y voit une famille unie échangeant des propos bienveillants. L’alternance de plans télés, dans lesquels nous devenons téléspectateurs ; de plans subjectifs, dans lesquels nous sommes dans la peau du personnage téléspectateur ; de plans globaux, avec la mère au téléphone en arrière-plan ; et de plans du personnage téléspectateur, auxquels s’ajoutent des répliques anticipées par celui-ci, contribue à entremêler les deux mondes, tout en marquant la réalité du monde filmique et la fictionnalité du monde télévisuel. Il s’agit là d’un des effets de la scène de cinéma incluant un poste de télévision commentés par Mireille Raynal-Zougari dans son article « La télévision dans le film : décentrement de la fiction ». La télévision incarne ici la distance avec la réalité, elle circonscrit « le monde vivant spectacularisé et figé dans l’image, transformé en fiction4 ». D’ailleurs, le film joue sur l’artificialité du monde télévisuel de Pleasantville en mettant en scène l’incomplétude typique des mondes fictionnels décrite notamment par Thomas Pavel5, mais aussi celle, réelle, des tournages cinématographiques et de leurs décors conçus uniquement pour ce qui est visible à la caméra, et donc eux aussi incomplets. C’est ainsi le cas au départ pour le monde de Pleasantville, limité à ce qui peut être connu et vu du téléspectateur : les routes sont circulaires et ne quittent pas la ville, il n’existe pas de lits doubles, les toilettes publiques ne contiennent pas de cuvettes, le feu est inconnu, ainsi que la pluie, etc.
L’entrée des adolescents dans le monde fictionnel passe précisément par l’entremise de la télévision et d’une télécommande magique, fournie par un personnage liminaire, dans une scène qui associe les deux mondes en miroir6. Alors qu’ils se disputent pour contrôler la télécommande et la brisent, un réparateur de télévision (Don Knotts) semblant sorti d’une autre époque7 remplace la télécommande, laquelle les transporte tous deux « dans la télévision », selon un motif répandu de « saut métaleptique » au cinéma. Comme l’indique Jeff Thoss dans son article sur le sujet, « pop-cultural narratives have abundantly explored the possibility of fusing distinct realms by using one’s TV (or DVD, VCR, etc.) remote, to the point where the “metaleptic remote” has become a storytelling trope8. » Les deux personnages arrivent dans la série télévisée où les adolescents qu’ils remplacent se querellent cette fois au sujet d’un poste de radio. Finalement, l’entremêlement déjà suggéré des deux mondes est souligné lorsque, peu de temps après leur arrivée dans Pleasantville, David est salué par un « voisin » et qu’il affirme à sa sœur qu’il le connaît, comme s’il avait réellement partagé la vie des habitants de la série, ce que laissait prévoir les répliques anticipées lorsqu’il regarde un épisode au début du film et sa connaissance encyclopédique de la série – démontrée par des échanges avec son camarade de classe. Toutefois, dans le monde de Pleasantville, c’est le personnage de David qui est le plus soucieux du statut fictionnel des gens qui s’y trouvent et des particularités de leur vie, tandis que sa sœur, qui s’ennuie dans ce monde trop conservateur, n’hésite pas à les traiter sans plus d’égards que s’ils étaient réels, bouleversant ainsi rapidement l’ordre établi. Aussi lorsqu’elle doit sortir avec le prétendant de Marie Sue et s’apprête visiblement à ne pas suivre le scénario vertueux prévu par la série, à court d’arguments, son frère lui lance-t-il : « You can’t do this to someone who doesn’t exist9 ! »
Le film lie étroitement les livres et la lecture à l’intrication des mondes réel et fictionnel. D’abord parce que les livres qui apparaissent dans Pleasantville (des fictions qui existent dans la réalité) présentent avant toute chose une ouverture sur l’ailleurs et l’évocation d’autres mondes possibles. Les livres de Pleasantville sont d’abord complètement vides sous leurs couvertures et leur contenu, permettant d’imaginer autre chose et de susciter des émotions (et donc de la couleur), apparaîtra grâce à la présence des jumeaux, tout comme le contenu du monde fictionnel se déploiera et se colorera progressivement grâce à l’intérêt croissant de ses personnages pour le changement. Les livres deviennent alors un moyen de voyager pour les habitants de Pleasantville, avant qu’apparaissent, à la toute fin du film, des prolongements de leur monde vers d’autres destinations, et ils gagnent rapidement de la popularité auprès des jeunes. Aussi, la lecture est-elle associée dans ce film à la découverte de nouveaux horizons et à la transformation ; transformation que l’on retrouve chez une lectrice imprévue, le personnage de Jennifer. Contre toute attente, sa présence à Pleasantville amène cette non-lectrice dans la réalité à la lecture dans le monde fictionnel, comme si son voyage dans celui-ci l’ouvrait à des possibilités jusque-là inexplorées et même, qu’elle y recevait l’influence du personnage qu’elle « remplace », Mary Sue. On verra que ce personnage appartient à un type spécifique et qu’il joue un rôle particulier dans les fictions où il se trouve, étroitement lié à la lecture.
Le livre comme ouverture sur l’ailleurs
Le mode d’apparition de l’objet-livre dans le film souligne l’importance des lecteurs dans l’élaboration des mondes fictionnels et leur lien avec la découverte d’un ailleurs. Après qu’il a montré aux pompiers de Pleasantville comment éteindre un feu allumé accidentellement par le désir grandissant de sa mère fictionnelle, Betty, le personnage de David-Bud est interrogé par les autres jeunes gens sur sa connaissance du feu – auparavant inconnu dans ce monde – et, éventuellement, sur ce qui existe en dehors de Pleasantville. Après quelques réticences, encore soucieux de préserver l’intégrité de leur monde qui se transforme pourtant progressivement, il leur répond : « There are some places that the road doesn’t go in a circle. There’s some places where the road keeps going./Keeps going !/Keeps going ?/Yeah, yeah, it just keeps going, it all keeps going: roads, and rivers, and10… » Il est alors interrompu par un personnage qui nomme le « mighty Mississipi11 » et lui montre le livre (à la couverture verte) de Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn. Alors que jusque-là les livres étaient vides, celui-ci contient visiblement du texte, apparu, explique Jennifer, lorsqu’elle a commencé à raconter les passages dont elle se souvenait, à la demande des autres jeunes. Le livre est ainsi mis en parallèle avec le monde hors-Pleasantville à partir du rapprochement entre les rivières et le Mississippi décrit dans le roman de Mark Twain. Il semble que cette scène met en avant le texte du lecteur tel qu’il a été décrit par Catherine Mazauric, Marie-José Fourtanier et Gérard Langlade, c’est-à-dire comme reconfiguration du texte par la lectrice ou le lecteur12. En effet, le livre est d’abord vide jusqu’à ce que Jennifer puis David racontent leurs souvenirs de lecture, faisant ainsi apparaître le texte sous leurs yeux. Pour exister, le texte nécessite donc d’être « activé » ; les pages auparavant blanches matérialisent ainsi le statut d’un texte qui « n’existe » pas sans lecteurs.
Les « blancs » ou lieux d’indétermination décrits par Wolfgang Iser13 sont, on le sait, nécessaires à l’activité créatrice des lecteurs et inhérents aux mondes fictionnels, considérés comme incomplets. Un texte entièrement composé de blancs, comme c’est le cas pour les livres de Pleasantville, empêche toutefois l’activité lectorale – les personnages de la ville ne deviennent lecteurs qu’à partir du moment où les livres se remplissent au moins partiellement. On peut néanmoins prolonger le concept de texte du lecteur à partir des livres vides du film et se demander si le texte littéraire n’est pas simplement une « trame fictionnelle, support de projections fantasmatiques et idéelles14 » comme le suggère Catherine Mazauric, Marie-José Fourtanier et Gérard Langlade dans leur ouvrage. Dans la scène évoquée, lorsque David raconte la suite des Adventures of Huckleberry Finn à partir de l’épisode du radeau (là où les souvenirs de lecture de Jennifer s’arrêtaient et, ainsi, les lignes apparues sur les pages blanches), il décrit l’évasion de Huck et de l’esclave ainsi : « They were running away, Huck and the slave15. » Il ajoute ensuite qu’en remontant la rivière, les deux personnages s’aperçoivent qu’ils sont en réalité déjà libres : « They were going up the river trying to get free and in trying to get free, they see that they’re sort of free already16. » Or, la lecture du texte de Twain révèle qu’il ne correspond pas à la description qu’en fait le personnage : les protagonistes fuient, mais ne se sentent pas plus libres pour autant et craignent toujours d’être repérés. Le roman constituerait ici un support de projection pour David, qui y superpose, en se le remémorant, ses propres désirs vis-à-vis de sa situation dans le monde fictionnel de Pleasantville. En effet, on le voit tenter de contacter le réparateur de télévision responsable de son arrivée à Pleasantville à quelques reprises à l’aide de la télécommande pour s’échapper de la série télévisée. Aussi ses souvenirs de lecture à propos des aventures de Huck font-ils du texte une trame pour exprimer le retournement qu’il est en train d’éprouver pour Pleasantville ou du moins pour sa présence dans le monde de la série télévisée, qu’il appréciait davantage lorsqu’il le regardait de l’extérieur. Grâce aux souvenirs de David, l’œuvre de Twain entre aussi en résonance avec le monde de Pleasantville, introduite par le désir de ses personnages de connaître un ailleurs, garant de leur liberté. Le film met ainsi l’accent sur la mobilité des œuvres littéraires, telle que la décrit Pierre Bayard : « les livres ne sont pas des objets stables, mais des organismes vivants qui réagissent au contact de tout lecteur et de tout inconscient17 ». D’ailleurs, dans cette scène, on entend la chanson Take Five de Dave Brubeck, connue pour bousculer la rythmique traditionnelle du jazz avec une écriture musicale établie sur une mesure à cinq temps (plutôt que quatre), invitant ainsi à considérer les nouvelles possibilités d’une structure établie.
Les livres deviennent alors très populaires auprès des jeunes de Pleasantville, qui font la queue à la bibliothèque, se font la lecture à voix haute à Lover’s Lane, un parc où se rencontraient autrefois chastement les amoureux, et deviennent de plus en plus colorés. Dans un monde désireux de conserver sa simplicité et ses manières plaisantes, les livres deviennent dérangeants, entraînent de vives réactions, puis ils sont interdits, en même temps que l’accès à certains lieux, aux personnages « de couleur » (colored), dans une nouvelle forme de ségrégation raciale. L’intolérance vis-à-vis des livres et la discrimination envers les personnages colorés s’aggrave rapidement : les livres sont brûlés, dans une allusion évidente aux autodafés nazis, tandis que les personnages colorés sont pourchassés.
De la série télé à la lecture
Tandis que le monde de Pleasantville possède déjà une influence sur la vie du personnage de David avant qu’il ne s’y retrouve, il apparaît a priori étranger à sa sœur jumelle qui considère la série télévisée comme dépassée et ridiculement sage. Aussi, lorsque les adolescents arrivent dans ce monde, est-elle moteur de nombreux changements chez ses habitants, peu soucieuse, à l’inverse de son frère, de préserver l’intégrité de la fiction et de ses personnages. La première touche de couleur qui s’y introduit, une rose rouge, apparaît d’ailleurs à la suite de la première rencontre amoureuse de Jennifer-Mary Sue avec son prétendant, Skip Martin (Paul Walker), dont l’existence est bouleversée par sa découverte suggérée de la sexualité, auparavant inexistante à Pleasantville. Lorsque le lendemain celui-ci partage son expérience avec les membres de son équipe de basket-ball, tous ratent ensuite leur tir au panier, ce qui ne s’était jamais produit auparavant dans ce monde parfait où tous les ballons atteignent les paniers sans effort ni exception. Dans sa recherche de popularité, sa volonté d’intervenir sur le monde fictionnel et l’expression d’un désir attendu – et somme toute formaté – dans son monde à elle, Jennifer semble être toutefois progressivement transformée en retour, comme si le personnage de Mary Sue qu’elle incarne ou le monde dans lequel elle se trouve l’influençait.
La transformation la plus importante et la plus intéressante concerne son appropriation de la lecture. N’ayant presque jamais lu dans le monde réel, ce personnage s’intéresse tout à coup à un livre qui lui semble « sexy », Lady Chatterley’s Lover de D.H. Lawrence, lorsque que la bibliothèque municipale de Pleasantville se garnit. On la voit successivement dans plusieurs étapes de sa lecture : sur son lit, à son bureau, et même refusant de voir son amoureux pour continuer sa lecture plutôt que de s’adonner à ce qui constituait le centre de sa vie jusqu’alors. Alors qu’il lit à son bureau, le personnage aperçoit « ses » lunettes (c’est-à-dire celles que porte normalement Mary Sue, tandis que Jennifer n’en possède pas dans le monde réel) et les chausse pour continuer sa lecture. Ce détail paraît significatif d’une transformation plus globale du personnage qui semble marqué par son double fictionnel, présenté comme plus studieux. Au-delà d’un accessoire travestissant le personnage, les lunettes introduisent un double regard qui fait signe vers l’entremêlement des mondes de Mary Sue et de Jennifer, en offrant une autre vision à celui-ci. La circulation entre les mondes réel et fictionnel qui s’opère dans Pleasantville a donc pour résultat « d’encourager les personnages fictionnels à l’autonomie18 » comme l’a signalé Pierre Bayard à propos de Sherlock Holmes dans son ouvrage L’Affaire du chien des Baskerville, et d’appuyer la théorie des textes possibles, qui se fonde sur les ouvertures des œuvres. L’enchevêtrement des mondes fait aussi naître un besoin d’ailleurs chez Jennifer, qui se manifeste chez celle-ci par la lecture, capable de la changer, elle, dans un monde où elle introduit des changements. La transformation du personnage est rendue visible lorsqu’elle se réveille le lendemain matin auprès de son livre et apparaît maintenant en couleur, alors qu’elle s’inquiétait jusqu’alors d’être toujours en noir et blanc, comme si le livre lui avait procuré des émotions plus intenses que celles qu’elle recherchait dans le flirt. Cela rejoint le propos de Marielle Macé qui attire notre attention sur le désir impliqué dans la lecture et nous invite à « penser la lecture, du moins la lecture des fictions préférées ou l’expérience du romanesque, […] selon les modalités quotidiennes du désir, du désir figuré comme un voyage et comme la projection d’un monde possible19. » Ainsi, le désir de Jennifer pour la lecture est intimement lié au besoin d’un autre horizon, dont on peut imaginer qu’il se situe notamment dans l’esprit pour elle, par opposition au corps ou en équilibre avec lui. C’est ce que suggère le choix de Lady Chatterley’s Lover, qui a notamment pour thème l’équilibre entre le corps et l’esprit ; il porte aussi, et surtout, sur le désir féminin déçu, puis comblé. La présence du livre à Pleasantville fait d’ailleurs écho à la situation de Betty, la mère de la famille Parker, uniquement considérée (dans l’esprit de la série télévisée) comme une ménagère par son mari, même lorsque les choses commencent à évoluer, et qui devient l’amoureuse de Bill Johnson (Jeff Daniels), le propriétaire du soda shop où travaille David-Bud.
L’entremêlement des deux mondes se confirme pour le personnage de Jennifer-Marie Sue, lorsqu’elle choisit, dans un revirement par rapport au début du film, de rester à Pleasantville (dorénavant coloré) pour aller à l’université, qui semble être apparue en même temps qu’une ville voisine. Jennifer profite ainsi d’une opportunité qui ne s’offrait pas à elle dans la réalité, tandis que son frère, lui, retourne dans le monde réel par l’intermédiaire de la télécommande. La lecture de fiction révèlerait ainsi, comme l’ont montré Catherine Mazauric, Marie-José Fourtanier et Gérard Langlade dans un séminaire inédit, les « autres » qui composent le lecteur à son insu20. Le film suggèrerait même que nos autres existent dans des mondes parallèles et qu’ils peuvent se manifester et enrichir notre subjectivité, appuyant ainsi les théories qu’expose Pierre Bayard sur la coexistence littérale et l’influence des univers parallèles dans son ouvrage Il existe d’autres mondes21. C’est d’ailleurs sur ce point que le personnage de David attire notre attention lorsqu’il affirme, au procès où il est accusé d’avoir peint une fresque en couleurs, que celles-ci font partie de nous, comme autant de possibilités qui s’offrent à nous. Il dit alors : « It can’t stop at once because it’s in you and you can’t stop something that’s inside you22. »
Par ailleurs, le prénom Mary Sue attire notre attention sur la fonction métadiscursive du film car il appartient au registre de la fan fiction, constituée de récits écrits par des admirateurs pour prolonger un univers fictionnel qu’ils affectionnent, et au discours critique qui la concerne. Devenu un nom commun au même titre que Tartuffe ou Don Juan, une Mary Sue désigne un personnage trop parfait pour être réaliste, perçu par les lecteurs comme une intrusion de l’auteur et servant à combler ses désirs vis-à-vis de l’univers fictionnel, dans ce que Tisha Turk nomme un « excès métaleptique23 ». Le personnage de Pleasantville n’est certes pas une intrusion du réalisateur Gary Ross et son prénom s’intègre parfaitement dans l’imaginaire de la culture populaire américaine des années 1950, où les filles s’appellent, comme les amies de Mary Sue, Betty Jean, Lisa Ann ou Peggy Jane. Dans la peau de Mary Sue, Jennifer fait néanmoins intrusion dans le monde Pleasantville et s’oppose à ses limites, déconstruit sa binarité, questionne ses valeurs. Selon Anupam Chander et Madhavi Sunder, une Mary Sue peut « challenge a patriarchal, heterosexist, and racially stereotyped cultural landscape... [she can] rewrite the story to revalue [our] place in it... [Mary Sue] offers important epistemological interventions in the reigning discourse, confronting the traditional production of knowledge by reworking the canon [via] ... commodity resistance – a strategy of popular struggle through the resignification of common goods24. » Sa présence même signifie une remise en question qui semble applicable à notre manière de considérer le monde et le sujet, qui gagnent à être décrits comme pluriels et donc en couleur, selon la métaphore exploitée dans le film. Elle sous-entend également une figure de lectrice ou de lecteur, puisque les Mary Sue sont intégrées à un récit par des lecteurs admiratifs voulant prolonger et/ou modifier un texte déjà existant. Elle inscrit donc la lecture comme processus actif permettant une réécriture des œuvres à travers un filtre singulier, mêlant critique et désir et menant à une perméabilité des frontières entre réel et fiction.
Conclusion
Le film Pleasantville invite donc, comme le décrit Marielle Macé à propos d’une approche de la fiction qui repose sur les mondes qu’elle élabore, à « un questionnement “écologique” qui insiste, sur la réintégration des univers fictionnels dans le nôtre, sur la co-présence, dans nos vies, de plusieurs espaces de références mobilisés en synchronie25 ». Son mélange de la couleur et du noir et blanc dans de mêmes plans renverse notre compréhension de l’image cinématographique comme homogène telle qu’elle a été décrite par André Bazin26. La superposition de registres diégétiques que provoque l’hétérogénéité chromatique va de pair, il me semble, avec un entremêlement des mondes fictionnel et réel que le rôle des livres et la présence de la « lectrice métaleptique » viennent incarner.
La manière dont le film se conclut, avec David qui rentre dans le monde réel et console sa mère et Jennifer qui reste à Pleasantville pour aller à l’université, laisse penser que les mondes de fiction sont perçus très diversement et que chacun y trouve son compte à sa manière. En effet, alors que David était passionné par la série télévisée, qui lui procurait la satisfaction (à distance) d’un monde rassurant, lisse, stable qui s’opposait à sa réalité (difficile) dans une famille dysfonctionnelle et une conjoncture socioéconomique laissant présager le pire, il choisit de quitter ce monde (transformé) pour, on le suppose par son geste auprès de sa mère, s’impliquer davantage dans sa vie et participer à transformer aussi ce monde qui ne lui convient pas. Jennifer, qui, elle, croyait posséder une vie idéale, marquée, finalement, par une conformité sociale et sexuelle suggérée par ses pairs, découvre un désir bien plus personnel, qui l’intime à rester dans un monde plus en accord avec elle-même. Pleasantville met ainsi en scène, à l’aide des livres et du travail de la couleur, signe d’un entremêlement des mondes, les possibilités de la lecture de fiction et la souplesse des mondes dans lesquels nous sommes impliqués.